Introduction
Et si la remédiation des revues savantes passait moins par une réflexion sur les enjeux techniques de l’édition numérique que sur les dispositifs et dynamiques conversationnelles ? Avant de poursuivre cette piste dans le présent chapitre qui clôturera la thèse, je voudrais rappeler le chemin parcouru jusqu’à présent afin de souligner à nouveau le changement de perspective qui me semble devoir s’imposer.
Dans la première partie, j’ai posé un cadre général pour comprendre les origines et les enjeux fondamentaux des revues scientifiques en lettres et sciences humaines. Il s’agissait de considérer d’abord la revue au prisme de son format, conçu à la fin du 17ème siècle à partir de la forme épistolaire. La pratique de cette dernière est reconnue pour avoir largement contribué à la circulation des connaissances et à leurs mises en conversation au temps de la République des lettres. Les formes de l’article, conjointement à celle de la revue scientifique, se sont rapidement institutionnalisées établissant un régime d’autorité et de légitimation bien spécifique implémenté par le protocole éditorial. Mais ce régime, on l’a vu, est entièrement assujetti à l’univers de l’imprimé, aussi bien sur le plan économique que juridique et épistémologique. Or, de l’univers de l’imprimé à l’environnement numérique, les formes de communications scientifiques et en particulier la revue, sont remises en question par les nouvelles pratiques d’écriture et de lecture. À partir de ce constat, une première ouverture théorique se dessine grâce à Louise Merzeau, pour envisager une forme de communication réconciliant un régime documentaire et un régime social de production de connaissance. Dans un texte programmatique analysant un « dispositif d’éditorialisation » imaginé pour catalyser une conférence scientifique, Merzeau nous laisse en effet des pistes de réflexion pour penser une conversation de fragments et d’individus à travers ce que je qualifierai d’écritures dispositives. C’est notamment ce concept que nous allons explorer plus en avant dans cette partie, en le reliant à une théorie de l’éditorialisation.
Dans la seconde partie, je suis revenu sur mon étude de terrain auprès des éditeurs de revues en littérature et sciences humaines, dans le cadre du projet de recherche Revue 2.0 soutenu par la Chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques. En interrogeant cette fois plus particulièrement les protocoles éditoriaux des revues, il s’agissait de saisir la chaîne de décisions autorisant un texte à la publication. Cette étude a révélé les constantes négociations qui ont cours au sein des rédactions éditoriales. D’un côté, les négociations entre acteurs humains qui mettent elles-mêmes en lumière diverses discussions d’ordre scientifique et témoignent de la fragmentation des rôles et des positions. D’un autre côté, une négociation entre un modèle éditorial idéalisé censé garantir la légitimité des textes, des auteurs et de la revue, et la réalité des pratiques. L’analyse des entretiens menés lors de mon enquête suggère ainsi que la revue comme espace, c’est-à-dire comme dispositif légitimant, peut s’ouvrir plus largement encore à la conversation. Car si la conversation est déjà présente dans les protocoles institutionnalisés hérités de l’univers de l’imprimé, elle ne demande qu’à se réaliser autrement, selon des pratiques conversationnelles déjà répandues, propres à la culture numérique, et que la revue scientifique pourrait œuvrer à institutionnaliser comme forme de communication scientifique.
La conversation est une connaissance
C’est donc à ces pratiques conversationnelles et aux « écritures dispositives » que je consacre ce dernier chapitre, en appuyant mon travail conceptuel sur plusieurs cas d’études auxquels j’ai moi-même pris part. Si tel que je l’ai mentionné plus tôt, j’opérerai ici un pas de côté en me concentrant d’abord sur des initiatives conversationnelles qui excèdent le champ de la revue scientifique, ce n’est que pour mieux y revenir en fin de partie. Le changement de perspective que je propose consiste à considérer la conversation comme un mode de production des connaissances à part entière, avançant l’hypothèse – et des pistes de conception – d’un modèle éditorial conversationnel. Cette vision de la conversation s’inscrit dans un contexte de reconceptualisation de la conversation en lien avec les nouvelles sociabilités de l’environnement numérique, et plus largement avec la culture numérique telle que Milad Doueihi la définit et dans laquelle s’inscrit la culture participative théorisée par Henry Jenkins. Tout comme Doueihi associe la culture numérique aux paradigmes philosophique et juridique adoptés par le monde informatique (Doueihi 2011), Jenkins érige la culture participative héritière du même terreau idéologique de l’ouverture et de la transparence (Jenkins 2006).
Évidemment, une telle reconceptualisation n’est pas sans risque, et a d’ailleurs déjà fait l’objet de critiques. Mais en inscrivant l’hypothèse de la conversation comme forme de communication scientifique dans cette culture participative, il ne s’agit pas de verser dans le « programme de vérité »Jahjah emprunte ce terme à Paul Veyne (historien de l’antiquité gréco-romaine) pour complexifier notre rapport à l’idéologie : « En parlant de ‘programmes de vérité’ […], nous évitons de réfléchir uniquement en termes de manipulation ou d’influence pour comprendre comment et pourquoi les programmes s’ajustent aux personnes ou à des collectifs de personnes, sans nier pour autant la part de cœrcition ou les rapports de force qui peuvent s’instaurer dans ces programmes et entre des programmes. » (2018, sur Hypothesis)
du web 2.0 dont Marc Jahjah déconstruit patiemment le méta-discours (Jahjah 2018). Il ne s’agit pas non plus de céder aux injonctions à la participation, réduite, avec la plateformisation du web, à un levier de marketing. Dans une série de billets de blog dédiés à « l’annotation comme “conversation” », Jahjah a en effet noté « que les industries du web dit social ont fait [de la conversation] leur paradigme jusqu’à l’assécher »Marc Jahjah source son propos avec un dossier de revue à charge contre un « marketing conversationnel » (Patrin-Leclère 2011).
(Jahjah 2019, sur Hypothesis). Gérard Wormser en dénonce d’ailleurs la menace que font peser le modèle conversationnel de certaines plateformes sociales sur le tissu social et la démocratie« Or l’engagement civique, s’il résiste aux dictatures, est tout aussi indispensable aux démocraties. Mais le terme d’engagement, aujourd’hui repris par les publicitaires, désigne la sensibilité des internautes qui cliquent pour approuver ou commenter le propos d’autrui. Zuckerberg a beau jeu de vanter l’avenir des conversations entre pairs, rappelons que nous devons nos libertés à des consciences qui se sont levées pour résister aux secrets d’État, non à des bavards qui commentent des ragots ou partagent des vidéopromotionnelles. » (2018, 128 sur Hypothesis)
(Wormser 2018).
Pour éviter ces écueils, je m’appuierai sur l’intuition optimiste de Louise Merzeau qui, tout en se méfiant de « l’injonction conversationnelle des réseaux sociaux » (2013b, sur Hypothesis), voyait dans le dispositif d’éditorialisation de la conférence ENMI12 un « modèle de transmédia documentaire [comme] une alternative aux modes d’agrégation fondés sur l’audience, la vitesse et l’affinité » (2013b, sur Hypothesis). Comme nous l’avons vu dans le premier chapitre, le régime attentionnel des plateformes maintient davantage une illusion conversationnelle, illustrée par la gouvernance algorithmique du lien social. C’est ainsi que s’orchestre la déprise de nos pratiques sociales et scripturalesÀ ce sujet, je renvoie au chapitre 1, voir sur Hypothesis.
. La conversation dont je parle s’agence au contraire selon un régime social vertueux, porté par des dispositifs d’éditorialisation dont une particularité est de permettre la déprise, ou plus exactement d’inciter à agir sur le dispositif.
La partie qui va suivre est par ailleurs redevable de la pensée inspirante de l’américain David Lankes, qui entre d’ailleurs tout à fait en résonance avec la vision de Louise Merzeau. Professeur en sciences de l’information à l’Université South Carolina, David Lankes est avant tout un bibliothécaire dans la tradition des “librarians” à l’anglo-saxonne tournée vers la valorisation des ressources, plutôt que leur conservation. Lankes envisage ainsi les concepts de connaissance ou de conversation selon l’angle bien spécifique de la communauté d’usagers des bibliothèques. Or il associe étroitement les concepts de conversation et de connaissance :
Pour les bibliothécaires, ce que j’appelle « connaissance » signifie le réseau de croyances interreliées qui orientent notre comportement. Et ce réseau se construit via les conversations et les actions que nous menons de notre côté, mais également au sein de nos communautés (Lankes 2016, 26)
Ainsi, la connaissance selon Lankes n’est pas la somme des artefacts éditoriaux stockés dans le rayonnage ou les bases de données des bibliothèques, mais un processus conversationnel relevant d’une expérience individuelle ou collective. Les traducteurs de son ouvrage “Expect More” voient ici un « processus infini de transformation qui, à chaque fois, invite à l’action » (Lapointe et Martel 2019). Dans sa vision relationnelle de la connaissance, l’enjeu ne réside pas dans le régime de vérité auquel participent l’édition savante ou encore la bibliothèque, censées garantir et instituer les textes (ouvrages, articles ou autres formes). Au contraire, la connaissance est toujours relative au contexte dans laquelle elle est performée, et transitoire, car liée à l’action ou à sa performance – performance dont les bibliothèques sont le lieu privilégié : ce que Christian Jacob appelle effectivement un lieu de savoir (Jacob 2007).
On retrouve d’ailleurs dans cette pensée un élément qui me semble fondamental dans l’évolution de la fonction éditoriale. Là où je considère que la fonction de l’éditeur doit désormais se concentrer sur les conditions de l’appropriation et non plus sur les conditions d’accès à une ressource, Lankes opère un glissement similaire pour le bibliothécaire qui doit selon lui se positionner avant tout comme « facilitateur des conversations », et non comme gestionnaire de ressources. Tout comme l’appropriation, que j’entends comme une réécriture interprétante, la conversation de Lankes est une transformation des ressources « en données partagées et partageables » (Lapointe et Martel 2019). Il appelle en quelque sorte les bibliothécaires à créer les conditions de possibilité de la conversation, notamment en développant et en transmettant ce qu’il appelle une « littératie conversationnelle », à savoir une capacité à transformer les ressources offertes par les bibliothèques.
À partir de cette conceptualisation de la conversation, et au regard de l’explosion des pratiques d’écriture et de lecture, notamment conversationnelles, je souhaite proposer une évolution radicale des modes de communication scientifique. Ainsi, ma thèse vient d’une part considérer la forme conversationnelle comme paradigme de production de connaissances, et d’autre part déplacer l’enjeu fondamental du processus de communication vers le collectif qu’il fait advenir. Je montrerai à travers différents cas d’études qu’au-delà de la production de nouveaux artefacts ou d’un document de référence, l’édition scientifique pourrait s’emparer de la conversation et adopter un régime d’écriture et d’éditorialisation processuel, dont l’élément le plus tangible serait alors le réseau social, autrement dit le collectif, qui ne cesse de se former. Cette partie conceptualise ainsi la revue comme collectif, incarnant à la fois la possibilité d’une intelligence collective et la redécouverte d’un nous.
Une réflexion située
En tant que contributeur ou initiateur, j’ai pu participer pendant le doctorat à une série d’expérimentations, d’initiatives ou d’événements scientifiques adressant d’une manière ou d’une autre les questions de l’écriture, de l’édition et de la publication. Ces activités, menées au cœur ou à la marge de mes recherches à la CRC-EN, présentent toutes un lien fort à mon hypothèse de recherche, la conversation comme mode de production et de communication scientifique. Elles en explorent cependant des manifestations différentes, ouvrant la voie d’une part à une collecte de données diversifiée et cumulative, et d’autre part à une analyse comparative de leur·s dispositif·s. Une constante demeure malgré tout d’une expérimentation à l’autre, tant chacune a pu, à sa manière, impliquer ou supposer l’intervention d’un collectif. Nous le verrons, les collectifs engagés ici et là ne sont pas de même nature. Un des enjeux de cette partie sera d’en identifier les variables, les constantes, et de décrire ce qui les a fait.
Les descriptions qui vont suivre sont parfois très détaillées et s’appuient sur un archivage riche des échanges et de la documentation de chaque processus. Cela n’est pas un hasard, car la valeur réelle des résultats se situe davantage dans le processus que dans les artefacts ou les productions documentaires. Aussi, bien que ma démarche puisse parfois sembler archéologique, il me semble important de rendre compte de la fabrique des dispositifs pour en saisir les enjeux en matière de conversation et de collectif. S’il est en effet tentant de concentrer nos analyses sur les artefacts produits, dans leur matérialité ou leur sémiologie, le collectif apparaît beaucoup plus ténu et insaisissable, voire énigmatique (Choplin 2020). Comment identifier le collectif ? Comment le décrire, dans sa forme, ses jeux d’autorité, ses intentions, si ce n’est en enquêtant sur les traces qu’il a laissées en s’élaborant ? Pour certains des projets, ces traces témoigneront de la nature processuelle de l’écriture et de l’éditorialisation dans l’espace numérique, celle-là même que Marcello Vitali-Rosati a théorisé (2018), et que Louise Merzeau identifiait dans l’environnement-dispositif des ENMI2012 :
Si les dispositifs d’éditorialisation par le réseau relèvent de l’action, ce n’est pas uniquement en vertu de leur dimension participative. En amont des processus d’échange, de partage et de contribution, c’est le tissu médiatique lui-même qui induit une logique processuelle de tressage, de butinage et de mouvement. Plus que de contenus, on devrait d’ailleurs plutôt parler de ressources, car le contenu proprement dit ne préexiste pas au dispositif d’accès : il est le produit d’une suite de transformations dispositives. (Merzeau 2013b, sur Hypothesis)
Ce passage est important, car il pointe le changement de nature de la production des connaissances survenue dans un dispositif conversationnel, à savoir le passage d’un statut de contenus auquel l’usager accède, à un statut de ressources disposées. Elles sont en effet disposées dans l’espace d’une part, c’est-à-dire inscrites et posées dans un agencement, et à disposition d’autre part, c’est-à-dire accessibles et appropriables. Ces ressources n’existent que dans la synergie établie entre elles et l’environnement d’écriture qui les agence. « Transformations dispositives », ou « actions dispositives », l’écriture, dans cette dynamique processuelle, agit. Cette performativité de l’écriture intervient autant dans l’environnement, en y inscrivant de nouvelles ressources, que sur l’environnement en contribuant à le structurer ou à l’aménager.
L’environnement n’est pas le seul acteur à se trouver ainsi agit. Louise Merzeau suggère que le collectif émerge précisément de cette écriture processuelle, en particulier lorsqu’il accède à une certaine réflexivité sur les processus dans lesquels il est engagé. C’était le cas effectivement lors de l’événement analysé en 2012 par Merzeau, pour lequel plusieurs visualisations représentaient la communauté et ses écritures dans des synthèses visuelles interactives mises à jour en temps réel.
La mise en visibilité des processus mêmes de production sert alors à la fois de boussole et de régie, et fait exister la communauté des contributeurs à travers l’image de sa propre dynamique contributive. (Merzeau 2013b, sur Hypothesis)
Dans la présente thèse, l’analyse des dispositifs relève davantage d’une archéologie que d’une mise en visibilité du collectif. Pourtant, il est permis de penser que l’identification de certaines traces du collectif ou de ce qui a fait collectif fournira des éléments nouveaux pour concevoir des dispositifs. Ces traces issues d’un relevé archéologique sont des pistes pour envisager de nouvelles visibilités des processus collectifs et permettre de nouvelles réflexivités du collectif sur lui-même.
Il y a ainsi un parallèle à creuser entre la façon dont ces écritures agissent l’environnement-dispositif d’un côté et le collectif de l’autre. Est-ce qu’identifier les mécanismes de l’un peut nous éclaircir sur le second ? Comment fonctionne cette triade composée d’un environnement-dispositif, d’écritures dispositives et d’un collectif ? Et pour ne pas perdre de vue la question de la communication scientifique, qu’est-ce qui se joue au plan épistémologique dans ces dynamiques collectives ?
Panorama des cas d’études
Dans le cas de l’ouvrage collectif « Version 0. Notes sur le livre numérique », le collectif transparaît de l’écriture et de l’édition elle-même. De l’édition, en premier lieu, car les contenus de l’artefact produit – un ouvrage numérique homothétique au format EPUB et PDF – ont été compilés par un groupe de personnes dédiées. De l’écriture en second lieu, puisque les contenus de l’ouvrage sont des fragments agrégés des écrits et des paroles des intervenants communiqués lors d’un colloque hébergeant cette expérimentation éditoriale. Outre le condensé de discours et un panorama des positions prises par les intervenants sur le thème du livre numérique, se tisse aussi dans ces agrégations une cohésion d’individus rassemblés autour d’un même sujet.
J’introduirai ensuite une réflexion sur la notion de milieu en m’appuyant d’une part sur la pensée de Louise Merzeau et d’un autre part sur l’étude que j’ai pu mener avec Servanne Monjour autour du collectif littéraire Général Instin. Je montrerai en quoi ces réflexions se rejoignent et laissent entrevoir une conceptualisation écologique de l’écriture, une écriture-milieu.
Mon troisième cas d’étude portera sur l’événement Publishing Sphere, une initiative de la CRC-EN dont j’ai été co-organisateur. Ces trois jours d’événement, rassemblant une trentaine d’auteurs, d’artistes, d’éditeurs, de chercheurs, ont constitué un intense moment de réflexion et de production avec l’objectif d’expérimenter et de créer de nouvelles formes de publications. Aventure collective s’il en est, Publishing Sphere a été le lieu d’une synergie émergeant du groupe et de sa performance, selon un phénomène similaire aux événements axés sur la réalisation de projets dans un temps très limité (hackathon, Museomix, etc.). Une certaine récursivité s’est établie entre la thématique de l’événement et son dispositif. D’un côté, il s’agissait de repenser l’espace public à partir de nouvelles formes de publication et d’éditorialisation, tandis que de l’autre, le dispositif de l’événement créait de fait une sphère publique (ou de publication) favorisant la conversation, dans le but affiché de faire émerger de nouveaux modes de production de connaissances.
Je m’appuierai enfin sur le dossier « Écrire les communs. Au-devant de l’irréversible », publié dans la revue Sens public, sur une initiative commune de Sylvia Fredriksson et de moi-même (2019a). La thématique du dossier interroge directement mon objet de recherche, puisque nous nous sommes intéressés aux écrits issus de la communauté des communs dans leur travail de documentation, de communication ou de portage juridique des règles et principes de gouvernance. Ces éléments et ce dossier viennent ainsi suggérer que d’autres communautés d’écriture que la communauté académique ont développé des écritures collectives susceptibles d’inspirer les formes académiques de production de connaissances. Par ailleurs, dans l’intention d’appliquer au projet les principes des communs que nous voulions étudier, le dossier a délibérément cherché à se constituer en collectif, réuni dans une écriture collective faite d’échanges, de lectures mutuelles, et d’annotations. La revue Sens public a su jouer le jeu de l’expérimentation en acceptant des modalités particulières de publication, à savoir une évaluation collégiale entre auteurs du dossier, une édition continue et au fil de l’eau des articles, qui furent publiés dans leurs versions successives. L’aspect conversationnel s’est ainsi installé à plusieurs niveaux, dans le fonctionnement collégial du protocole éditorial tout d’abord, puis dans les marges des textes en rédaction.
Vers un protocole conversationnel ? Le cas de l’ouvrage version 0
L’ouvrage collectif « Version 0. Notes sur le livre numérique » est né de l’intention initiale des organisateurs du colloque ÉCRIDIL de MontréalVoir ÉCRIDIL 2018 – Écrire, éditer, lire à l’ère numérique sur le site du colloque.
de produire un livre numérique avec « l’idée d’ouvrir les problématiques, les réflexions et les corpus du colloque à un public élargi, le plus vite possible – “à chaud” juste après le colloque » (Audet et al. 2018, 9‑10). Depuis sa première édition à Nîmes en 2016, le colloque ÉCRIDIL a vocation à engager une réflexion interdisciplinaire sur le livre et l’édition numérique, en mettant en conversation des théoriciens et des praticiens. En 2018, la seconde édition du colloque à Montréal a poursuivi cette réflexion sur le livre numérique comme artefact éditorial, autour du thème « Le livre, défi de design – L’intersection numérique de la création et de l’édition ». Adressant directement le sujet du colloque, chaque édition d’ECRIDIL a cherché à innover en proposant pour ses actes une forme éditoriale originale et alternative. Le colloque de 2016 a ainsi donné lieu à ce qui avait été baptisé des « Catal-actes », « un nouveau format éditorial qui tente de fusionner le format académique des actes de colloque et le format artistique des catalogues d’exposition » (Vial et Catoir-Brisson 2017, sur Hypothesis), dont la forme demeurait – du propre aveu des organisateurs – finalement relativement classique malgré l’intention initiale. Pour cette seconde édition à Montréal, la publication « à chaud » des éléments du colloque suggérait déjà l’ouverture d’une conversation, sur la base des éléments du colloque. L’objet issu de cette réflexion, Version0, est un petit livre au format poche, dont la chaîne éditoriale incarne le projet du colloque ECRIDIL.
On pourrait en effet qualifier l’ouvrage et son processus de création d’expérience éditoriale dans le sens où la méthode et les procédés mis en place relevaient de l’expérimentation, et ont été exécutés comme telle de manière assumée, sans garantie de succès sur l’artefact final. L’un des aspects que nous souhaitions explorer était effectivement la mise en conversation des participants entre eux d’une part et, via l’ouvrage, l’ouverture de cette conversation à un public élargi d’autre part. Pour cela, il s’agissait d’arrimer l’ouvrage à une série de dispositifs susceptibles d’amorcer une conversation, cette dernière devant s’établir sur trois niveaux. Le premier niveau était celui de la conception éditoriale de l’ouvrage, ouverte à une réflexion collective orchestrée lors d’un « atelier d’idéation ». Le second niveau consistait à faire dialoguer des éléments de sens, par la collection et l’agrégation de fragments provenant des différents intervenants au colloque. Nous convoquions donc ici le principe du collage et son précepte d’association, génératrice d’interprétation et de sens. Enfin le troisième niveau concernait l’ouverture des sources de l’ouvrage à un public élargi susceptible de se l’approprier.
L’idéal de co-conception
L’un des principes retenus pour la mise en œuvre de l’ouvrage était d’ouvrir son processus de conception aux participants du colloque lors d’un « atelier d’idéation »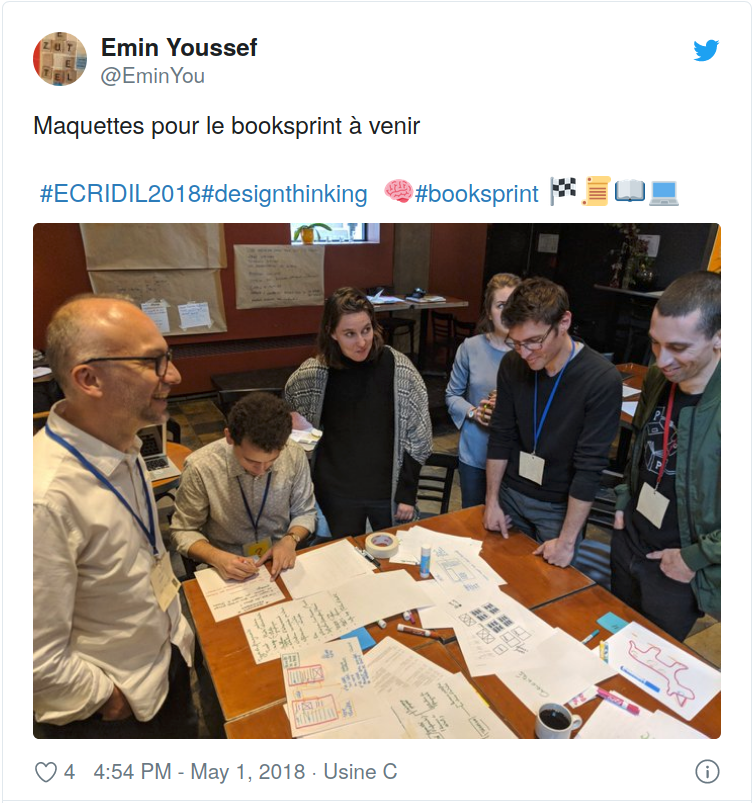 Tweet d’Emin Youssef documentant l’atelier d’idéation
Tweet d’Emin Youssef documentant l’atelier d’idéation
organisé sur une après-midi en parallèle à certaines sessions. Jean-Louis Soubret, principal instigateur de l’atelier, a souhaité utiliser ce temps collectif pour faire émerger une ou plusieurs formes éditoriales pertinentes et répondre ainsi au mieux aux objectifs de l’ouvrage. Ce principe de « co-création » faisait effectivement consensus, mais son application s’est heurtée à plusieurs contraintes. Pour certains, l’atelier avait pour objectif de définir la forme et le fond du livre, selon un dispositif de co-design précis. D’autres souhaitaient utiliser le temps particulièrement limité de l’atelier pour mettre les participants à contribution de la réalisation et non de la conception de l’ouvrage.Ces contraintes avaient déjà été identifiées avant le colloque, comme en témoignent les échanges courriels. Voir en annexe le fil « booksprint Ecridil (24/08/2018) ».
L’atelier a été un succès en termes de participation. Les échanges et les idées avancées lors de cet atelier ont été aussi riches que ludiques, mais leur état d’aboutissement ne permettait pas d’entreprendre leur réalisation dans le temps et le cadre impartis. L’objet éditorial initialement projeté par l’équipe instigatrice de l’ouvrage s’est donc imposé. Malgré cela, ce temps de réflexion collective a été utile pour créer un lien particulier entre les participants au colloque et l’équipe éditoriale qui allait poursuivre le travail d’édition. Ce lien a ainsi permis de sensibiliser la trentaine de participants aux objectifs et à la finalité du projet. Par ailleurs, en travaillant de concert avec l’équipe éditoriale sur une série de tâches collaboratives, ces participants se sont associés à une pratique créative, un faire ensemble, élargissant le collectif de pensée. Ainsi, en mettant en scène une conversation thématisée, la forme finale de l’ouvrage est entrée en résonance avec les échanges issus de l’atelier.



« Faire ensemble » pendant l’atelier d’idéation
De l’atelier – engagé dans une réflexion sur les formes possibles de l’ouvrage – à la forme retenue – une mise en conversation fondée sur l’agrégation et la synthèse visuelle de fragments du colloque – on retrouve les prémisses d’une pensée collective, mais aussi l’intention initiale de « maintenir un dialogue permanent entre forme et contenu »Voir la page de présentation du booksprint sur le site du colloque, ou ci-dessous.
. Il s’agissait précisément lors de cette expérience, de jouer de ces deux écritures, celle des énoncés de l’ouvrage, le « discours », et celle de sa « structure-code ». Dans ce lien entre forme et fond, maintenu de par les modalités d’écriture et d’édition, il s’agissait de prendre à la lettre et d’interroger dans le même temps ce rapport étroit entre la pensée et son support (d’écriture et de lecture), tel que Goody (1979) l’a théorisé.
Les différents visuels envisagés pour la couverture cherchaient spécifiquement à refléter cette approche, en donnant à voir la fabrique de l’ouvrage. Ils présentent ainsi les opérations d’édition successives enregistrées dans le registre du répertoire de travail. Les éditeurs collaboraient en effet au travers d’un répertoire d’une instance Gitlab, fonctionnant selon le protocole git. Ce protocole de gestion de versionpour version control system (VCS).
est habituellement utilisé dans un contexte de programmation logicielle, pour maintenir et versionner des fichiers de code informatique sur la durée et dans un contexte de collaboration restreinte ou ouverte. Ce n’est pas un hasard si notre expérimentation a adopté un tel protocole comme modalité d’édition et de collaboration. L’une des thèses poursuivies considère en effet qu’un énoncé ne saurait exister sans la structure qui supporte son enregistrement et sa circulation. Puisque dans l’environnement numérique l’énoncé et sa « structure-code » sont matériellement de même nature, à savoir des fichiers plain/text, il n’est pas étonnant que de plus en plus de projets éditoriaux prennent corps dans ces espaces d’écriture, aussi spécialisés soient-ils initialement. De fait, les services Gitlab, Github ou autres, élaborés sur le protocole git ajoutent une dimension métier tout à fait pertinente par rapport à la problématique du protocole éditorial et de sa fonction légitimante. En effet, si l’on conceptualise le protocole éditorial comme une organisation et une distribution de tâches, on peut lui trouver alors de très fortes correspondances avec le protocole git qui assure également, à sa manière, les différents éléments d’organisation du processus éditorial : identifier (quoi) et séquencer (quand) les tâches, les attribuer (qui doit faire quoi), les tracer (qu’est ce qui a été fait et quand), et en valider l’exécution une à une (valeur qualitative).
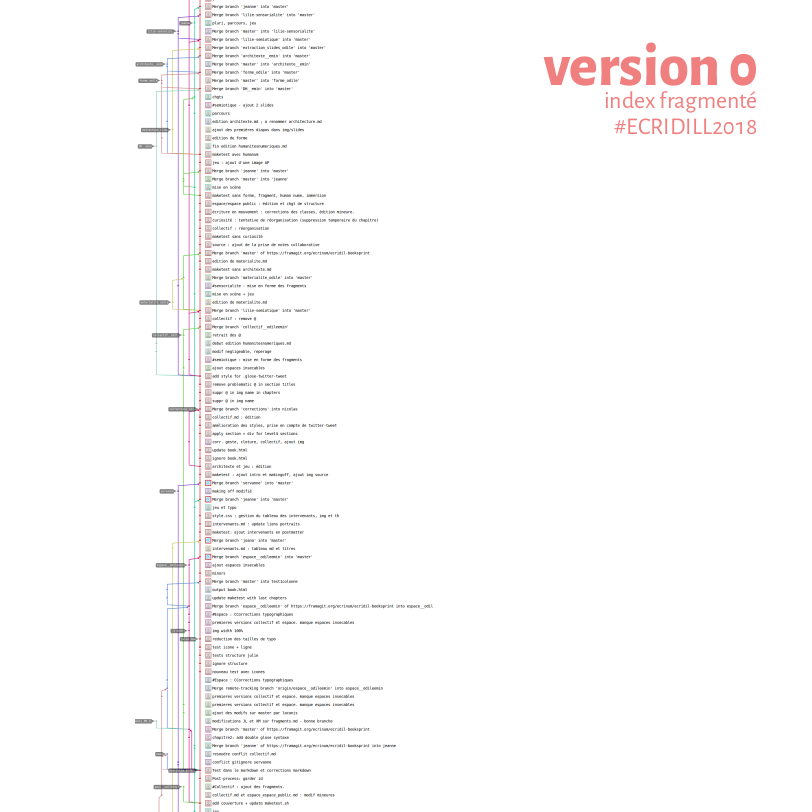
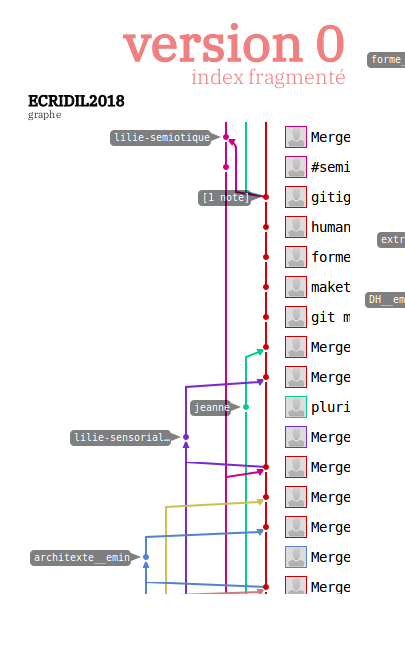
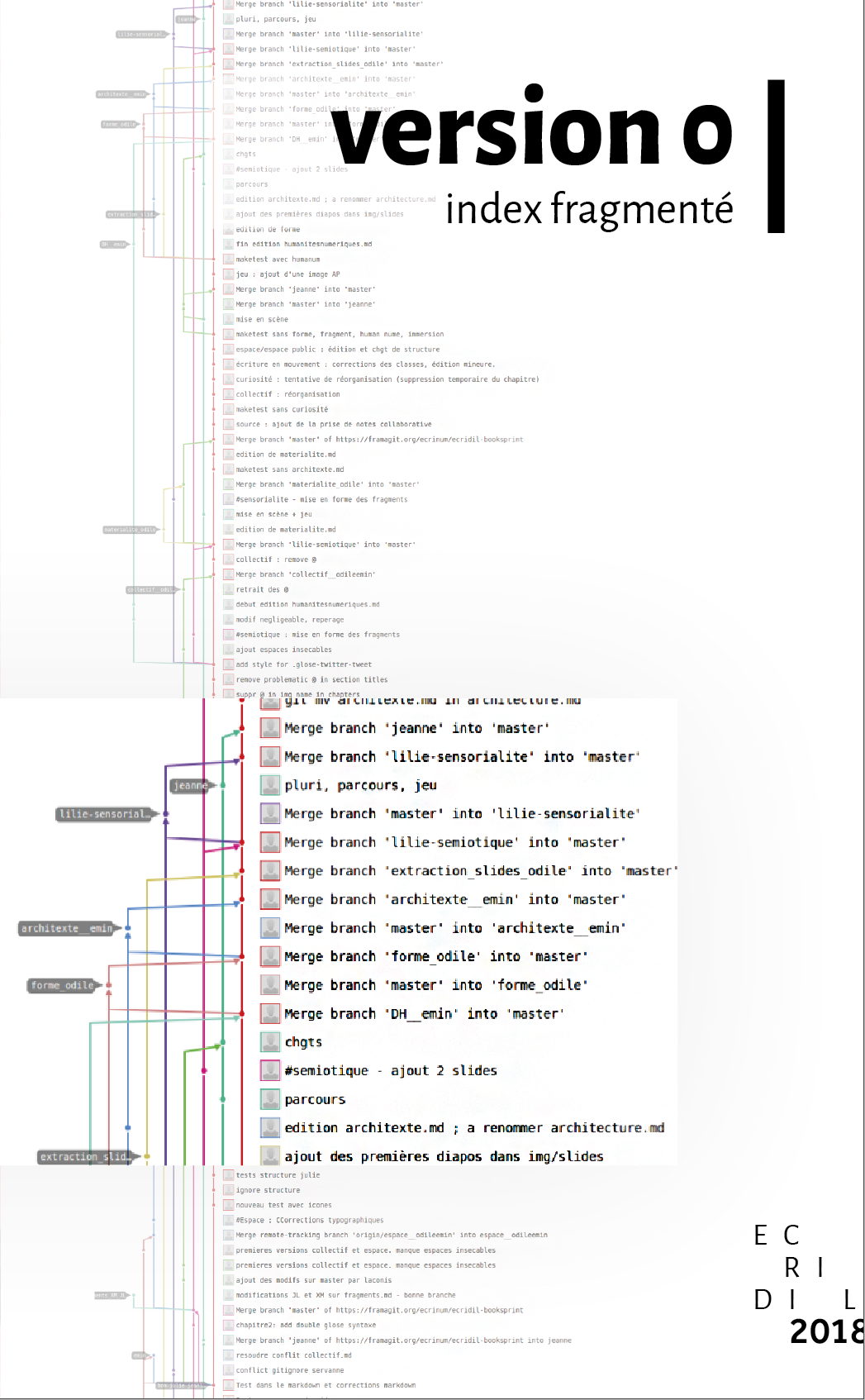
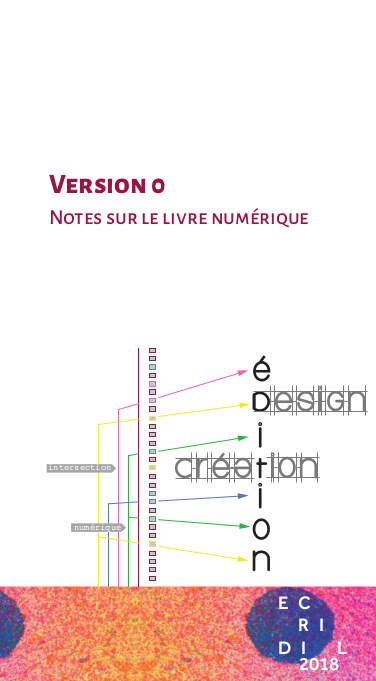
Propositions graphiques successives pour l’ouvrage version 0
La représentation graphique des commits en couverture de l’ouvrage renvoie alors autant à la nature processuelle de l’édition qu’à sa matérialité numérique et à sa dimension collective. Cependant, l’objet-livre, artefact disponible en impression à la demande, fini dans le temps et l’espace, reste un paradoxe. Si sa dimension économique, à travers sa licence CC0 Public Domain et son accessibilité en POD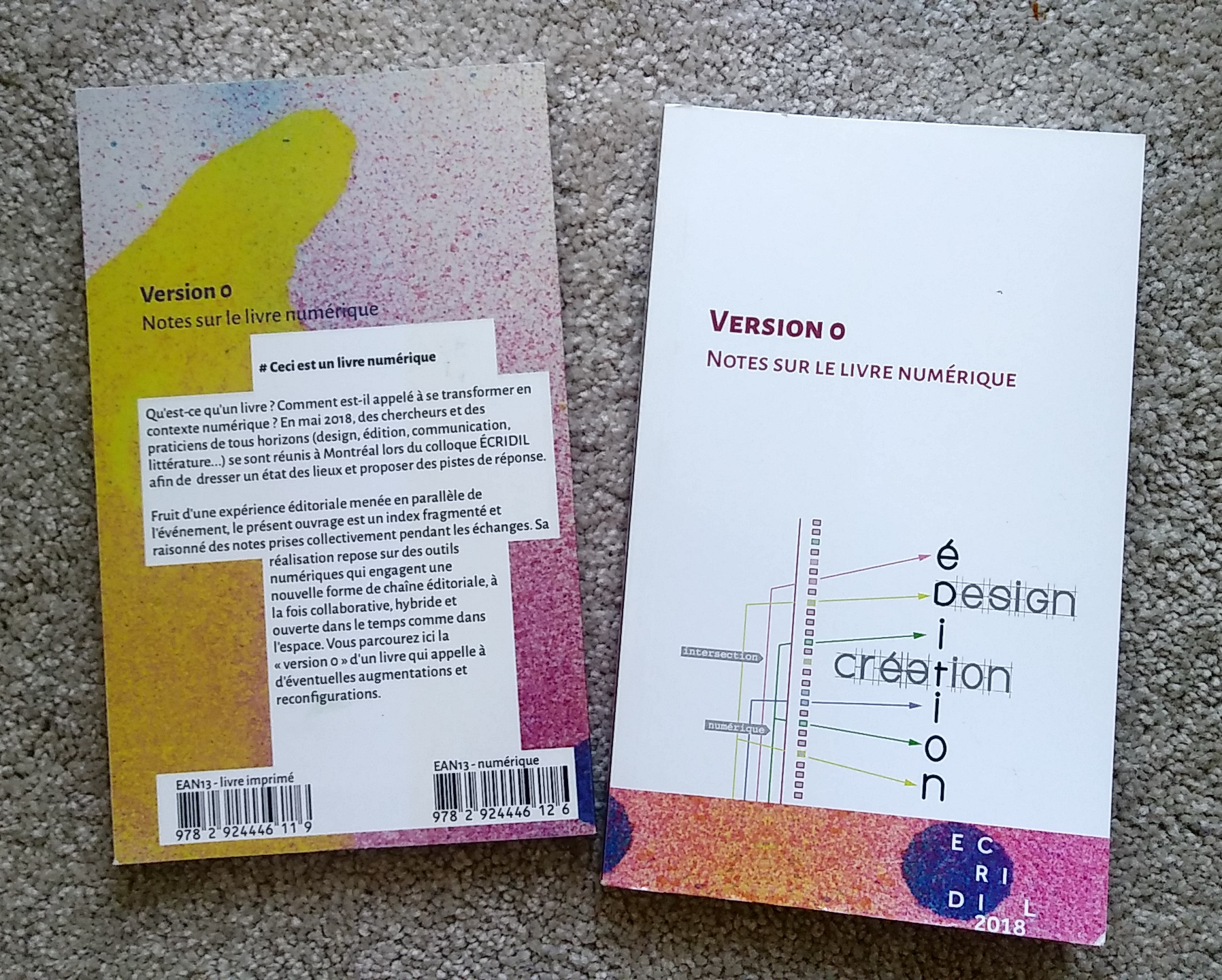 L’artefact papier de « version 0. Notes sur le livre numérique » imprimé à la demande (print on demand)
L’artefact papier de « version 0. Notes sur le livre numérique » imprimé à la demande (print on demand)
, l’installe pleinement dans le monde numérique, sa dimension matérielle, au contraire, semble presque un contresens. L’objet révèle pourtant plusieurs choses.
D’une part, il met en lumière sa fabrique davantage qu’il ne la masque comme c’est pourtant le cas, presque un principe de base, dans l’édition traditionnelle. Outre la couverture éloquente sur la matérialité du livre, son titre principal version 0 est une invitation à relancer un cycle d’écriture et à produire la version suivante. Car si ces fragments sont des portes d’entrée dans les échanges du colloque, leurs synthèses visuelles sont autant de prétextes à de nouvelles associations et interprétations, « appelant à d’éventuelles augmentations et reconfigurations » (Audet et al. 2018, sur la quatrième de couverture). Ainsi le readmeLe fichier readme contient les informations sur les autres fichiers d’un répertoire. Sur les plateformes collaboratives de type Github ou Gitlab, le readme d’un répertoire est utilisé pour présenter le projet sur sa page d’accueil. Voir sur l’accueil du répertoire.
du répertoire de travail s’ouvre sur le préambule suivant :
Cet index est ouvert : nous vous invitons à enrichir et à discuter (en ligne) la « version 0 » que nous proposons ici. Libre à vous de sélectionner, de ré-agencer, de discuter et d’augmenter à votre guise les différentes entrées de l’index afin de construire votre propre anthologie (imprimable). La branche
version1a d’ores et déjà été ouverte pour vous permettre de construire une « version 1 » - et nous espérons qu’il y en aura d’autres.
D’autre part, l’ouvrage papier fait la démonstration que les artefacts traditionnels de communication scientifique peuvent trouver une place dans un processus d’écriture et de circulation numérique, aussi continu et collectif soit-il. Cette preuve de concept n’est pas anodine. Elle montre que les formats numériques s’élaborent dans une certaine continuité des formats traditionnels. Elle prouve enfin qu’une chaîne de publication hybride (Fauchié 2019, voir la partie 1.1 Hybridation dans sa version HTML) est susceptible de satisfaire les différentes temporalités à l’œuvre dans la circulation des connaissances. La problématique de ces temporalités et de leur « alternance » a été une préoccupation majeure de la réflexion de Philippe Aigrain sur les écritures collectives :
Comment articuler des temps d’intensité d’interaction avec les autres, d’interaction parcellarisée avec les différents médias et des temps de recul, de mise à distance, de réflexion et de perception dans la continuité et le contexte ? Comment articuler l’expression individuelle et la production collective ? (Aigrain 2005, sur Hypothesis)
Cette problématique du maintien de l’alternance des temps dans nos pratiques d’écriture et de lecture était aussi relevée par Louise Merzeau (2014) dans son analyse du dispositif ENMI12. Aigrain propose dans ce texte court deux pistes faisant écho à ce cas d’étude et plus largement à la mise en conversation des textes. Je m’arrêterai sur la seconde qui suggère d’intégrer dans les textes collectifs publiés des « appels aux contributions », instituant « un mécanisme de demande sociale qui garantit à chaque contributeur potentiel qu’au moins un lecteur est en demande d’une partie d’une œuvre collective » (2005, sur Hypothesis). Aigrain s’appuie sur le modèle des wikis, mais un autre modèle éditorial performe parfaitement ces appels à la contribution. C’est le protocole git (j’aurai l’occasion d’y revenir), dont l’énonciation éditoriale est en effet entièrement tournée vers la contribution au texte et à son élaboration collective.
Le formalisme du protocole éditorial
L’ouvrage final se présente dans un format poche de 159 pages structurées comme un index comprenant quinze entrées thématiques dont l’ambition est de baliser la substance du colloque et de ses problématiques : Architecture, Clôture, Collectif, Espace (public), Forme, Geste d’écriture, Jeu, Humanités numériques, Matérialité, Mouvement, Parcours, Sémiotique, Sensorialité, Transferts et Typographie. Pour chacune des entrées, s’étalent sur une dizaine de pages des éléments de différentes natures issus du colloque : citations, diapositives, visuels, tweets, références, photographies. On peut penser version 0 comme une sélection de fragments de sens, assemblés et organisés graphiquement pour former une synthèse, certes lacunaire, mais déjà signifiante. Ces fragments ne sont pas de simples échos d’énoncés. Par la cohérence éditoriale de l’assemblage, l’effet d’association suscite une mise en dialogue et l’émergence d’un sens nouveau.
Par quel processus d’écriture et d’édition ont pu émerger ces entrées et comment les éditeurs les ont-ils alimentées ? Quel en a été le protocole, et quel rôle a-t-il joué dans cette fabrication pour le moins expérimentale ? Enfin, dans quelle mesure ce protocole participe-t-il de la fabrique de légitimité ?
Toute instance éditoriale organise ses équipes et sa chaîne d’écriture selon un ou plusieurs protocoles éditoriaux, définissant dans le détail la suite des actions à effectuer jusqu’à la publication d’un contenu. Le protocole éditorial d’un éditeur est souvent destiné aux auteurs souhaitant soumettre un texte ou un contenu à cet éditeur. Il indique alors à l’auteur une série de consignes à respecter et le cheminement des décisions qui affecteront l’éventuelle publication. Le protocole peut aussi être interne à l’équipe éditoriale et préciser dans ce cas les opérations et les états par lesquels le contenu soumis doit passer. Mais au-delà de ces considérations pragmatiques, le protocole se charge d’une dimension symbolique légitimante, que l’on retrouve dans les différentes acceptions du terme, qu’il s’agisse du protocole diplomatique, du protocole des notaires, du protocole de communication, ou du protocole éditorial. Pour chacun de ces protocoles, une autorité émane de l’écriture et de l’inscription séquentielle d’actes à effectuer ou de paroles déjà prononcées. Ainsi, tout écart de protocole diplomatique est immédiatement interprété comme un incident, toute erreur dans le protocole de prise en charge d’un patient peut lui être fatale, toute anomalie dans un protocole de communication générera, au mieux, un malaise ou un quiproquo, quand il n’empêchera pas purement et simplement, dans le pire des cas, la communication de s’établir. Ces écritures protocolaires sont au cœur de ce que l’institution au sens large produit et ce sur quoi elle construit sa légitimité.
Pour Olivier Bomsel, le protocole éditorial assure différentes fonctions légitimantes, dont celle d’établir les conditions de cette communication unilatérale et donc particulière qu’est la publication d’un ouvrage.
La publication est une émission vers des publics anonymes. Elle sert à communiquer des normes, des règles, des référents. Elle s’applique à la monnaie, au droit, à la science, aux faits sociaux, aux expressions artistiques, religieuses ou littéraires. Elle accompagne la circulation marchande des biens et des services. L’asymétrie structurelle entre émetteur et récepteurs en fait une opération très complexe, aux protocoles mille fois plus variés que ceux de la correspondance. Car, si depuis Sumer où s’invente l’écriture, l’Autorité, l’État est naturellement légitimé à publier, il n’en va pas de même des individus. Or, un message ne signifie que si l’on sait « qui parle ». Ce point, l’identification de « qui parle », est systématiquement traité dans le protocole de correspondance où s’installe le « qui parle à qui ». Mais pour publier, le processus par lequel un auteur se constitue, s’identifie comme tel, organise son discours pour, finalement, le faire éditer – au sens latin d’ēdere, exhaler, mettre au jour – est en soi une phase complexe, conditionnée par l’anticipation du protocole éditorial. (Bomsel 2013)
Pourtant, comme le remarque Lionel RuffelLionel Ruffel a co-organisé la première édition de l’événement Publishing Sphere qui fait l’objet d’une partie de ce chapitre.
, cette « idée de l’auteur solitaire en contact direct avec son éditeur, et s’adressant in absentia à un public anonyme, est obsolète ».Ma traduction de l’énoncé original : “The traditional idea of the solitary author in direct contact with his editor, and speaking in absentia to an anonymous public is obsolete.” (« The Publishing Sphere Ecosystems of Contemporary Literatures » 2017, sur Hypothesis).
En ce sens, tout l’enjeu du protocole se jouerait donc désormais ailleurs que dans l’établissement d’une communication asymétrique. Au contraire, je soutiens qu’une nouvelle fonction éditoriale consiste justement à rétablir une symétrie communicationnelle, ouvrant la voie à une véritable conversation. Cette conversation ne peut voir le jour que si l’éditeur, dans son rôle intermédiaire, crée les conditions d’appropriation des contenus. Ainsi, de sa fonction traditionnelle de circulation où l’éditeur se devait de rendre ses objets accessibles, c’est-à-dire d’en assurer l’accès (en passant la main aux réseaux de diffusion), il doit maintenant les rendre appropriables.
Dans le cas de l’ouvrage version 0, le protocole mis en place cherchait à relever le défi d’une édition collective et à faciliter l’accouchement d’un objet éditorial dans des contraintes de temps serrées.
Quelques jours avant l’événement, le site du colloque dédiait une page au booksprint qui décrivait le dispositif à travers une note d’intention, un protocole éditorial et un workflow (ou déroulé) précisant les étapes de collecte, de sélection, d’écriture et d’édition.
Le dispositif n’a cessé d’évoluer et de se mettre à jour, tant dans sa dimension organisationnelle que dans sa dimension technique. Proposé sous le terme de booksprint, en référence à la méthode diffusée par la plateforme FLOSS Manual, il en reprend certains principes. Le booksprint est défini par Wikipédia comme « une session de travail intensif organisée pour l’écriture complète d’un livre, par plusieurs auteurs, réunis ou à distance, souvent encadrés par un facilitateur non rédacteur »Voir sur Wikipédia.
. La méthode s’inspire du code sprint, rassemblant dans un temps limité plusieurs programmeurs autour de la réalisation d’un logiciel ou d’une fonctionnalité logicielle, et s’apparente de ce fait aux « méthodes agiles » préconisées en design et appliquées notamment au design logiciel.
Le booksprint Ecridil s’est déroulé en trois temps :
- le colloque : prise de notes et production de fiches de synthèse
- l’atelier d’idéation : émergence d’un concept et d’une forme pour le livre
- le sprint : réalisation du livre par l’équipe de sprinters
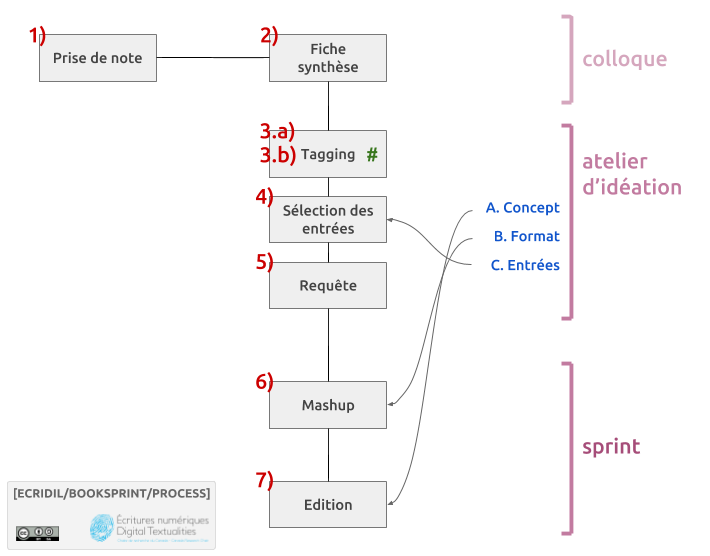
Il serait plus juste d’en ajouter un quatrième en amont du booksprint, à savoir la conception et la préparation du booksprint lui-même. L’analyse que nous avons faite du dispositif ENMI12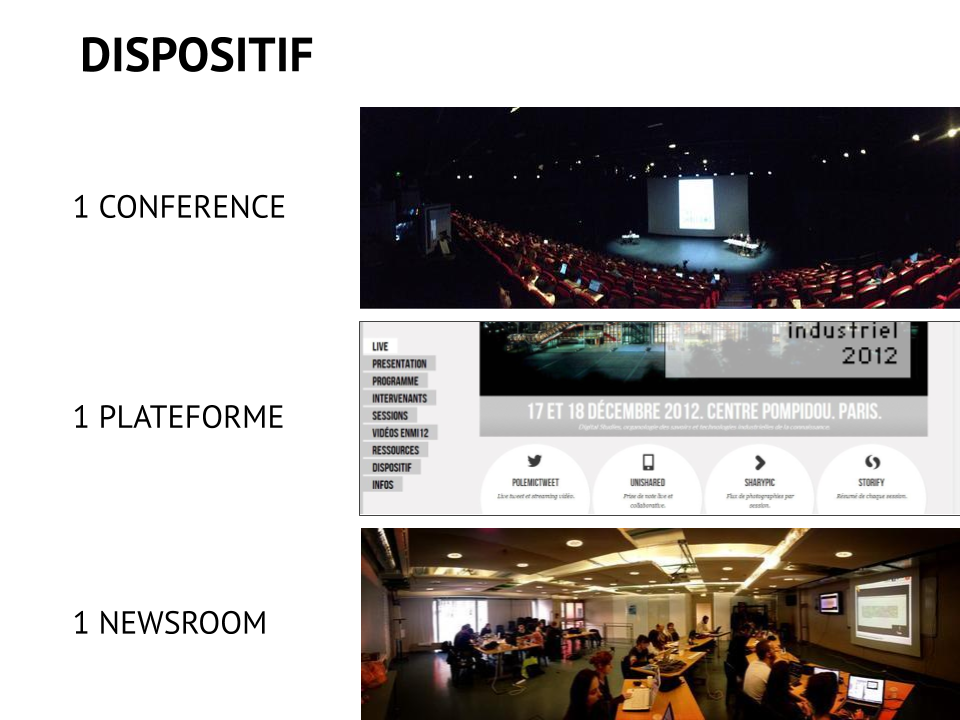
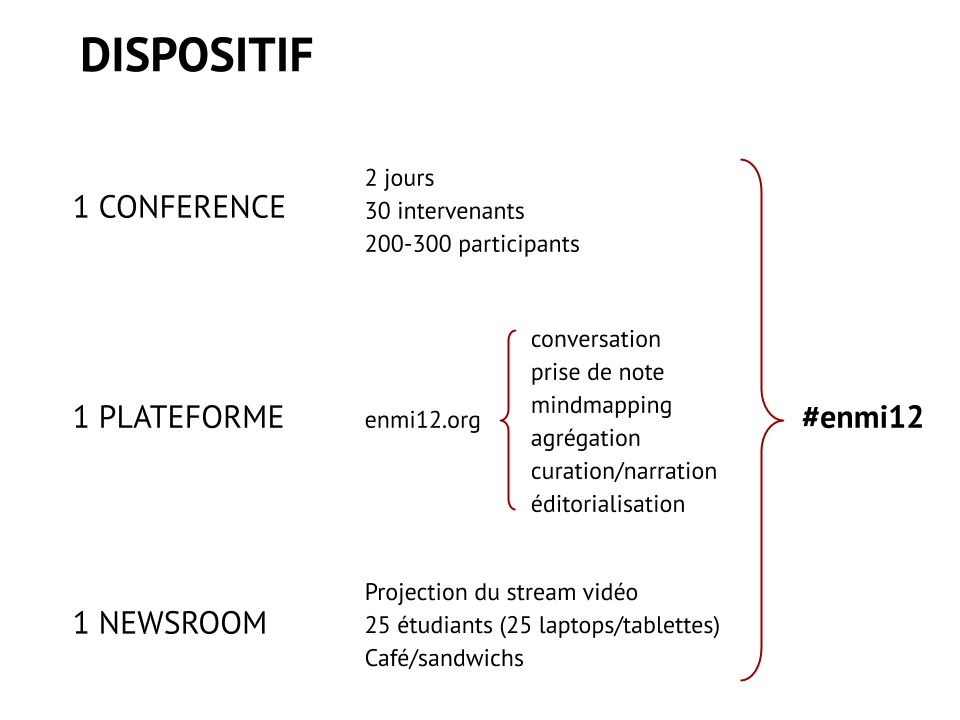 Dispositif ENMI12 - visuels
Dispositif ENMI12 - visuels
offrait une large place aux trois mois de préparation essentiels à la réussite de l’expérience. Le dispositif du booksprint d’Ecridil s’apparente à celui des ENMI12 en cela qu’il s’agissait également de procéder à une « éditorialisation collaborative d’un événement » (Merzeau 2013b), soit la « couverture » de deux journées de colloque.
Une différence notable entre les deux dispositifs réside dans la finalité anticipée. Là où les ENMI12 envisageaient une documentation et une conversation en temps réel par le biais de l’engagement d’une communauté large sur un archipel de plateformes, le booksprint Ecridil tendait à la production d’un ouvrage dont les formes et le fond étaient encore à définir, en partie pendant l’événement lui-même, en intégrant à la réflexion les participants au colloque. Lors des ENMI12, l’intention était d’ouvrir un espace alternatif à la conférence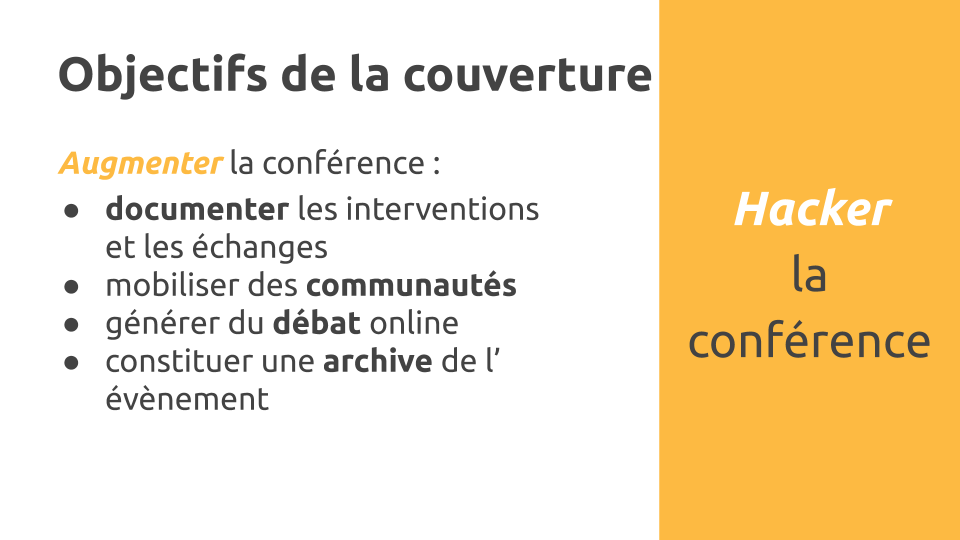 Les objectifs de la couverture ENMI12
Les objectifs de la couverture ENMI12
, tout en produisant sa documentation. L’intention du booksprint, dans la lignée des « Catal-actes » de la première édition d’Ecridil à Nîmes en 2016, relevait davantage d’une expérimentation éditoriale vers une forme livresque originale.
En parallèle au colloque ECRIDIL, le comité d’organisation organise un booksprint destiné à proposer une synthèse originale de nos échanges.
Le livre que nous souhaitons éditer ne constituera pas des « actes » à proprement parler et ne redoublera pas non plus l’ensemble des archives (visuelles, sonores, textuelles) produites pendant le colloque. Il s’agira plutôt d’ouvrir nos problématiques, nos réflexions, nos corpus à un public élargi. Nous faisons donc l’hypothèse de produire un index du colloque, qui permettra de rendre compte des concepts et notions les plus importantes, tout en faisant dialoguer les différentes interventions.
Outre l’objet livre qui en sera le résultat concret, ce booksprint est aussi une expérimentation questionnant le sujet du colloque. Nous adopterons ainsi des pratiques éditoriales tournées vers une édition collaborative, continue, susceptible de maintenir un dialogue permanent entre forme et contenu. Or les structures formelles de l’édition et de l’éditorialisation sont en premier lieu de nature scripturale. L’enjeu du dispositif de production réside alors dans l’articulation de ces deux écritures : la structure-code et le discours.
Extrait de la note d’intention du booksprint Ecridil 2018Voir la page dédiée sur le site du colloque (lien archivé).
Le protocole éditorial devait disposer une structure de travail, des temporalités et des espaces dédiés d’écritures et d’échanges. Le travail éditorial lui-même consistait en sept étapes :
| étape | description | |
|---|---|---|
| [1] | Prise de notes collaborative | un pad général pour toute la conférence, structuré par communication |
| [2] | Rédaction des fiches synthèses | 1 pad par fiche synthèse (chaque fiche synthèse est associée à une communication) |
| [3] | Tagging collaboratif | [a] catégorisation : émergence d’une première série de tags [b] tagging des fragments des fiches synthèses |
| [4] | Sélection des entrées | identification des entrées de l’index |
| [5] | Requête | on extrait tous les fragments tagués ou en lien avec les entrées sélectionnées |
| [6] | Mashup | production des entrées à partir des fragments |
| [7] | Édition | édition continue et simultanée à la production des entrées |
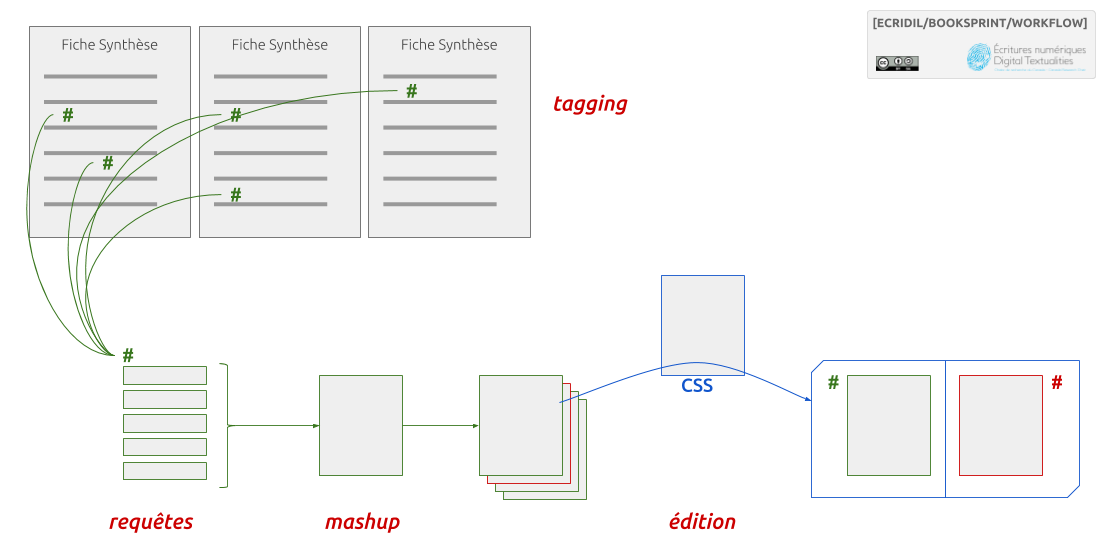
Ces sept étapes rappellent le découpage des activités de la newsroom des ENMI12 Fonctions principales de la couverture
Fonctions principales de la couverture
, organisées séquentiellement dans un processus relativement similaire d’assimilation et de transformation.
| ENMI12 | prises de notes, conversation –> agrégation, curation –> archive, éditorialisation |
| Booksprint | prises de notes –> synthèse –> catégorisation –> sélection –> agrégation –> mise en forme |
Alors que le dispositif des ENMI tendait principalement à susciter et à favoriser les conversations autour de l’événement, notamment avec l’intégration de la plateforme Polemictweet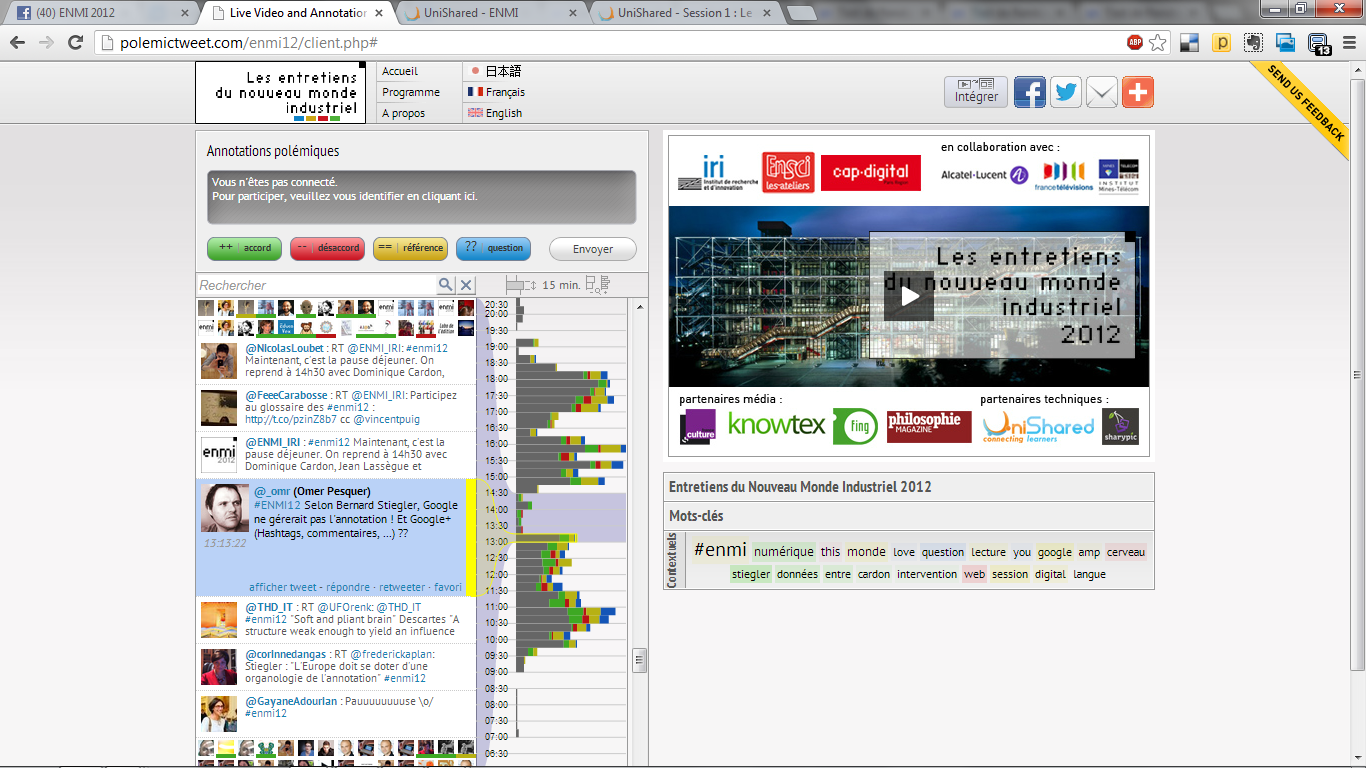 Capture d’écran de la plateforme Polemictweet lors des ENMI12
Capture d’écran de la plateforme Polemictweet lors des ENMI12
, le dispositif d’ECRIDIL a en quelque sorte instrumentalisé la conversation pour se définir lui-même.
La conversation au défi de la littératie numérique
On le constate, le dispositif éditorial de l’ouvrage version 0 avait été pensé pour favoriser l’implication des participants et des lecteurs. Pourtant, prendre part à une conversation ou à toute situation sociale suppose d’en maîtriser la langue et les codes. Les événements scientifiques en sont un bon exemple. Qu’en est-il des différentes conversations qui se sont déroulées lors de l’expérience du booksprint ? Peut-on mobiliser des contributeurs qui n’en possèdent pas les codes ? Quelles seraient les caractéristiques d’un dispositif inclusif ? Je répondrai à cette dernière question dans la partie commentant l’expérience de la Publishing Sphere. Mais je peux d’ores-et-déjà tirer quelques conclusions de cette première expérimentation éditoriale afin de saisir quel collectif en aura finalement émergé.
Comme on l’a vu précédemment, trois niveaux de conversation ont été implémentés, respectivement dans le dispositif éditorial du booksprint, dans l’artefact livre lui-même, et plus généralement dans l’expérience sensible et sociale des éditeurs et participants. La première conversation a été celle de la co-conception de la forme avec les chercheurs participants au colloque. Le second niveau s’est joué dans l’articulation constante entre le fond et sa forme, à savoir entre les énoncés et le code, ou leur encodage, qui allait structurer l’objet final. Enfin, une troisième conversation est celle des fragments de discours mis en dialogue entre eux, point de départ de nouvelles associations d’idées et invitation à poursuivre et à augmenter l’ouvrage dans une version 1.
Je l’évoquais plus haut, la co-conception n’a pas véritablement fonctionné, et si l’atelier d’idéation a su fédérer une communauté éphémère autour du projet de l’ouvrage, la forme et le fond de celui-ci n’ont pas directement bénéficié de cet effort collectif. En revanche, on peut considérer que la preuve de concept a été faite de l’articulation entre le fond et la forme. En effet, les modalités d’édition et de circulation adoptées ont su maintenir un lien constant entre les énoncés et leur énonciation éditoriale, démontrant que même dans le cas d’une édition numérique destinée à l’impression, il n’est pas possible de séparer le discours de son support d’écriture et de diffusion. C’est ce qui transparaît de la matérialité de l’ouvrage et de sa fabrique, incarnée par son protocole éditorial et sa chaîne de publication modulaire et continue. L’indissociabilité de l’éditorial (le protocole) et de la technique (la chaîne) vient d’ailleurs confirmer l’interrelation entre la pensée et son support. De ce point de vue, il est intéressant de noter que le protocole éditorial et la chaîne se sont appuyés en grande partie sur le protocole git et l’instance de la plateforme Gitlab, résolument tournés vers la collaboration.
De fait, si un collectif a émergé de cette expérimentation, c’est sans doute lors du booksprint lui-même, autour des onze éditeurs et éditrices créditées dans l’ouvrage. Pour la plupart étudiant·e·s en formation sur les mêmes outils et pratiques d’édition au sein d’un stage en édition numérique encadré par Servanne Monjour, ils·elles ont su, lors de cette expérience, acquérir une autonomie d’édition jusque dans leurs prises de position intellectuelles et théoriques. Fonctionnant en collectif, outillés de différentes plateformes collaboratives, le travail éditorial s’est déroulé de manière extrêmement fluide au regard des objectifs et des contraintes imposées, notamment la contrainte temporelle. Ce collectif et l’intelligence qui s’en est dégagée sont avant tout un succès pédagogique. Si ce succès vient conforter les pratiques alternatives développées à la CRC-EN, il vient aussi en écho aux observations effectuées après l’événement ENMI12.


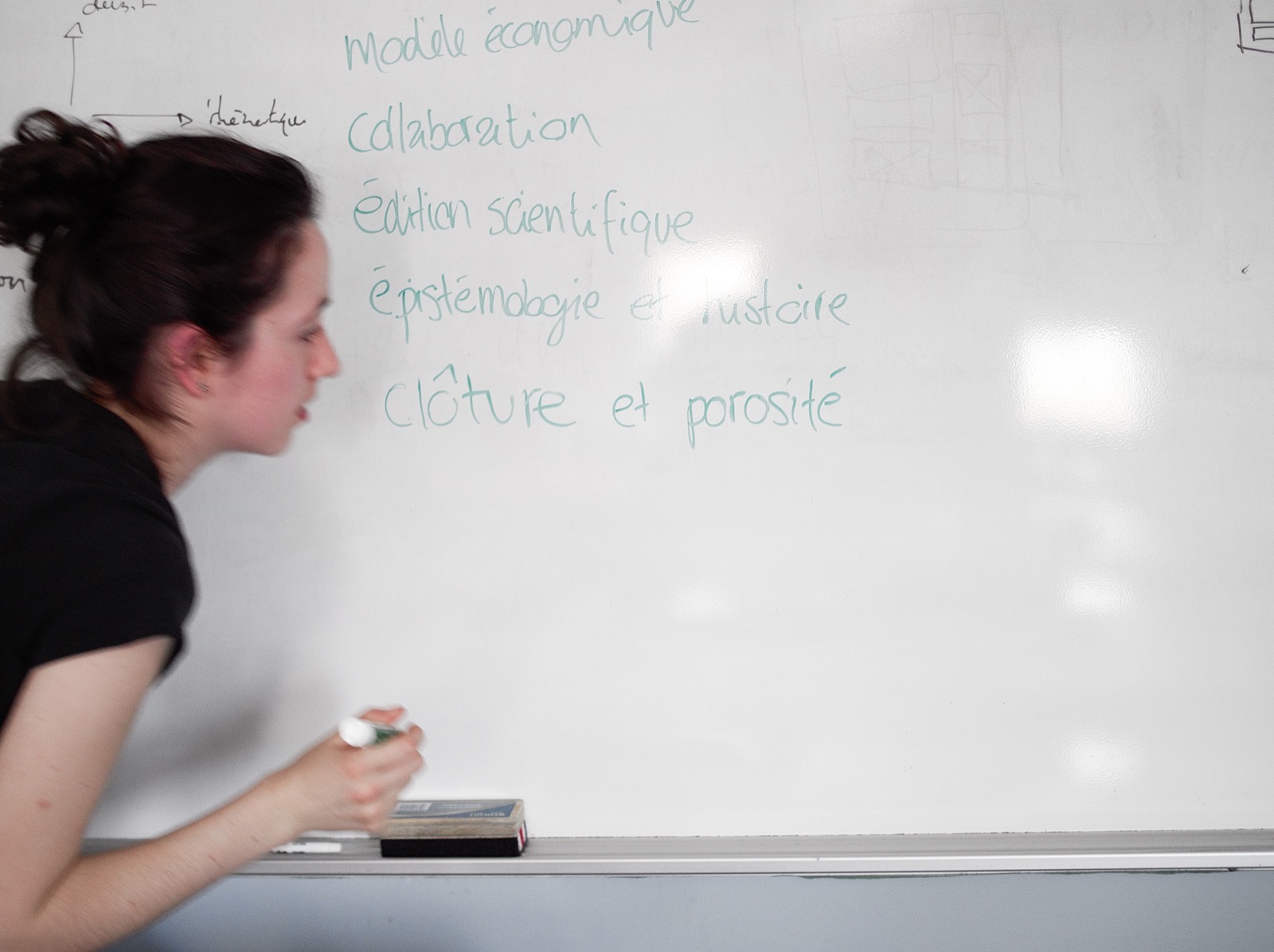
Scènes du booksprint
Sylvia Fredriksson, co-initiatrice du dispositif d’éditorialisation collaborative mis en place lors de la conférence ENMI12, met également en avant le rôle fondamental de ses étudiants et leur étonnante capacité à s’être approprié à la fois les outils proposés, les cadres conceptuels et théoriques de la conférence, mais aussi le dispositif lui-même. L’encadrement hebdomadaire pendant trois mois en amont de l’événement leur a permis de devenir collectivement co-concepteur·rice du dispositif, en augmentant de leur propre initiative l’« archipel » de plateformes et leurs interrelations, support de la conversation. Comme pour le collectif du booksprint Ecridil, le collectif s’est réalisé dans l’appropriation conjointe de la matière intellectuelle et des modalités de son écriture. L’effort pédagogique réalisé dans ces deux cas d’étude montre le bénéfice conséquent d’une littératie numérique qui transpose le savoir lire et écrire à un savoir lire, écrire et éditer. Plus fondamentalement, il apparaît qu’écrire pour penser dans l’environnement numérique revient déjà à éditorialiser, c’est-à-dire à maîtriser les structures spatiales, et finalement à habiter l’espace numérique. C’est sur ces conditions d’appropriation que je propose donc de poursuivre ma réflexion autour d’un nouveau cas d’étude, celui du Général Instin.
Quel milieu pour la conversation ? Les « écritures dispositives » du collectif littéraire Général Instin
L’hypothèse que je défends d’un modèle conversationnel de communication scientifique doit beaucoup, on l’a compris, à l’analyse du dispositif des ENMI12 réalisée par Louise Merzeau dans une série de publications. Cette analyse que j’ai présentée dans le premier chapitre m’a permis d’élaborer une première réflexion sur l’écriture et la conversation, et de forger en particulier un concept important pour penser la conversation : celui d’écriture dispositive. En cherchant à élargir la notion de conversation, ce concept est rentré en résonance avec les pratiques d’écritures propres à des communautés non académiques. C’est le cas pour la communauté des communs, sur laquelle je reviendrai dans la dernière partie de ce chapitre. C’est également le cas pour le collectif littéraire Général Instin dont j’ai entrepris l’analyse avec Servanne Monjour en 2016. Dans cette partie, je cherche à faire dialoguer la lecture de Louise Merzeau du dispositif des ENMI12 avec ce que nous avions appelé « l’analyse dispositive » du Général Instin. Il s’agit ici d’adopter sur la conversation une perspective différente, offerte par les pratiques d’écriture littéraire contemporaines. De quoi la conversation est-elle faite ? Comment fonctionne-t-elle ? De quoi est-elle le révélateur ? Avant de prendre le chemin du Général Instin où se dévoile le collectif, il m’apparaît nécessaire de reposer au préalable les éléments théoriques introduits par Louise Merzeau et d’amener les miens.
L’écriture dispositive
De 2012 jusqu’en 2017, où paraît son dernier articleL’article « De la bibliothèque à l’Internet : la matrice réticulaire » (2017) est le dernier écrit rédigé par Louise Merzeau. D’autres publications plus récentes sont en réalité des productions plus anciennes.
, Louise Merzeau produit une série de travaux qui vont progressivement asseoir une pensée du collectif à partir des formes d’écriture qu’elle observe dans les processus d’éditorialisation. Son analyse du processus ENMI12 fait ressortir le concept d’« action dispositive » qui désigne l’ensemble des actions des individus lorsqu’ils sélectionnent, organisent, éditent, réécrivent des ressources, autrement dit lorsqu’ils les « éditorialisent » (Merzeau 2013b, p111). Il est intéressant de noter ici que l’emploi du terme éditorialisation préfigure assez clairement la première définition du terme, élaborée d’abord dans le cadre du séminaire Écritures numériques et éditorialisationVoir le site du séminaire.
, puis retravaillée par Marcello Vitali-Rosati dans une série de publications (Vitali-Rosati 2015 , 2016 , 2018). Dans cette première définition en effet, l’éditorialisation désigne :
un processus complexe résultant des interactions entre des contenus (ou des ressources), un environnement technique (le réseau, les serveurs, les plateformes, les CMS, les algorithmes des moteurs de recherche), des structures et formats (l’hypertexte, le multimédia, les métadonnées), et des pratiques (l’annotation, les commentaires, les recommandations via réseaux sociaux). Ce processus d’organisation et d’agencement des contenus numériques est par essence ouvert et dynamique. (« "Séminaire Écritures numériques et éditorialisation" - Cycle 2014-2015 - Pratiques de recherche et de production de la connaissance » 2014, lien archivé)
Tel que l’utilise Merzeau, le terme éditorialisation s’emploie aussi à l’infinitif « éditorialiser ». Cette activité, ou cet agir, témoigne pour elle du « savoir-lire-et-écrire numérique » des individus. Ainsi, le processus collectif peut s’envisager comme une somme d’actions individuelles, mais sans pour autant s’y réduire. Car déjà dans ce texte de 2013, l’éditorialisation résulte aussi d’un « tissu médiatique » :
En amont des processus d’échange, de partage et de contribution, c’est le tissu médiatique lui-même qui induit une logique processuelle de tressage, de butinage et de mouvement. (Merzeau 2013b, sur Hypothesis)
J’ai pour ma part introduit l’idée d’« écriture dispositive » (2016) pour requalifier l’action dispositive, en considérant que ces actions « de tressage, de butinage et de mouvement » sont essentiellement des écritures. En effet, toute activité dans l’espace numérique se traduit par une ou plusieurs écritures, qu’elles soient humaines ou machiniques, discursives ou programmatiques. On l’a vu avec l’analyse du dispositif ENMI12, ces écritures sont de différentes natures : discours, collections, réécritures, catégorisationsLouise Merzeau en dresse également une typologie, empruntée à Fanny Georges (2009) : « Tous les niveaux de traçabilité sont donc écrasés, superposant les identités déclarative, navigationnelle, agissante et calculée (Georges, 2009) : ce que je dis de moi (qui je suis), où je vais (comment je me comporte), ce que j’édite ou publie (ce que je pense) et ce que les plateformes calculent à partir de mes activités (ce que je vaux). » (Merzeau 2013a, voir sur Hypothesis)
. Toutes pourtant apposent à l’espace numérique leurs « traces » (Merzeau 2013b, sur Hypothesis), témoignant autant d’une inscription que d’une action. L’écriture est ici performative, car elle agit autant sur le plan scriptural que sur un plan spatial en participant de l’agencement de l’espace numérique. L’écriture dispositive opère donc autant dans un environnement, que sur cet environnement. L’adjectivisation du terme dispositif n’est pas neutre. Ce glissement syntaxique est également un glissement sémantique, puisque le dispositif devient alors environnemental et pervasif.
Dans ce jeu d’applications distribuées, l’événement s’écrit sur ce que Zacklad appelle un « environnement-support » (Zacklad, 201[2]). Combinant matériel, applicatif, système d’exploitation et infrastructure réseau, le média numérique ne peut plus être pensé comme externalité d’un support : il relève d’une pervasivité par laquelle l’information produit des effets de permanence et d’enveloppement. […] Embarquant « le contexte transactionnel » (Ibid.) qui les conditionne, le dispositif n’est pas une forme, mais une dynamique. (Merzeau 2013b, sur Hypothesis)
Ainsi, penser l’espace numérique avec Merzeau et Zacklad (2012) comme un « environnement-support », permet de mieux comprendre la nature environnementale du numérique, et ce lien étroit entre espace et écriture. En jouant de la même adjectivisation que pour l’action ou l’écriture (dispositives), ce que j’appelle pour ma part l’environnement dispositif se voit agit autant qu’il agit, il écrit autant qu’il est écrit. Cela permet de s’extraire du déterminisme foucaldien du dispositif, qui prête à ce dernier un pouvoir de coercition sur ses usagers, mais d’en conserver la fonction, c’est-à-dire cet agencement des acteurs, objets et artefacts prédisposant à l’action. L’environnement dispositif peut alors se penser comme un environnement continuellement écrit, agit et agencé par les écritures ou les actions qu’il accueille. C’est en cela que l’écriture peut être qualifiée de dispositive, car elle participe au processus d’agencement de l’espace, rejoignant alors les caractéristiques de l’éditorialisation : processuelle, continue, dynamique, performative (Vitali-Rosati 2018), comme nous allons le développer.
De l’écriture au milieu
Le « tissu médiatique », dans lequel écritures et environnement se confondent dans un même processus, procède en fait d’un milieu. En tant qu’éditrice des Cahiers de médiologie, puis de la revue Médium, Merzeau est une héritière active de la pensée médiologique. Elle s’en émancipe pourtant en 2007 dans sa « nouvelle feuille de route » où elle appelle les médiologues à enfin considérer le « tournant médiologique » que constitue l’Internet.
Plus fondamentalement, la médiologie doit se demander si son message est toujours en prise avec l’état du monde, et si l’urgence aujourd’hui n’est pas de décrypter et d’accompagner le passage de la vidéosphère à l’hypersphère. Si nous admettons que la numérisation et la mise en réseau de la totalité des traces constituent un tournant médiologique majeur qu’on ne saurait amalgamer avec les changements survenus aux XIXe et XXe siècles, il faut en effet s’intéresser de plus près aux écarts que l’hypersphère introduit. (Merzeau 2007, sur Hypothesis)
Si les publications qui s’ensuivent vont radicalement diminuer l’usage des termes médias ou médiationL’article « La médiation identitaire » (2012) fait office d’exception venant confirmer la règle.
, pourtant centraux dans ses précédents écrits, Merzeau utilise et développe le concept de milieu dans un premier article « L’intelligence des réseaux » (2010), dont elle reprend l’idée dans son tout dernier article « De la bibliothèque à l’Internet : la matrice réticulaire » (2017). Dans ces deux textes, elle fait référence au « milieu technique associé », qu’elle emprunte à Bernard StieglerVoir notamment la définition qu’en donne le site Ars Industrialis (« Milieu » 2009).
, reprenant lui-même Gilbert Simondon.
[Les usagers] co-construisent simultanément l’accès et le contenu accédé. Bernard Stiegler souligne qu’en ce sens l’environnement numérique constitue bien ce que Simondon appelait un « milieu technique associé ». (Merzeau 2010, 12)
En 2017, Merzeau en fait un usage plus large et introduit une dimension écologique qui nous intéresse particulièrement :
Appréhender la conversion numérique depuis cette seule entrée revient surtout à ramener l’Internet au seul plan du support, lui-même considéré dans une logique instrumentale. Or c’est dans sa dimension « écologique » qu’il convient aujourd’hui de penser le numérique, c’est-à-dire en tant qu’écosystème ou environnement. C’est dans ses effets d’interactions, de continuum et d’enveloppement qu’on mesurera le mieux comment ce qui n’était d’abord perçu que comme une « nouvelle technologie » a finalement configuré un milieu de vie. La première appelait des opérations de transcription, de transfert ou de traduction depuis la sphère des objets ou du papier vers le numérique : on se focalisait alors par exemple sur la numérisation des collections. Le second appelle un art de cohabiter et de co-évoluer, et c’est le développement des réseaux sociaux qui devient le principal enjeu. Ce milieu est certes un milieu technique, mais c’est surtout un « milieu associé », au sens où il se modifie à mesure que nous l’habitons. (Merzeau 2017, 3 ou sur Hypothesis)
Ce « milieu de vie » permet de repenser les entités qui nous intéressent – le dispositif, les écritures, les individus, le collectif – et de concevoir leurs interactions comme une écologie davantage que comme une économie. En effet, alors que le dispositif relevait directement de l’économie chez Agamben (2014), il devient environnemental, se fondant en un écosystème où les rapports de causalité ne sont plus fondés sur une conception linéaire, comme le précise Thierry Bardini (2016, 163). Dans son article Entre archéologie et écologie : Une perspective sur la théorie médiatique, l’auteur tente de réconcilier plusieurs approches de ce qu’il appelle l’« écologie médiatique », dans laquelle il rassemble « les travaux fondateurs d’Harold Innis, Marshall McLuhan et Neil Postman, mais aussi de la médiologie française de Régis Debray et Daniel Bougnoux – et de l’archéologie médiatique – inspirée de Friedrich Kittler, Jussi Parrika et Erkki Huhtamo » (2016, 159). Il constate ainsi dans ces courants de pensée le passage d’une causalité linéaire, entre par exemple support (d’écriture) et pensée, ou entre inscription et technique intellectuelle, à une causalité formelle (McLuhan 1976), circulaire (Merzeau 2006) ou encore récursive (Lévy 1998) selon les termes choisis par les auteurs. L’écologie médiatique inscrit les supports dans une boucle rétroactive entre technique et usage, permettant d’envisager autrement les interactions entre des entités en partie dissoutes dans le milieu.
Or, il se trouve que le numérique, caractérisé notamment par sa récursivitéJean-Guy Meunier (2014) en fait une des propriétés de la computationnalité, dont le numérique est une modélisation.
, adhère particulièrement bien à cette conception de la causalité. Parce qu’il est un milieu écrit (codes, protocoles, dispositifs), le numérique propage de manière récursive ses propriétés dans les écritures qu’il supporte et génère. récursivité du LISP : un langage et un programme capable de s’écrire lui-même Par exemple, on retrouve les effets de cette récursivité dans la propagation de l’ouverture et la transparence, deux propriétés essentielles inscrites au cœur du protocole TCP/IP de l’Internet, aux infrastructures logicielles et aux contenus que le réseau soutient. Le cas le plus emblématique de ce phénomène étant le protocole HTTP et le langage de balisage HTML, dont l’adoption massive a été permise par la libération de ses sourcesVoir le récit qu’en fait le CERN dans son histoire du Web, et en particulier « Le Web sous licence » (Flückiger et Smith, s. d.).
. De même, les écritures juridiques que sont les licences copyleft, conçues et utilisées d’abord pour le partage et la libre diffusion des logiciels, ont été plus tard adoptées et adaptées dans les Creative Commons, licences copyleft dédiées au partage et à la diffusion des contenus culturels. Alors que chacun de ces niveaux d’écriture (protocolaire, logiciel, culturel) supporte le suivant, les valeurs politiques des niveaux inférieurs se transmettent effectivement aux niveaux supérieurs.
Ainsi, penser avec le milieu, en tant qu’il met en place une causalité circulaire entre ses habitants, suggère d’adopter une approche écologique à même de saisir ce qui se joue en matière de production du collectif. C’est ce que l’écologie médiatique nous invite à faire en déplaçant notre regard des artefacts documentaires vers leur condition de matérialité. L’archéologie des media telle qu’elle se développe dans l’école finlandaise (Huhtamo et Parikka 2011; Parikka 2013) s’intéresse moins aux sociabilités qu’à la matérialité des médias. Elle entend ainsi « revenir aux conditions de possibilité sous la forme des conditions de médialité, c’est-à-dire aux conditions qui permettent aux discours de prendre forme, elles-mêmes formellement déterminées par les conditions techniques des supports » (Bardini 2016, 165‑66). De manière très similaire à la théorie de l’intermédialité, et en particulier selon l’approche dévéloppée au sein de l’Université de Montréal (Larrue 2015; Besson 2014), il s’agit de retracer la matrice des relations historiques, institutionnelles et matérielles entre les médias, et qui ensemble établissent les modalités d’émergence d’un média.
Heuristique de l’appropriation
On retrouve cette inspiration écologique du milieu dans une analyse de Sébastien Rongier sur les formes d’écriture du Général Instin (GI). Le cas du Général Instin m’intéresse particulièrement en tant qu’objet littéraire collectif, mais aussi en tant que modèle pour repenser des modes de production savante collectifs. Rongier relie directement les écritures multiples du GI à un « milieu » pour parler d’un « espace littéraire et artistique » qui semble ainsi s’être davantage érigé en écosystème d’écriture plutôt qu’en artefact éditorial.
L’écriture numérique n’invente pas la plasticité de l’écriture mais expérimente de nouvelles formes de délinéarisation et d’écriture comme milieu. (Rongier 2017, sur Hypothesis)
Avec Servanne Monjour, nous n’hésitons pas à parler d’une « écriture-milieu » (Monjour et Sauret 2017), rejoignant les concepts d’écriture dispositive ou encore d’« environnement dispositif », ces concepts témoignant finalement des différentes facettes d’un même écosystème.
Par ailleurs, l’analyse de Rongier est particulièrement précieuse tant elle vient confirmer les intuitions de Louise Merzeau sur la spécificité d’une écriture en mouvement. La proximité de leurs écrits est frappante alors même que la première étudie un dispositif conversationnel ayant seulement opéré 48 heures dans le cadre d’une conférence scientifique, et que le second interprète un projet littéraire et artistique sévissant depuis une vingtaine d’années.
En s’offrant comme milieu, comme écosystème, l’expérience directe du processus de l’écriture s’intensifie. Car c’est l’expérience d’une écriture comme commun, la logique exigeante d’une relation inclusive qui ne cesse de reconfigurer les formes. C’est assurément l’exemple le plus probant d’une esthétique rhizomatique : une morphologie mouvante et infinie, sans hiérarchie ni finalité, l’œuvrement plutôt que l’œuvre, c’est aussi, me semble-t-il, une dynamique que propose le numérique et la logique du réseau qui préside au Général Instin. (Rongier 2017, sur Hypothesis)
Et chez Louise Merzeau :
L’intelligibilité des contenus éditorialisés se construit en effet non par juxtaposition ou succession de briques indépendantes, mais par tressage, croisement et rappels d’un ensemble d’énoncés qui s’enrichit à mesure que les déplacements s’intensifient. Ainsi, c’est bien dans la transversalité que quelque chose s’écrit. Par le travail d’éditorialisation collective, les traces des conférences et des interactions avec le public ne s’atomisent pas, mais reconstituent une sorte d’univers discursif, relationnel et conceptuel appelant immersion et participation. (Merzeau 2013b, sur Hypothesis)
On peut en effet identifier certaines caractéristiques communes à l’écriture littéraire d’Instin et à celles observées autour des ENMI12. On l’a vu précédemment, il y a tout d’abord cette relation étroite (récursive) entre milieu et écriture. Par ailleurs, la notion de mouvement est omniprésente dans les deux analyses, avec « un principe de mouvement et de prolifération » (Rongier 2017, sur Hypothesis) ou une « logique processuelle de tressage, de butinage et de mouvement » (Merzeau 2013b, sur Hypothesis). Ce mouvement continu, « infini », déplace justement le projet du geste d’écriture dans une finalité plus large que le discours exprimé ou l’artefact éditorial. On y perçoit en fait la promesse d’un collectif, que les deux auteurs vont bientôt mettre à jour. Les deux écritures s’appuient sur le fragment : qu’il soit « ressource » ou « prélèvement », il est à la fois contrainte littéraire, forme dispositive ou même déformation algorithmique. La forme fragmentaire suppose le montage, le remixage, le mashup, la collection, et avec cette dernière les catégories comme méta-discours collectif.
Autre caractéristique commune, et bien que déclinée de manière différente selon le milieu, le principe d’appropriation est au cœur de ces formes d’écriture. Liée à l’usage des fragments dans ce que Louise Merzeau appelle des « redocumentarisations », terme qu’elle emprunte à Manuel Zacklad (2008), l’appropriation se traduit par des réécritures successives de fragments, recontextualisés d’une plateforme à une autre, parfois commentés ou catégorisés. Cette heuristique de l’appropriation par le fragment fait écho au texte « L’auteur comme copiste » tiré de l’ouvrage Général Instin Anthologie dans lequel Nicole Caligaris propose un éloge du fragment et de son mouvement : « le texte vestige, fragment, sa transmission par citations, par évocations, par interprétations, gloses, variantes qui donnent naissance à tout un réseau de versions parallèles et successives » (Caligaris 2015). Pour parler des variations à chaque réécriture, Rongier introduit la notion d’« écart » qu’il lie à la subjectivité de chaque contributeur, tandis que Merzeau parle de « distance » et d’« interstice » entre les fragments recomposés. Ainsi, d’une écriture à sa réécriture, se dégage toujours un geste de création et/ou d’interprétation.
Or Merzeau et Rongier associent tous deux très clairement ce mode d’écriture avec « le numérique », entendu ici principalement comme l’espace du Web.
Ce que l’expérience d’écriture du Général Instin nous montre, c’est d’abord un renversement des normes par le commun, ouvert grâce au numérique notamment. C’est un risque de l’ouverture et de la multiplicité que le projet porte, le risque esthétique de la fiction. (Rongier 2017, sur Hypothesis)
Le fait qu’Instin nourrisse son écriture dans l’espace du Web n’est pas un hasard. Si le Web n’en est plus exactement à l’utopie des premières heures, il en véhicule fondamentalement certains ingrédients, encore imprimés dans ses protocoles ou sa gouvernance collective. Malgré le tournant commercial du Web des grandes plateformes, on peut ainsi se demander dans quelle mesure il est possible d’en réactiver certaines valeurs pour créer les conditions du collectif. Mais « le numérique » n’est pas tout, ou plutôt il n’est rien sans son ancrage physique et social dans l’écosystème global. Rongier ne s’y trompe pas et remarque que le GI se déploie aussi en dehors d’une sphère purement numérique, « pren[ant] et agrège[ant] toutes les formes (écriture, performance, danse, théâtre, arts plastiques, street art, musique, photographie, happening, et d’autres encore) ». Instin établit justement un milieu hybride d’actions et de gestes, laissant dire à l’auteur que « [l]a vie numérique du Général Instin est indissociable des festivals créés autour de cette figure ».
Ce rôle essentiel du numérique ou du Web comme milieu ouvre en fait la voie à de nouvelles formes d’organisation collective, déjà pressenties par Deleuze et Guatarri dans leurs écrits – le second investissant d’ailleurs largement une pensée écologique – ou encore confirmées par la théorie de la transmédialité de Jenkins. Ce qui m’intéresse au-delà des manifestations politiques ou culturelles qui ont su proliférer sur un tel milieu dès les années 2000, c’est de pouvoir envisager désormais des formes d’organisation collective engagées dans la production du savoir, ou pour être plus précis, dans l’élaboration du savoir par la conversation.
Du collectif au « faire collectif »
Face à l’analyse du dispositif conversationnel des ENMI12, le Général Instin comme objet littéraire offre un point de comparaison pertinent, notamment sur le plan du collectif.
L’expérience littéraire du Général Instin n’est sans doute pas unique. Instin n’invente évidemment pas l’écriture collective, le déplacement des formes et leurs interrelations. En revanche, la durée dans laquelle s’inscrit le projet lui donne une épaisseur et une dimension rare sinon inédite. Sans doute le numérique participe-t-il de cette durée. […] Le numérique apparaît ici comme un nœud, un espace ouvert qui concentre et diffuse en même temps. En effet, le numérique, du blog au site, en passant par les réseaux sociaux, accueille et reçoit. Pour l’écriture du Général Instin, c’est un espace d’expérimentation qui repose sur un principe de mouvement et de prolifération. (Rongier 2017, sur Hypothesis)
Rongier envisage Instin comme « un point de rencontre partagé ouvrant un dialogue artistique »« Un des effets les plus surprenant est peut-être la production d’un commun, non pas d’une communauté, même littéraire, mais la production d’un point de rencontre partagé ouvrant un dialogue artistique. C’est bien ce commun qui crée les interactions entre le réel et le virtuel (si l’on conserve encore un peu ces catégories et ces distinctions). » (Rongier 2017, sur Hypothesis)
, point de rencontre qu’il considère être un commun. S’il renverse ainsi l’attention sur le commun créé plutôt que sur la communauté, il n’en reste pas moins qu’écriture et collectif sont étroitement liés dans le « dialogue » ainsi ouvert.
La production du collectif chez Merzeau, qu’elle théorise dans ses publications ultérieures comme une « rhétorique dispositive », rejoint l’effet collectif propre au GI. Plusieurs écrits ou méta-écrits instiniens font ainsi état du GI comme d’un collectif, ou plus exactement d’un « mouvement de collectivité des individus » qui en « instinant », c’est-à-dire en écrivant, déclamant, publiant, participe à un même geste : faire collectif (Chatelier 2019). Ce collectif en devenir et jamais advenu, car toujours en mouvement, n’existe que dans ses gestes, ceux de l’écriture et de l’appropriation. À la fois corpus, collectif, écriture, le GI est cet écosystème, cette écriture-milieu qui s’autoféconde, qui existe par et pour le mouvement. Sa finalité n’est plus tant littéraire (donner à lire) que de faire mouvement, ou encore de faire collectif. Il y a là un parallèle essentiel avec la pensée de Merzeau lorsqu’elle analyse le dispositif ENMI12 et ses écritures dispositives, ou plus tard dans la rhétorique dispositive des écrits profilaires, tous deux porteurs d’un nouvel ethos collectif passant fondamentalement par l’écriture. Servanne Monjour a d’ailleurs bien montré que les pratiques notamment littéraires du profil sur les plateformes en ligne relèvent également d’une appropriation, dans son cas celle du média photographique et de sa remédiation dans le milieu numérique.
Dans le sillage des travaux consacrés à ces profils d’usager et aux mutations du concept d’identité à l’ère numériqueVoir notamment :
Louise Merzeau, « Le profil : une rhétorique dispositive », Itinéraires, 2015-3. Lire en ligne ;
Dominique Cardon, A quoi rêvent les algorithmes, Seuil, 2015 ;
Aimée Morisson, « “What’s on Your Mind ?” : The Coaxing Affordances of Facebook’s Status Update », dans Julie Rak et Anna Poletti (dir.), Identity Technologies : Producing Online Selves, UW Press, 2013 ;
Marcello Vitali-Rosati, On Editorialization : Structuring Space and Authority in the Digital Age, Institute of Network Cultures, 2018. Lire en ligne.
, nous avons montré ailleurs combien ces nouvelles formes d’écriture profilaire pouvaient jouer avec les codes picturaux, photographiques et littéraires de l’autoportraitVoir Servanne Monjour :
« L’écrivain de profil(s)... Facebook. Réflexion autour d’une photographie de profil de Victoria Welby », dans David Martens, Jean-Pierre Montier et Anne Reverseau (dir.), L’écrivain vu par la photographie, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2017. Lire en ligne ;
« Le profil numérique : un genre littéraire ? ». Dans le cadre de Narrations contemporaines : écrans, médias et documents / Contemporary Narratives : Screens, Media and Documents, Colloque organisé par Leverhulme International Network for Contemporary Studies / Chaire de recherche du Canada sur les arts et la littérature numériques, Montréal, Université du Québec à Montréal, 28 avril 2016. Voir la communication
. Les photomontages sont ainsi légion sur les profils d’artistes ou d’écrivains en ligne, où ils détournent généralement la contrainte mimétique pour se faire métonymie de l’œuvre, ou encore d’un projet esthétique ou politique. Sur Facebook, Twitter, Tumblr ou tout simplement sur des blogues, ces réappropriations à tendance ludique et poétique des dispositifs numériques formatés, notamment conçus pour tracer les usagers, permet ainsi de reprendre le contrôle de nos traces numériques et de se protéger contre le risque « d’expropriation identitaire » induit par le web. (Monjour 2018, sur Hypothesis)
Mais cette appropriation du média dans le cas des écritures profilaires décrites par Monjour ne doit pas être vue comme un phénomène séparé. Elle rejoint en fait parfaitement l’appropriation du fragment et sa « redocumentarisation », dans le même élan créatif du détournement. Le détournement est autant celui du fragment, et, dans le cas de la photographie, de ses codes et de sa sémiologie, que celui des dispositifs profilaires. Ainsi, cette appropriation conjointe du fragment et du media réitère l’hypothèse d’une écriture-milieu. Comme Rongier ou Monjour le remarquent, le caractère numérique favorise en effet la « plasticité » du milieu. En s’appuyant pour sa part sur l’image photographique et sa remédiation numérique, Servanne Monjour propose le concept d’« anamorphose » pour d’une part invalider la distinction ontologique traditionnelle entre numérique et analogique, et d’autre part pour concevoir « la dimension multiple et hétérogène des choses », là où les travaux précédents suggéraient plutôt une fusion ou une hybridationServanne Monjour poursuit cette avancée théorique en associant l’invalidité des statuts ontologiques et la révélation de la médiation à un mouvement plus profond de désessentialisation caractéristique du paradigme contemporain. Elle s’en explique notamment dans sa lecture Les impensés de la littérature contemporaine. Une lecture de Moderne/contemporain de Pascal Mougin. (Monjour 2020)
. Le modèle anamorphique nous est utile pour lever le voile sur les procédés de médiation, que l’on peut alors « concevoir […] comme un geste »La citation exacte et contextualisée est : « L’anamorphose bouscule la condition du spectateur (celui qui devait se contenter d’observer) dont le corps est désormais convoqué dans le dispositif de vision, afin de performer l’image par un “acte ontologique” : la médiation se conçoit ainsi comme un geste. » (Monjour 2018, sur Hypothesis)
:
[D]es pratiques ludiques (qui ne sont pas nécessairement le fait des « artistes » en premier lieu) fonctionnent comme des stratégies d’appropriation des nouveaux médias qui offrent l’occasion de voir le réel autrement. Ces expériences « limites », jouant d’une déformation qui confine à l’abstraction la plus totale, presque à la cécité, nous engagent à ne pas essentialiser le sens de la vue, souvent conçu comme une réalité simplement organique. Voir est aussi le résultat d’une médiation, notamment culturelle. Le média exerce et révèle les sens, il participe pleinement à leur construction. (Monjour 2018, sur Hypothesis)
La réflexion de Monjour croise finalement notre problématique conversationnelle lorsqu’elle analyse la circulation comme un trait caractéristique de l’image numérique. Comme nous l’avons vu déjà lors de l’analyse de Merzeau du dispositif ENMI12, la circulation des fragments est un des principes essentiels du dispositif, au point de laisser l’auteure concevoir ce dernier comme une dynamique et non une forme (Merzeau 2013b, voir notamment sur Hypothesis). La circulation est également au cœur de la problématique de la communication scientifique, depuis le réseau épistolaire des Lumières jusqu’aux réseaux sociaux scientifiques numériques en passant par la mission des bibliothèques et son corrélat : l’indexation des contenus. Dans le texte de Monjour, l’image numérique circule sur le Web, et ses multiples réécritures produisent des variations, ou « mutations », dans un phénomène similaire à celui précédemment décrit, relevant de l’interprétation.
Il est en effet impératif de désessentialiser le code à l’heure où l’image évolue d’abord dans un environnement numérique, le web. Car si ce milieu lui permet de se reproduire, il agit sur elle en retour. En 2014, l’artiste de rue Mark Samsonovich s’est amusé à pister sur le web la photographie de l’une de ses fresques, Water the Flowers [1]. De Twitter à Instagram en passant par Tumblr, l’image a subi une succession de recadrages, de compressions, de changements de formats, d’ajouts de filtres ou de citations… Virale, la photo avait muté tout en gardant une trace de chaque nouvel utilisateur ayant participé à sa réécriture. En d’autres termes, la photographie s’était anamorphosée à la faveur d’un processus d’éditorialisation qui est encore inachevé aujourd’hui, puisque l’image circule toujours en ligne. (Monjour 2018, (sur Hypothesis))
Après Merzeau et Rongier, on retrouve ici tous les ingrédients de notre hypothèse, à savoir le fragment écrit et réécrit dans un processus continu (un mouvement) d’éditorialisation. On retrouve par ailleurs cette écriture-milieu dont les variations de fragments sont aussi les variations du milieu lui-même. Rassemblés parfois malgré eux par le biais de leurs traces numériques – qu’elles soient signature visuelle d’une image ou métadonnées accompagnant les fragments – individus et fragments sont indexés, collectionnés et finalement mis en conversation.
Ce détour par les pratiques littéraires et artistiques remet en perspective les intuitions de Louise Merzeau tout en permettant d’introduire quelques nouveaux concepts. Étroitement liées, l’« écriture dispositive » et l’« écriture-milieu » sont envisagées pour considérer le rapport écologique de nos actes d’écriture – « écritures dispositive » – dans l’environnement numérique. L’écriture comme pratique est toujours intimement liée à son support, mais le caractère écosystémique du support numérique, lui-même de nature scripturale, induit une relation « stigmergique » (Dyens 2015) entre l’écriture et son milieu. L’« écriture-milieu » désigne ainsi cette écriture qui s’inscrit dans un milieu tout en l’agençant, c’est-à-dire aussi une écriture susceptible de faire évoluer ses propres modalités. Elle permet également de conceptualiser l’écriture comme un mouvement continu et collectif, dans lequel j’inscris mon modèle conversationnel. En cela, la conversation que je tente d’imaginer apparaît comme un mode particulier d’éditorialisation où les fragments de ressources sont constamment écrits et réécrits dans une succession vertueuse d’« écritures dispositives ». Vertueuse car ces écritures introduisent de nouvelles associations et interprétations, ouvrant la voie à une véritable création, et parce que la mise en conversation des fragments s’accompagne d’une mise en conversation des individus, engagés alors dans un faire collectif que je vais maintenant approfondir.
Les pratiques esthétiques et littéraires analysées par Rongier ou Monjour par exemple constituent, il me semble, une source d’inspiration pour repenser les communautés savantes et leurs productions. Ce que des collectifs artistiques parviennent à mettre en œuvre peut-il être transposé à l’écriture savante ? Peut-on envisager qu’une telle écriture en mouvement puisse véritablement produire des connaissances scientifiques ? J’aborde ces problématiques dans le prochain cas d’étude qui revient sur un événement scientifique un peu particulier, la Publishing Sphere, mobilisant des praticiens de l’édition, des artistes et des chercheurs autour des formes émergentes d’écriture et de publication.
Faire advenir le collectif : L’événement Publishing Sphere
Dans la partie précédente, je me suis intéressé à la pratique littéraire et artistique, dont on a vu que la conversation, en tant que mode particulier d’éditorialisation, participait à l’émergence d’un collectif. Peut-on de fait s’inspirer d’une recette mise en place par d’autres communautés, avec l’objectif de favoriser cette conversation vertueuse au sein des pratiques savantes ? C’est le pari que nous avons fait en organisant en 2019 à Montréal l’événement Publishing Sphere pensé comme un espace de conversation performatif, c’est-à-dire susceptible d’ouvrir d’autres espaces de conversation. Il s’agissait alors de déployer un environnement-dispositif, composé de multiples espaces d’écritures, de temporalités alternées, de groupes de travail, avec une intention délibérée de façonner un espace public et de surcroît un collectif. Ce troisième cas d’étude fait donc état d’un événement scientifique un peu particulier dont je commencerai par présenter les tenants ainsi que le dispositif. Je me concentrerai ensuite sur l’un des six groupes de travail auquel j’ai pris part personnellement, et dont la conversation s’annonçait particulièrement riche. Le groupe rassemblait en effet des pratiques et des positions théoriques hétéroclites, mais susceptibles de converger, depuis la pratique d’écriture performative et collective au sein du Général Instin (que je viens de présenter) à la pratique des communs comme paradigme de gouvernance collective, ou encore à la création d’institutions fictionnelles comme mode opératoire dans l’espace public. Avouons-le dès à présent : cette convergence n’a pas eu lieu. Je m’attacherai à en comprendre les raisons et à faire dialoguer cette expérience pratique avec des écrits me permettant de préparer un terrain favorable à la conversation.
La Publishing Sphere, une énonciation performative
La seconde édition de l’événement Publishing Sphere se basait sur un double postulat : l’éditorialisation comme processus de production d’espace, et la publication comme modalité de rendre public, pour explorer l’hypothèse selon laquelle certaines formes d’écriture et de publication favorisent la conception des espaces publics. Selon les mots de Lionel Ruffel, initiateur de la première édition à Berlin en 2017, la “publishing sphere” désigne « une sphère artistique et politique vibrante », émergeant depuis quelques années d’« une abondance de pratiques littéraires – performances, lectures publiques, créations sonores et visuelles et nouveaux espaces publics »Fragments traduits de la phrase : “In recent years an abundance of literary practices – performances, public readings, sound and visual work and new public spaces– have emerged, forming a vibrant artistic and political ‘publishing sphere’.” (« The Publishing Sphere Ecosystems of Contemporary Literatures » 2017, sur Hypothesis)
. Son point de départ s’appuie sur le constat selon lequel les pratiques d’écriture et de publication se sont émancipées de leurs canaux traditionnels :
The realm of writing has never been so extensive; nor has the idea of publication ever been so plural. Not a day passes without a great percentage of humanity publishing one or numerous texts: on a blog, a social media network, or elsewhereTraduction automatique corrigée : « Le domaine de l’écriture n’a jamais été aussi vaste, et l’idée de publication n’a jamais été aussi plurielle. Il ne se passe pas un jour sans qu’un grand pourcentage de l’humanité ne publie un ou plusieurs textes : sur un blog, un réseau social, ou ailleurs. »
. (« The Publishing Sphere Ecosystems of Contemporary Literatures » 2017, sur Hypothesis)
Cette libération de l’écriture constitue pour lui « une œuvre littéraire au-delà de la matérialité du livre ». Pour parler de ces pratiques littéraires et éditoriales contemporaines, Ruffel forge le terme de littérature « brouhaha », qu’il développe dans un ouvrage du même nom (2016). Chez Ruffel, « brouhaha » et “publishing sphere” renvoient au même phénomène. La dernière cependant rend compte de la dimension éditoriale de ces pratiques, qu’il reconnait comme indissociable du champ littéraire contemporain. En organisant l’événement Publishing Sphere, il s’agissait ainsi d’« interrog[er] les agents et acteurs qui occupent le champ » littéraire, à savoir les canaux traditionnels de l’édition et de la publication, par l’exploration et l’exposition « d’autres formes d’édition que les textes »Fragments traduits de la phrase : “They [les participants à l’événément] explore what constitutes a literary work beyond the materiality of the book, expose other forms of publishing besides texts, and survey the agents and players who inhabit the field.” (« The Publishing Sphere Ecosystems of Contemporary Literatures » 2017, sur Hypothesis).
.
L’un des aspects particulièrement inspirants de l’événement montréalais résidait dans sa récursivité (encore), considérant qu’on ne pouvait explorer et questionner cette sphère artistique qu’en reproduisant à petite échelle, pendant le temps de l’événement, une sphère créative, critique et littéraire. Lors de son allocution d’ouverture face aux participants, Ruffel parle d’« énonciation performative » pour rendre compte du dispositif mis en place pour les trois jours suivants. Ce terme est intéressant, car il renvoie d’un côté à l’« énonciation éditoriale » d’Emmanuel Souchier (1998) c’est-à-dire à « ce qui fait la matérialité » d’un texte dit premier, et à la « matérialité performative » de Johanna Drucker (2013) du medium ou des supports. L’énonciation de l’événement consiste en quelque sorte à créer les conditions matérielles d’une autre production. Mais cette dernière n’est pas première, comme c’est le cas notamment avec l’énonciation éditoriale d’un texte tel que Souchier le pense dans un contexte éditorial classique. Au contraire, dans le contexte de l’événement, la production est encore à venir, installant la Publishing Sphere-événement dans une dynamique performative de sphères d’écritures et de publications encore à inventer. C’est en cela que l’« énonciation performative » proposée par Ruffel fait écho à la « matérialité performative » introduite par Johanna Drucker. Avec cette notion, l’auteure cherche à sortir d’une approche de la matérialité linéaire ou littérale, par laquelle les propriétés matérielles d’un medium peuvent être interprétées en tant que telles, conditionnant « mécaniquement » les discours produits avec ou par ce média.
Literal materiality is based on a mechanistic model that suggests that the specific properties of material artifacts or media can be read as if meaning were a self-evident product of form, […].Ma traduction : « La matérialité littérale est basée sur un modèle mécaniste qui suggère que les propriétés spécifiques des artefacts matériels ou des supports peuvent être interprétées comme si le sens était un produit évident de la forme. »
(Drucker 2013)
Au contraire, le cadre conceptuel d’une matérialité performative prend en compte la dimension interprétative de l’utilisation des supports et de ses propriétés matérielles.
In this framework, we chart the shift from a concept of things as entities to a concept of them as events, from a notion of what is to that which is always in flux, from a literal to a contingent materiality that is exposed by the performative dimension of use.Ma traduction : « Dans ce cadre, nous décrivons le passage d’une conception des choses comme entités à une conception des choses comme événements, d’une notion de ce qui est à ce qui est toujours en mouvement, d’une matérialité littérale à une matérialité contingente qui est révélée par la dimension performative de l’utilisation. »
(2013)
La matérialité (d’un support) devient un point de départ, une « provocation »Le terme provocation pourrait également être traduit ici par impulsion.
, mais n’en limite en aucun cas les écritures. Celles-ci n’en sont pas induites, et doivent être interprétées non pour ce qu’elles sont (entités), mais comme mouvement ou processus continu, en prise constante avec la matière qui les supporte. Cela rejoint la notion d’écriture en mouvement déjà abordée précédemment. Drucker en conclut que notre regard ne doit pas s’arrêter à ce qu’un objet est, mais se tourner vers ce qu’il fait.
Performative materiality suggests that what something is has to be understood in terms of what it does, how it works within machinic, systemic, and cultural domains.Ma traduction : « La matérialité performative suggère que ce que quelque chose est doit être compris en termes de ce qu’il fait, comment il fonctionne dans les domaines machinique, systémique et culturel. »
(2013)
C’est justement l’approche que j’ai privilégiée en tentant, à travers les différents cas d’étude, de saisir la conversation par le collectif plutôt que par les artefacts censés la produire. Puisque les formes (ou les formats) ne suffisent ni à “provoquer” la conversation ni à l’interpréter sur le plan épistémologique, pourquoi ne pas déplacer notre regard, comme le Général Instin nous y invite ? Pour ses membres, le GI n’est en effet ni un corpus littéraire, ni même comme un collectif littéraire, mais un « faire collectif », advenant par le mouvement continu d’écriture·s au sens large.
Pour reprendre mon cas d’étude, la dimension performative de la Publishing Sphere comme événement s’est jouée dans les conditions rassemblées pour générer de nouvelles publishing spheres. Pour cela, le dispositif à Montréal était relativement simple. L’événement réunissait une trentaine d’éditeurs, d’artistes, d’auteurs, de designers, et de chercheurs répartis en 6 groupes de travail. Chaque groupe de travail avait pour objectif de concevoir et de réaliser une ou plusieurs “sphère·s”, incarnée·s dans des dispositifs et/ou des productions éditoriales, qu’elles soient poétiques, littéraires, expérimentales, documentaires ou autre. Après une première édition plus littéraire, l’événement de Montréal a cherché à tisser des liens entre des mondes éditoriaux divers, en explorant aussi les enjeux épistémologiques des formes d’édition émergentes sur la production des savoirs.
L’intention délibérée des organisateurs de produire, le temps de l’événement, un espace public susceptible de faire collectif, incite à conceptualiser a posteriori cet espace comme un environnement-dispositif. Celui-ci s’est notamment incarné dans la mise en place d’espaces d’écritures multiples, dans la prise en compte de temporalités alternées (moments synchrones d’échanges collectifs, moments asynchrones de conception en groupe, moments d’écritures individuelles), ou encore dans l’instauration de groupes de travail et d’objectifs communs. Si une telle démarche peut sembler quelque peu préfabriquée, son artificialité est contre-balancée par l’attention des participants, mobilisée dans une double performance, celle de jouer l’espace public, et celle de concevoir une ou plusieurs sphère·s malgré les contraintes serrées. On retrouve en fait le « régime participatif » des barcamps, hackathons ou autres ateliers créatifs, proposant un contexte de co-création et une « dynamique attentionnelle » destinée à « faire converger des intentionnalités disparates autour d’un même projet » (Merzeau 2013b, sur Hypothesis).
Produire une sphère de publication : l’invention de Pink my pad
Un premier brainstorm de l’équipe organisatrice (mars 2019) sur un dispositif numérique pour l’événement a abouti à une liste d’actions génériques, inférées des différents outils, espaces ou plateformes envisagées pour produire une sphère de publication. Ces actions balisent en quelque sorte un panel de potentialités en lien avec le faire propre à cet événement. Les voici rassemblées selon leur champ sémantique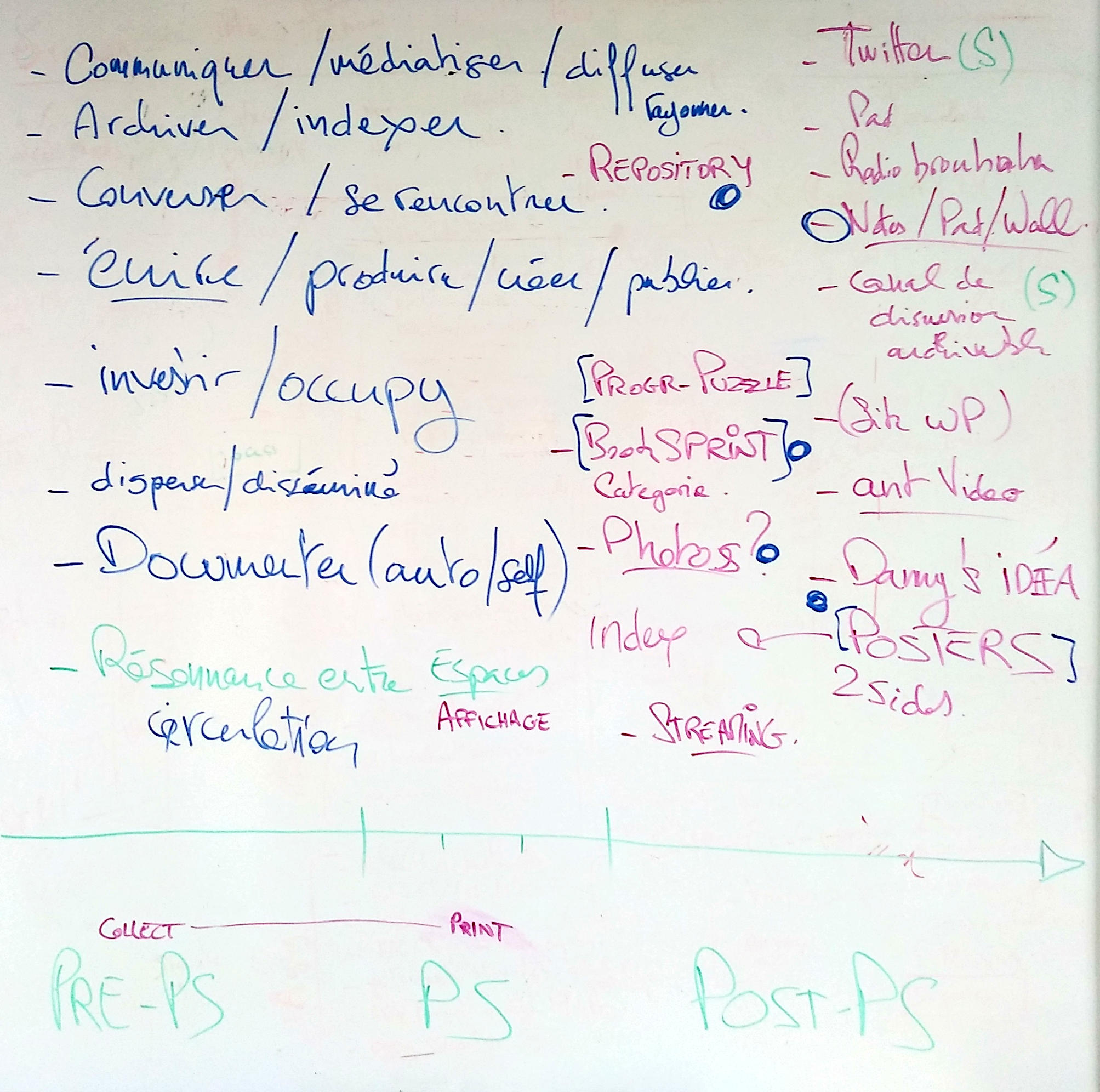 Brainstorm sur le dispositif Publishing Sphere (mars 2019)
Brainstorm sur le dispositif Publishing Sphere (mars 2019)
:
- Communiquer, médiatiser, diffuser, rayonner
- Archiver, indexer
- Converser, se rencontrer
- Écrire, produire, créer, publier
- Investir, occupy
- Disperser, disséminer
- Documenter (auto/self)
- Circulation
De cette première réflexion collective j’avais proposé une ébauche de dispositif articulant quatre activités principales : Collecting, Writing, Conversing, et Talking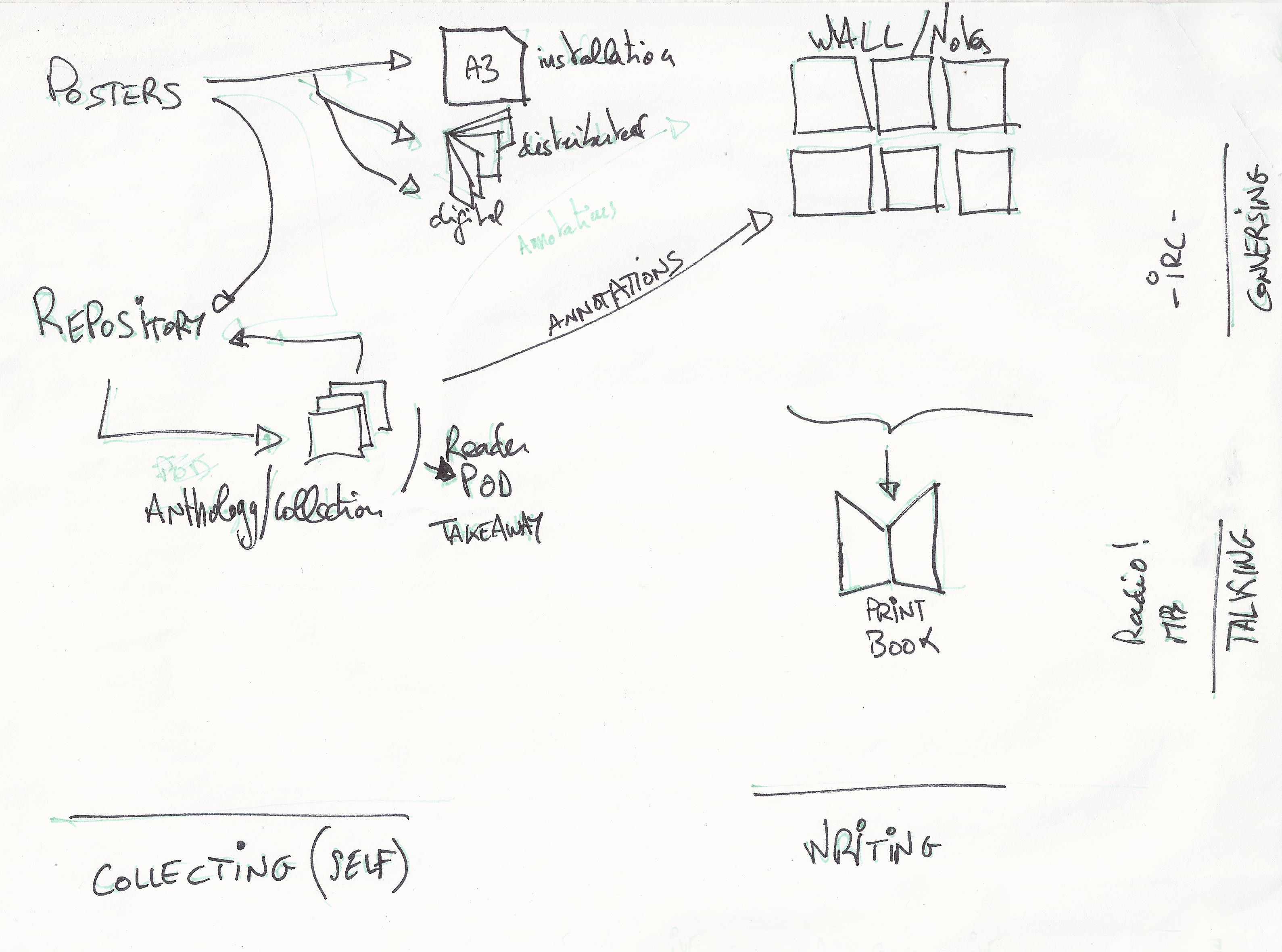 Dispositif Publishing Sphere
Dispositif Publishing Sphere
. Les trois premières sont certainement les plus importantes, Talking (« parler ») ayant été retenu opportunément pour anticiper les captations sonores de Lionel Ruffel dans le cadre de sa Radio Brouhaha. Les entretiens radio menés pendant l’événement ont d’ailleurs été rebaptisés par la suite « conversations collectives ». On peut apercevoir ici un cycle correspondant très schématiquement à celui de la recherche et de la production de la connaissance : collecter des données (sur un terrain, dans une bibliothèque, etc.), puis écrire à partir de ces données pour proposer une analyse, une interprétation, une idée nouvelle, et enfin en parler, dialoguer, pour vérifier ses analyses, les enrichir ou les réfuter. Un tel schéma relève bien entendu d’une simplification excessive, mais il est permis de se demander si une telle simplification n’établit pas un terrain favorable à l’émergence de choses… La particularité du dispositif Publishing Sphere au sens large, vis-à-vis de ce cycle de recherche, aura été de rendre ces trois étapes concomitantes plutôt que successives, et pleinement collectives, que ce soit par la transparence et l’ouverture des espaces d’écritures ou par l’organisation sociale du travail.
C’est en cherchant à répondre à ce triptyque que nous avons développé un outil dédié, pensé comme un espace commun d’écriture qui puisse à la fois ou alternativement être utilisé pour documenter, informer, s’organiser, réfléchir, mais aussi lire, agréger, réagir, discuter. En adoptant une approche lowtech engagée, nous avons bricolé une plateforme aussi simple qu’efficace, combinant trois outils existants :
- l’éditeur de texte collaboratif Codi-md, proposant une interface d’écriture au format markdown et de publication au format HTML,
- le convertisseur de document numérique Pandoc, permettant de transformer le contenu produit sur l’éditeur de texte,
- l’outil d’annotation du web Hypothes.is, ajoutant à toute page web un module pour d’annotation de texte.
Il peut être utile de revenir sur l’origine de cet outil et sur la chronologie de son bricolage. Inspiré de l’outil Note(s) Note(s), développé par Émile Greis et Vincent Maillard, qui a inspiré notre outil pink my pad. Voir sur le site personnel de ce dernier
développé en PHP et proposant une éditorialisation HTML d’un pad d’écriture collaborative (Etherpad), j’avais développé quelque temps auparavant un outil similaire de publication d’un document au format Markdown sur le Web au format HTML. Cette application minimaliste exploitait l’intégration continue de la plateforme Gitlab. En plus de leur service de stockage et de versionnage de répertoires, les plateformes telles que Github ou Gitlab proposent en effet des process d’intégration continue pouvant être utilisés pour héberger et publier les applications ou les pages stockées sur ces répertoires. Il est ainsi possible de mettre en ligne un site généré depuis un répertoire de fichiersC’est le cas par exemple de mon site web personnel, stocké et versionné sur github.com/lakonis/lakonis.github.io, et publié en ligne sur le domaine lakonis.github.io, vers lequel est redirigé le domaine nicolassauret.net.
. Pour ce faire, Github se charge, à chaque mise à jour des sources, de compiler le site selon une séquence d’instructions précises, à partir des sources stockées dans le répertoire. La séquence d’instructions listées dans un script se charge également de déplacer les fichiers nécessaires à l’affichage du site sur une machine dédiée à la publication. C’est à partir de ce mécanisme de « déploiement continu » que j’ai testé un script de déploiement minimaliste supposé 1) récupérer (wget) un fichier au format markdown, 2) le convertir (pandoc) au format HTML dans un fichier index.html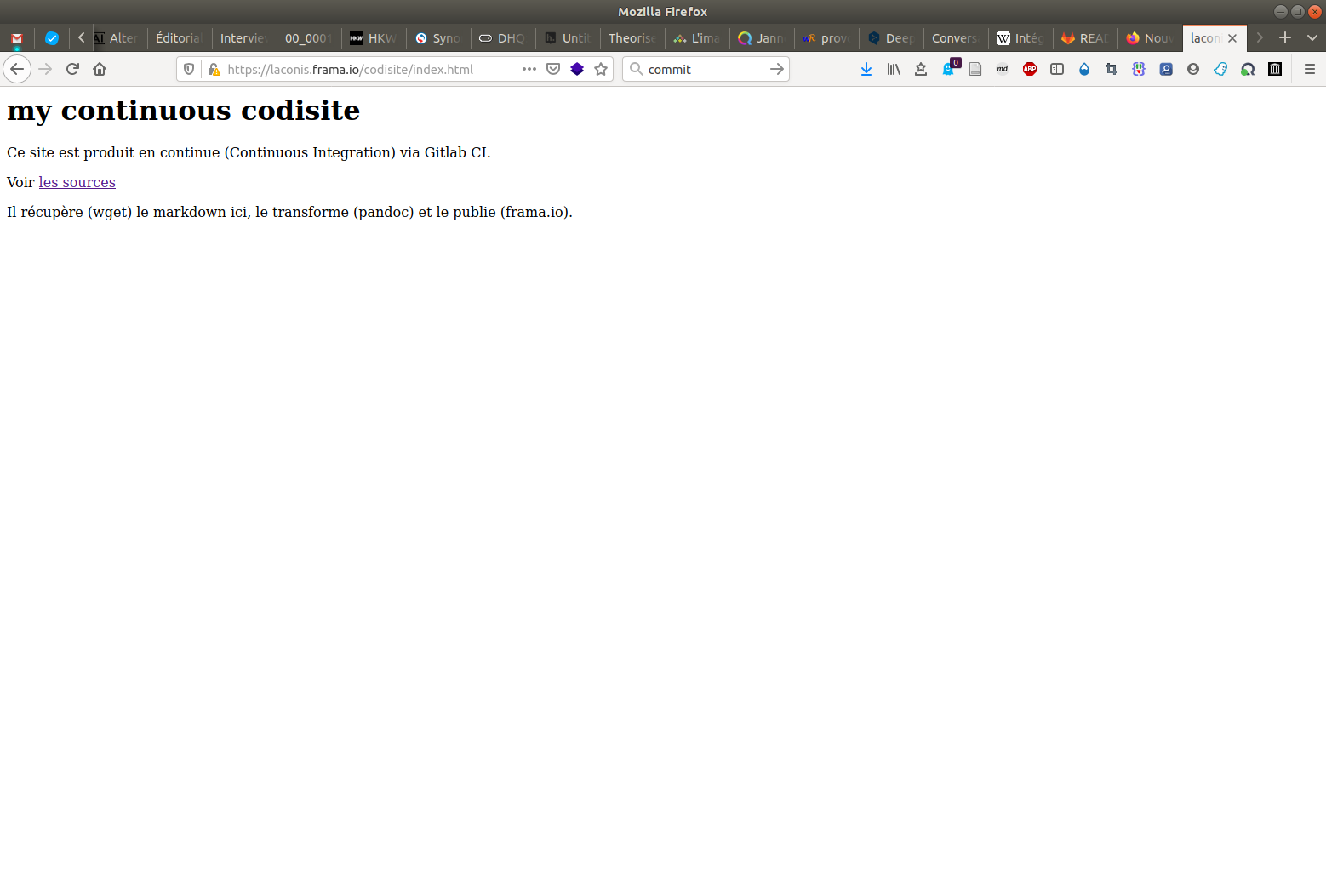 Première page du Codisite publiée à partir d’une source au format Markdown provenant de la plateforme Codi-md
Première page du Codisite publiée à partir d’une source au format Markdown provenant de la plateforme Codi-md
.
Preuve de concept simpliste : Les trois instructions du fichier d’intégration continue /codisite/gitlab-ci.ylm
Cette première preuve de concept tombait à pic lorsqu’il a été question d’ouvrir un espace d’écriture commun. Il s’agissait de reprendre le principe général (exploiter un éditeur de texte collaboratif) et de l’améliorer. Plusieurs fonctionnalités ont rapidement été ajoutées :
- multi-notes permettant de créer très simplement de nouvelles notes
- note modulaire structurée en sous-notes (titre de niveau 2),
- accès direct au pad d’écriture (Write) et mise à jour de la note (Refresh)
- système de mot-clés catégorisés permettant de filtrer les sous-notes. Par exemple un mot-clé simple
@conversationet un mot-clé catégorisé@type:informationsou@author:nicolas - sommaire des sous-notes et index cliquable des mot-clés,
- mise en forme de la note (feuille de style CSS).
Ces améliorations seront réalisées conjointement avec Marcello Vitali-Rosati, dans une première version basée sur un script bash. Puis, transposée en node.js par Arthur Juchereau, une seconde version permettra de gérer le multi-notes et leur mise à jour.
Ainsi la preuve de concept initiale a évolué vers une application combinant simplement trois outils éprouvés dans une chaîne éditoriale minimaliste consistant fondamentalement à écrire, convertir et annoter.
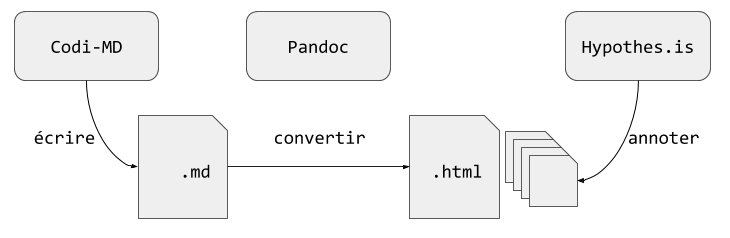
La simplicité de l’application et de la chaîne en ferait un bon candidat pour une technologie dite “lowtech” : rien n’est automatique, c’est l’utilisateur qui opère chacune de ces trois actions, l’application elle-même n’utilise aucune base de données, et ne fait que stocker des fichiers HTML statiques convertis à la demande. La réalité est un peu plus complexe, car si le convertisseur Pandoc peut effectivement être considéré comme un outil lowtech (bien que sophistiqué), l’application exploite les clients et les API de deux plateformes (Codi-md et Hypothes.is) relativement conséquentes en termes d’infrastructures technologiques.
Il n’empêche. Si l’application a été initialement développée pour la Publishing Sphere, sa généricité, que l’on peut résumer fondamentalement à écrire et publier, lui a permis d’être utilisée de manière extensive à plusieurs reprises dans des cadres et pour des communautés différentes. pink my pad a par exemple été employée pour l’écriture collective d’un cahier de propositions dans le cadre des élections municipales 2020 en FranceVoir le cahier final sur politiquesdescommuns.cc.
. L’expérience a donné lieu à une cinquantaine de notes rédigées et annotées collégialement. On peut aussi citer l’exemple de la table ronde « Manifesto » (Collectif 2020) qui s’est appuyée sur l’application pour revisiter le format institutionnalisé de la table ronde, et qui questionnait justement les formes institutionnelles de communication scientifique, appelant à l’expérimentation d’autres « pratiques d’édition et de légitimation ».
Une telle diversité d’usages s’explique par la généricité mais aussi par la souplesse de l’outil. La conjonction presque indolore entre ces trois moments, écriture, publicationOn pourrait parler ici d’éditorialisation dans la définition restreinte que lui donne Manuel Zacklad (2019) et qu’il assimile à ce qu’il appelle « documentarisation éditoriale » (Zacklad 2007b).
et annotation, permet la coexistence de plusieurs modes d’action (écrire, lire, échanger) et l’articulation de leurs temporalités spécifiques. On retrouve partiellement les trois activités pressenties lors de la conception initiale du dispositif : Writing, Collecting, Conversing. C’est ainsi que plusieurs notesVoir en particulier the Publishing Sphere Reader (A Repository), “working as an indexed Reader, streaming the materials produced during and for the PS, proposed by Michael Nardone”.
créées pendant l’événement ont servi d’espace de collecte et d’agrégation de ressources. Par ailleurs, si l’application propose un format unique pour l’éditorialisation des notes, elle a su conserver la généricité des deux plateformes Codi-MD et Hypothes.is, sans en orienter les usages. Selon les usages rencontrés, l’application est devenue un espace d’information, de documentation, d’écriture collective, d’échange, d’agrégation/curation, etc.
En l’absence de tout système d’authentification ou de base de données requêtable, chaque utilisateur ou collectif s’emparant de l’outil démarre son usage par une première note et y indexe les notes suivantes. Ce principe rappelle les débuts du Web dont une bonne pratique consistait à lister sur la page d’accueil d’un serveur les différentes pages hébergées sur ce dernier. Pour cet événement, la note index a été intitulée “WRITING”, déclarant explicitement l’ouverture un espace d’écriture. Elle a servi de point de départ et de référence pour l’ensemble des notes produites pendant l’événement. “WRITING” s’ouvre avec cet incipit :
The Publishing Sphere emerges from writing in its broadest sense. For that very reason, it provides this Read/Write space that everyone can use to express, document, exchange, copy and paste, rewrite, remix and mashup.
Un espace d’écriture ouvert, transparent et appropriable, dont chaque groupe pouvait s’emparer pour travailler, documenter et partager leurs progrès. L’espace de la note index s’est révélé non pas centralisant, mais centrifuge, élaborant rapidement un dense réseau de notes. Ainsi, l’espace ouvert par pink my pad constitue en quelque sorte une méta-sphère, support à l’éclosion de nouvelles sphères. C’est à travers cette première écriture dispositive que la Publishing Sphere de Montréal réalisait effectivement l’« énonciation performative » des publishing spheres, en gestation sur les notes de chaque groupe de travail.
Suivant cet incipit, l’index présentait l’archipel des dispositifs, des outils ou des espaces prévus par les organisateurs, ainsi que diverses initiatives des groupes ou des participants.
- A Conference Participant Map & Annotation Extraction Poster (proposed by the Poetic Infrastructures group)
- A Human-Located Publishing Sphere Reading Series (proposed by the Poetic Infrastructures group)
- Radio Brouhaha, a resonance program conceived by Lionel Ruffel, that will cover a second time the Publishing Sphere.
- A Conference Reader (proposed by the Poetic Infrastructures group)
- A repository, working as a indexed Reader, streaming the materials produced during and for the PS, proposed by Michael Nardone
- A storage space (NOW READ ONLY) to drop and store all your files (media, photo, document, …), think of it as a ©Dropbox or a ©Drive, yet free and open. (It is now read-only).
- An thematic issue at Remue.net, proposed by Patrick Chatelier and Eric Darsan.
- An archive, yet to be imagined, will be gathered following the event.
- An official website ! publishingsphere.ecrituresnumeriques.ca
- A in-live photographic follow-up by Louis-Oliver Brassard !
Archipel mis à disposition des participants
Cette simple liste dessine en fait une infrastructure d’écriture, prise au sens large, supportant les différentes écritures que sont la collection, l’agrégation, la curation, l’organisation, l’illustration, l’archive, etc.
Mais une telle infrastructure fait-elle à elle seule émerger le collectif ? Elle n’est bien entendu qu’un acteur parmi d’autres de l’environnement-dispositif, qui ne peut être saisi qu’en analysant de plus près les processus de chaque expérience Publishing Sphere. Bien qu’une analyse exhaustive des six groupes de travail constituerait sans aucun doute un travail de recherche pertinent, en faire l’inventaire ici serait trop long. Je me concentrerai sur le groupe « Institutions fictionnelles », dont j’ai été l’animateur et dont le processus n’a pas été sans accrocs malgré un dispositif qui a bien fonctionné dans les autres groupes. L’expérience que je retire de cette rencontre manquée est riche d’enseignements, tant le groupe a été révélateur des limites et des difficultés du collectif, et finalement de ses enjeux.
Les limites du projet « Institutions fictionnelles »
Parmi les six groupes de travail réunis lors de l’événement, le groupe Institutions fictionnelles promettait une réflexion particulière sur le collectif et sur l’espace public. Ces deux notions sont en effet investies par chacun des participants du groupe à travers sa pratique artistique, éditoriale, activiste, ou encore ethnographique.
Le groupe rassemblait notamment deux membres du collectif Général Instin, Eric Darsan et Patrick Chatelier. Ce dernier, éditeur de la plateforme de création littéraire Remue.net, a été et reste encore la figure la plus investie dans le GI. Instin répond parfaitement aux caractéristiques de ce que Lionel Ruffel a appelé « la littérature brouhaha »« [C]ette multitude d’espaces publics caractérise le moment contemporain de la littérature, comme la sphère publique de la Littérature caractérisait sa représentation moderne. Si ces espaces publics ont toujours existé, même lorsqu’on les mettait sous silence, jamais ils n’ont été aussi nombreux et visibles. Non seulement ils se sont multipliés, mais ils se sont très largement diversifiés si bien que le littéraire aujourd’hui apparaît en très grande partie comme une arène conflictuelle composée d’une sphère publique hégémonique reposant sur l’imprimé et d’une multitude d’espaces publics contre-hégémoniques relevant plutôt d’une « littérature-brouhaha » (exposée, performée, in situ, multi-support) avec de très nombreuses circulations entre eux. » (Ruffel 2016, 183)
dont les modes de publication réinvestissent l’espace public, ou plutôt réinventent des espaces publics. Par ailleurs, nous avons vu plus en amont de la thèse comment Instin s’est révélé, de par son écriture en mouvement, une dynamique collective, laissant dire à Chatelier que le GI n’est pas un collectif littéraire, mais qu’il fait collectif. Que peut-on dire d’une telle affirmation et que nous apprend-elle, au-delà du « moment contemporain » de la littérature et des arts théorisé par Ruffel, pour repenser la publication et la communication scientifique ?
Le groupe comprenait également Sebastien Thiéry, enseignant à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Malaquais et fondateur du PEROU, le Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines. Le PEROU se présente comme un groupe d’action développant « des recherches-actions sur les confins de nos villes (bidonvilles, jungles, squats, refuges en tout genre) et les gestes, formes, actes d’hospitalité qui s’y inventent »Voir la note sommaire du groupe Institutions fictionnelles.
. Le PEROU a par exemple échafaudé au cœur de la jungle de Calais diverses institutions comme l’Ambassade du PEROU, dédiée à l’hospitalité, ou le Palais, dédié à Yvette, doyenne des riverains de la jungle qui donnait bénévolement des cours de français à ses habitants. Il y publie de faux journaux, et procède à un « relevé des actes d’hospitalité ». Toutes ces actions et inscriptions sont pour Sébastien Thiéry des « requalifications » et des « republications » d’actions et d’inscriptions du réel déjà performées, que le PEROU entreprend de performer à nouveau. Parce qu’il reconnaît que « le bidonville est une écriture qui légifère en silence par ce qu’elle crée sur le territoire »Voir la note d’intention « Avec quoi nous venons », et sur Hypothesis.
, le PEROU enquête, collecte, procède aux relevés de cette écriture, dans le but affirmé de « répond[re] à des écritures assassines qui gouvernent »[Ibid., sur Hypothesis].
Camille Louis a rejoint le groupe en tant qu’artiste dramaturge et co-initiatrice du collectif KOM.POST. Son travail se situe à la rencontre de l’art et de la politique à travers des « propositions dramaturgiques qui […] visent à modifier les conditions de perception de ce que l’on nomme “action” (drama)»Voir sa biographie sur la note sommaire du groupe Institutions fictionnelles et sur Hypothesis.
. Ses terrains d’action croisent ceux du PEROU avec un engagement artistique et journalistique sur la question des migrants en Europe, par exemple avec l’édition la Jungle et la ville sur la plateforme de blogs de Médiapart.
Le groupe était initié par Sylvia FredrikssonMes travaux croisent ceux de Sylvia Fredriksson à plusieurs reprises, avant et pendant le doctorat. En 2012, nous élaborons ensemble le dispositif ENMI12, elle à titre de designeuse en collaboration avec l’association Knowtex et enseignante au BTS Multimédia du Lycée Jacques Prévert, et moi à titre d’ingénieur à l’IRI qui organise les Entretiens du nouveau monde industriel (ENMI). En 2017, nous proposons à la revue Sens public un dossier sur les communs « en train de s’écrire », publié en mars 2018, qui fait l’objet de la partie suivante. En 2019 enfin, dans le cadre de la Publishing Sphere, je l’invite à initier une thématique pour ce groupe de travail constitué.
, chercheuse et designeuse dont j’ai déjà eu l’occasion de parler, engagée elle aussi dans une recherche-action au sein du mouvement des communs en France, recherche qui se traduit notamment par un travail minutieux d’entretiens et de documentation sur ses propres espaces de publication : notamment le site Note(s), son compte Soundcloud ou encore son site personnel. Pour initier la publishing sphere qu’on lui confiait quelques mois avant l’événement, Sylvia s’est appuyée sur une mission en cours aux côtés de l’artiste Claire Dehove, l’amenant à proposer une réflexion sur les institutions fictionnelles. Le projet de Claire Dehove, intitulé « Ambassade des communs » est porté en 2014 par WOS / Agence des HypothèsesWOS se définit comme « organisation collaborative et extra-disciplinaire basée sur le co-autorat ». (« L’Ambassade de La MétaNations » 2019, 46)
dans le cadre du programme Les Nouveaux Commanditaires, un programme de mécénat associant une communauté commanditaire et un artiste pour mener des actions collectives régies par un « Protocole donn[ant] la parole à tous les acteurs sociaux concernés »Voir la note d’intention des Nouveaux Commanditaires, et sur Hypothesis.
. Dans ce contexte, l’Ambassade des communs, pensée comme une institution fictive, est venue s’installer physiquement dans un hall de la maison des arts de l’Université Bordeaux Montaigne. Le projet cherchait à revitaliser un lieu en créant les conditions de sa convivialité et de son partage, et en mobilisant les désirs et autres modalités d’appropriation de sa communauté.
ajouter ici potentiellement des citations de Claire Dehove sur le collectif (voir Chutes)
Toutes ces initiatives et ces projets se trouvent ancrées dans des terrains d’action où l’écriture revêt manifestement une forme performative, que ce soit pour l’Ambassade des communs appliquée à asseoir l’existence d’une institution par une série d’inscriptions et de documents, pour le PEROU attaché à « enquêter », « décrire », « instituer », ou encore pour le Général Instin dont les diverses manifestations textuelles ont engendré, au fil des performances et des ateliers d’écriture, davantage qu’une simple figure littéraire. Mis ensemble, de tels horizons de pratiques et de pensées laissaient présager une rencontre extrêmement porteuse et productive, tant chacun semblait par ailleurs rompu à l’accueil et à la collaboration. Tous, enfin, partageaient une même sensibilité au collectif, que ce dernier soit appréhendé comme postulat, processus ou même finalité.
C’est ainsi que Sylvia Fredriksson, jouant le jeu de la note de groupe comme espace commun d’écriture, initie la réflexion dans une note d’intention :
À l’origine de ce groupe, une intuition, portée par les organisateurs de Publishing Sphere, que nous (Camille, Général Instin, Éric, Érik, NathalieNathalie Casemajor et Erik Bordeleau n’ont finalement pas pu participer à l’événement.
, Patrick, Sébastien, Sylvia) pouvions nous réunir pour nous saisir des enjeux qui touchent aux “communs” et aux “configurations urbaines dans les marges”.Voir sur la note pink my pad du groupe Institutions fictionnelles, et sur Hypothesis.
Cette première note se place sur un plan très théorique, en introduisant notamment comme axe de réflexion les communs, à propos desquels Sylvia Fredriksson invoque des travaux récents et pointus en études juridiques (Isabelle Stengers et Serge Gutwirth). En plaçant son discours sur un tel niveau d’abstraction, Sylvia Fredriksson cherche un dénominateur commun autour duquel fédérer le groupe. Sa note d’intention révèle à la fois sa rigueur conceptuelle et l’ambition politique qu’elle souhaite donner à ce projet.
De cette analyse, se révèle à nous l’urgence de réinventer ce qui préexiste même à nos institutions, de réinvestir nos mémoires partagées, et de réinterroger la composition de nos savoirs, en mettant en tension les principes prééminents de nos sociétés modernes.
Si, au cœur du projet des communs se loge l’enjeu de la création institutionnelle, en redéfinir la teneur s’impose comme un impératif.
Les communs seront alors ici envisagés comme un espace politique en réécriture permanente, et leur redéfinition la condition même de possibilité de la création institutionnelle. Autour de quoi faire institution ? Il est proposé au groupe, en formulant un certain nombre d’hypothèses et à travers une conversation croisée, de réinvestir les communs comme un espace politique en train de se faire.Voir sur la note pink my pad du groupe Institutions fictionnelles, et sur Hypothesis.
Elle formule également un « ACTE qui nous réunit », ainsi que des propositions concrètes de dispositif. Elle fait des communs un principe directeur pour les actions du groupe et énonce finalement un « appel à la conversation » comme « mode opératoire » du groupe. Elle invite alors les participants à formuler une série d’hypothèses.
- On débattrait du droit autorisant certaines idées à suivre leur libre parcours
- La valeur résiderait dans la communauté d’action licite ou illicite
- Nous aurions besoin d’une politique dotée de la force de coalitions diverses et mobiles. [par Sylvia Fredriksson]
- Des fictions ontologiques donneraient naissance à des institutions parasitaires et clandestines. [par Sebastien Thiéry]
- Créer une Diplomatie fantômnale. [par Patrick Chatelier]. en lien avec l’hypothèse Des fictions ontologiques donneraient naissance à des institutions parasitaires et clandestines [par Sébastien Thiéry] — et les communs latents Anna Tsing (voir prolongement ci-dessous)
- Renversement de la proposition de Sebastien Thiéry en : « Des institutions parasitaires et clandestines donneraient naissance à des fictions ontologiques » dans le cadre de la « Diplomatie fantômnale » proposée par Patrick Chatelier. L’idée serait d’entrevoir un (des) récit(s) commun(s) capable de con-/re-/stituer une autre vision de la nature et de la culture, de l’histoire et des relations. […] [par Eric Darsan]
Hypothèses formulées par les participants (extraits)Voir sur la note sommaire du groupe Institutions fictionnelles.
Toute cette démarche puise dans son expérience pratique de contextes similaires de co-création et de coopération. Plutôt que d’imposer à ses pairs un dispositif ou un protocole, Sylvia Fredriksson ouvre une première conversation en soumettant au groupe un cadre théorique sur lequel élaborer collégialement une initiative artistique ou éditoriale. La démarche conversationnelle est ici consciente et délibérée.
Et pourtant, dans ce groupe précisément, rien ne s’est passé comme prévu. Concrètement, nous avons passé trois jours à discuter sans réussir à faire émerger un consensus d’action collective entre les participants – à l’inverse des dynamiques propres aux autres groupes. Voyant les différentes impasses dans lesquelles le groupe s’embourbait, nous avons tenté de diversifier les dispositifs d’échange et de conversation.
Toutes ces actions ont été documentées sur la plateforme pink my pad dans une série de notes, utilisées alternativement comme espace d’écriture individuel, prise de notes des conversations en présentiel, documentation des processus, espace de conversation via les annotations Hypothesis, ou encore comme espace de publication à l’instar de l’entretien que Sylvia mènera au dernier jour avec Sébastien Thiéry. Cette production de textes tous azimuts est remarquable, mais présente une contradiction. D’un côté, ce groupe aura écrit davantage que les autres groupes, mais sans réussir collectivement à sortir de la sphère déjà en place. En effet, là où d’autres groupes ont utilisé la plateforme comme support de travail pour projeter des espaces nouveaux et proposer des formes éditoriales et performatives détachées du dispositif initial, le groupe Institutions fictionnelles l’a investi complètement… mais seulement. C’est là sa contradiction : aucun projet concret n’a été collégialement adopté, malgré les « protocoles d’actions »Voir la note du 24 mai au second jour de l’événement.
qui ont pu émerger pendant les trois jours de l’événement. Rien de collectif n’est véritablement sorti de notre groupe de travail.
De quoi cet échec est-il le symptôme ? Est-ce l’échec du méta-dispositif de la Publishing Sphere, celui des ateliers en groupe sur trois jours ? Est-ce la chronique d’une inconciliabilité de personnalités, de discours ou de rhétoriques ? Mais surtout, est-ce vraiment un échec ?
Entretenir les lisières : le collectif au défi des singularités
Dans un article proposé dans le cadre du dossier « Écrire les communs. Au-devant de l’irréversible » sur Sens public, Romain Lalande développe la notion de « lisière ». La lisière constitue, dit-il : « un espace de relation entre deux écosystèmes, et dont la caractéristique principale est d’abriter une diversité plus riche que la somme des écosystèmes en présence » (Lalande 2019, sur Hypothesis). Il appelle alors les communautés des communs à entretenir des « lisières » afin de ne pas fonctionner en vase clos et de conserver une relation fertile au monde qui les entoure. Sa réflexion s’appuie à la fois sur sa connaissance de ces communautés, qu’il a pu observer au plus près, et sur l’intuition selon laquelle les communs « ne s’écri[vent] que pour eux-mêmes ». Cette assomption, qui n’a pas fait l’unanimité chez les intéressésUne première version du texte de Romain Lalande, rendue public en pré-publication sur Stylo, a suscité plusieurs réactions sur les réseaux sociaux ainsi que sur le texte lui-même par l’intermédiaire de l’outil Hypothes.is. J’analyse cette conversation et son dispositif en abordant le dossier Écrire les communs.
, révèle un certain paradoxe, tant le mouvement des communs se caractérise, notamment dans ses écritures (Fredriksson et Sauret 2019a), par un principe de partage. La renaissance des communs dans le monde a été favorisée par les travaux d’Elinor Ostrom (1990; 1994), récompensé par le prix Nobel d’économie en 2009. Ostrom a su démontrer par un travail de terrain minutieux que la fameuse « tragédie des communs » théorisée par Garrett Hardin (1968) n’était pas fondée. Au contraire, les communs encore pratiqués dans le monde présentaient de meilleurs résultats en termes de gestion et de durabilité des ressources que les préceptes économiques dominants. Ce qu’on désigne souvent comme un mouvement poursuit depuis un extraordinaire développement tant sur le plan pratique que sur le plan théoriqueLe spectre est large, car il dépasse largement la théorie économique. On pourra citer notamment les travaux de Philippe Aigrain, Michel Bauwens, Christian Laval et Pierre Dardot, David Bollier, Benjamin Coriat, etc.
. Historiquement, les commons, qui régissaient par exemple le partage des pâturages en Angleterre, ont subi les effets des enclosures, consistant à privatiser les ressources jusque-là intuitivement mises en commun au sein de communautés d’usagers. Romain Lalande remarque ainsi que la vigilance presque traumatique des communs vis-à-vis de tout phénomène d’enclosure risque d’amener ses praticiens et ses communautés à se refermer sur eux·elles-mêmes. Si cette remarque peut être discutée en soi, sa proposition théorique est intéressante et peut être généralisée au-delà des communs. Il associe son concept de « lisière » à celle de « créolisation » d’Édouard Glissant, désignant « la mise en relation consciente et inconsciente de deux cultures “valorisées égales ou inégales” », de laquelle résulte une nouvelle culture autonome.
Créolisation et lisières portent un enseignement similaire : la relation rend fertile là où l’entre-soi stérilise. (Lalande 2019, sur Hypothesis)
Lalande appelle ainsi à prendre soin de ces lisières, en « assumant les interdépendances » entre groupes humains. Ces espaces périphériques, ces « marges instituantes », ne sont pas des espaces neutres, mais au contraire des espaces fertiles de diversité, c’est-à-dire où peuvent s’inventer de nouvelles pratiques ou formes de pensée.
En reprenant les propositions théoriques de Romain Lalande, je serais tenté de comprendre l’expérience en partie manquée du groupe Institutions fictionnelles comme la rencontre d’espaces conceptuels et d’espaces de pratique n’ayant pas suffisamment accueilli et entretenu leurs lisières respectives. C’est probablement le cas du PEROU dont la position intellectuelle se manifeste essentiellement sur le mode affirmatif. Le très bel entretien de Sébastien Thiéry par Sylvia FredrikssonVoir la note Republier le monde. Interview de Sébastien Thiéry.
est porteur d’un discours puissant et inspirant. Lorsque, par des écritures dites « instituantes », il retourne la position du migrant ou de l’opprimé, lui redonne la parole, le met à jour, on comprend qu’il y a là un projet politique particulièrement convaincant. Cet entretien est structuré autour d’une longue énumération de verbes venant des champs sémantiques de l’enquête, de l’écrit, de l’instauration, etc. On pourrait synthétiser ces champs dans la double action documenter et inscrire. Pourtant cette longue liste de verbes à l’infinitif sonne aussi comme autant d’injonctions, des injonctions à soi-même sans doute – « voilà notre mission en tant qu’enquêteur-activiste sur le terrain », mais aussi des injonctions à l’autre, celui qui n’est ni migrant ni enquêteur. Ce discours installe finalement une position de supériorité excluante. Là où le PEROU prend soin et fait place à l’opprimé, il lui redonne une visibilité au monde. Mais la démarche se dote d’un tel attirail théorique que le discours accompagnateur finit par mettre en visibilité l’entité soignante elle-même. L’humilité manifeste, consciente et nécessaire de la pratique du PEROU sur le terrain se heurte à la position intellectuelle dominante que le PEROU entretient malgré lui. C’est peut-être cette critique qui a déjà provoqué des points de frictions avec des organisations non-gouvernementales déjà à l’œuvre sur les terrains où est intervenu le PEROU trouver une référence - voir Sylvia ou FrédéricEn l’absence de lisière intellectuelle, d’espace de dialogue et de bienveillance praticienne, le PEROU n’est pas en mesure de s’hybrider avec des initiatives alternatives. L’injonction à l’infinitif est radicale de ce point de vue. Lors de la dernière séance collective de la Publishing Sphere, le groupe Institutions fictionnelles a performé en ordre dispersé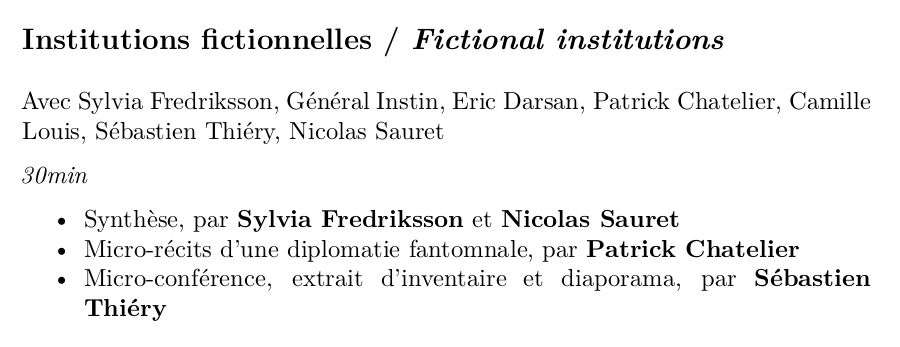 Extrait du programme de la présentation publique Publishing Sphere – 25 mai 2019 (voir en annexe le programme complet)
Extrait du programme de la présentation publique Publishing Sphere – 25 mai 2019 (voir en annexe le programme complet)
. Pour sa part, Sébastien Thiéry s’est lancé dans une longue énumération improvisée de ces infinitifs ayant structuré l’entretien donné quelques heures plus tôt. En performant cette liste, Thiéry les associe, les appuie, joue de leur sémantique et de leur polysémie. Le résultat à nouveau est puissant, troublant tant l’ensemble tend à former un impératif aux accents très politiques. Mais il est aussi autoritaire. Le résultat est là, Sébastien Thiery a performé seul son discours déjà rodé, sans qu’il ait pu l’hybrider d’aucune autre proposition – propositions pourtant abondantes et riches dans ce groupe.
Cette position intellectuelle dominante renvoie à une critique post-coloniale déjà bien connue. Pour mieux comprendre son terrain, à savoir ce moment contemporain artistique et littéraire, Lionel Ruffel tire dans le chapitre « Cyborgs et subalternes » le fil conceptuel des études post-coloniales et féministes. Il invoque notamment le texte largement discuté de Gayatri Spivak « Les subalternes peuvent-elles parler ?», dans lequel l’auteure amène une critique importante du post-structuralisme en faisant l’analyse d’un dialogue entre Foucault et Deleuze. Ruffel réitère la critique et l’interprétation de Spivak : ces intellectuels français, « malgré leurs plus louables efforts, ne sont finalement, selon Spivak, jamais sortis de la trinité Occident - Homme - Histoire ; jamais sortis des contradictions de la modernité et de la postmodernité »(Ruffel 2016, p230). Ruffel reconnait ainsi le « déplacement dans le champ critique » que réussit à faire Spivak, en montrant combien leur approche intellectuelle reproduit l’impérialisme du « mâle blanc dominant »Le terme est de Ruffel, voir par exemple : « La reconstitution historique du postmoderne n’a pourtant, jusqu’à récemment, retenu que le “grand” débat entre mâles blancs dominants. » (Ruffel 2016, p206)
.
Alors qu’on pensait avec Foucault et Deleuze être parvenu au point où, enfin, les opprimé(e)s pourraient, non pas parler, puisqu’ils n’ont jamais cessé de le faire, mais être entendus ; un point où le rôle de l’intellectuel serait de se faire caisse de résonance de ce qui, jusqu’alors, était mis sous silence, Spivak tente de montrer combien cette approche demeure prise dans la représentation d’un sujet unique, les masses, le peuple, les femmes et combien il s’agit d’une position rusée qui reconduit l’impérialisme d’un sujet souverain. (Ruffel 2016, p232)
Cette citation fait évidemment penser à la démarche du PEROU qui cherche à « se faire caisse de résonance de ce qui, jusqu’alors, était mis sous silence », de « donner à entendre les voix inentendues » (Ruffel 2016, p232).
Ruffel utilise cette critique et l’associe à la politique cyborg d’Haraway (Haraway 1985) pour caractériser la contemporanéité qu’il étudie. En « pensant les conditions de la parole » dont « l’usage a été colonisé par une vision de l’histoire et du présent », Haraway et Spivak livrent « une méthode et une politique » (Ruffel 2016, p224). C’est bien le propos de Ruffel avec le brouhaha, dont il montre ainsi que sa pratique relève d’une émancipation politique. Elle est éditoriale parce qu’elle réinvente en effet les formes de mise en public. Mais elle est aussi politique, car elle réinvente les formes d’écriture de l’histoire« L’histoire est désormais un enjeu politique ; l’idée même de parole et d’écriture est à réinventer. Avec l’Histoire, la parole et l’écriture ont été volées, pillées, colonisées, et ce doublement. D’une part, parce qu’elles ont été associées au phallogocentrisme occidental et, d’autre part, parce que ce même phallogocentrisme occidental a instruit une histoire qui définit les populations exclues comme privées d’écriture et de parole propres » (Ruffel 2016, p228)
. C’est en cela que le brouhaha peut inspirer une réflexion radicale sur les formes de production de la connaissance dans le milieu académique. C’est en cela, aussi, que le « faire collectif » esthétique du Général Instin mérite d’être pris en compte dans la position réflexive de l’institution académique sur elle-même.
Le collectif conjugué : invoquer le nous
Fort de nos différentes expériences de co-création et de collaboration, en particulier sur des projets de très court terme de type hackathon, barcamp ou autres, il est nous est apparu assez vite avec Sylvia qu’au-delà d’une communication fluide favorable, le groupe manquait finalement d’un objet à réaliser. Il est probable que la conversation s’en serait mieux sortie si elle s’était ancrée dans un faire, une praxis dont le postulat est une matière, et dont le processus révèle le collectif. Cette révélation du collectif est particulièrement bien amenée par Patrick Chatelier dans sa performance solo, intitulée « Général à vendre » Une enregistrement de « Général à vendre » est disponible sur Remue.net
Une enregistrement de « Général à vendre » est disponible sur Remue.net
. Patrick Chatelier y retrace l’histoire du GI et du collectif Instin, construisant son propos sur une série d’images et de son. En empruntant un texte plus ancien, il Patrick Chatelier lors de sa performance « Général à vendre » (25/05/2019)
Patrick Chatelier lors de sa performance « Général à vendre » (25/05/2019)
déclare :
GI fut résumé ainsi : prendre acte, faire geste ; prendre acte des gestes faits, faire geste des actes pris. Dans une perpétuelle revenance entre moi et nous, intime-extime, réel-fiction, marge-centre.Retranscription d’un extrait de la performance Général à vendre.
Il invente un terme pour l’occasion, le mot instiner, qui semble vouloir désigner l’acte d’éditer, de faire geste d’écriture et d’édition. On comprend dans ce terme que les instiniens sont en fait des instineurs. Ils n’appartiennent pas à une communauté, ils la font. Son interprétation du GI est très claire. Le GI n’est pas un collectif, c’est une « interface » entre les individus qui s’en emparent et le collectif, il est un « mouvement de collectivité des individus » dont la finalité, selon ses termes, est de « faire collectif » Tweet de Servanne Monjour pendant la performance de Patrick Chatelier.
Tweet de Servanne Monjour pendant la performance de Patrick Chatelier.
.
Mais la finalité n’est pas tout. Encore faut-il qu’elle advienne. Car ce “faire collectif”, infinitif de son état, doit encore se conjuguer afin que le collectif s’actualise. En la conjuguant au présent et à la première personne du pluriel, l’injonction devient « nous faisons collectif ». Et voilà que le collectif prend forme. Il prend tout d’abord la forme présente et indicative de « faisons » qui suggère (ou indique) que le collectif est en train d’être fait. C’est ce caractère performatif qui est déjà présent dans la pensée de Patrick Chatelier, mais qui soudain s’éclaire lorsqu’on le conjugue. L’écriture d’Instin est un processus, sa figure en mouvement est un signal continu. Par ailleurs, le collectif prend forme par le pronom « nous », le reliant physiquement à cette « collectivité d’individus », somme d’entités humaines souvent concrètes et parfois fictionnelles.
Dans un chapitre intitulé « Les Noues », Marielle Macé (2018) élabore elle aussi une pensée du collectif et du « nous » qu’elle associe poétiquement à la noue.
Une noue est un fossé herbeux en pente douce, aménagé ou naturel (l’ancien bras mort d’une rivière par exemple), qui recueille les eaux, permet d’en maîtriser le ruissellement ou l’évaporation, de reconstituer les nappes souterraines et de ménager les terres. C’est un abri végétal qui limite la pollution, et s’est mis à protéger des inondations les villages qui y sont continûment exposés[…]. (Macé 2018, p10‑11)
Il y a toute une science des noues, même s’il n’y a pas de code cartographique pour les identifier ; (Macé 2018, p13)
La noue est cet espace inutilisé, non pas inutile, mais laissé là, « ménagé » pour son utilité justement, et selon un savoir-faire qu’on appellerait désormais « patrimoine immatériel ». Dans le soin qu’on y met, à la noue comme à son territoire, Macé entrevoit une certaine mémoire collective de la lutte.
Les noues, les noës comme autant d’arches, arches d’eaux vives et de pratiques, où conserver non pas des choses mais des forces, où faire monter des inquiétudes, des pensées, des combats.
Car les noues se souviennent de destructions et des exploitations, elles font accueil aux luttes, rouvrant ces lits de rivières anciennes « où les eaux tendent à revenir en cas de débordements ».
Ce qui découle des noues en effet déborde. (2018, p15‑16)
Dans ce texte, comme dans le suivant « Nos cabanes », Marielle Macé se fait témoin des luttes « écopolitiques » qui se jouent dans les ZADZones à défendre.
. De ces luttes, émergent des collectifs, des « nous » investissant temporairement des zones, pour se nouer et se dénouer« On y entend que dans le mot « nous » quelque chose (mais quoi au juste ?) se noue, doit se nouer et pourra donc aussi bien se dénouer ; on se dit que « nous » est une affaire de liens, d’arrachements, de mêlements, d’interdépendances et d’attachements, et de démêlements et de dénouements – plutôt que d’appartenance ou d’identification. » (2018, p19)
. L’écriture de Macé se fait sensible, à la mesure d’une pensée politique écologique, capable de réconcilier le collectif et l’individu aussi par un lien d’amour.
On devine que penser et éprouver le « nous » amoureux n’est peut-être pas inutile à une pensée du commun, autrement dit que le « nous deux » d’amour (le « nous deux encore » de Michaux) pourrait, si on l’écoute, s’élargir en collectif, s’infinir en politique. (On se dit d’ailleurs aussi qu’avec les Noues « nous » pourrait se décliner au féminin, pour noues les femmes.) (2018, p19‑20)
L’élargissement du collectif jusque dans l’idéal politique – l’infini, résulte en fait de l’élargissement d’un « je ». C’est dans la dilatation du « moi », dit-elle, qu’advient le « nous » comme « sujet collectif », et non comme une addition de sujets. Ainsi, s’il y a du politique dans le collectif, il intervient non pas dans l’identité (« en es-tu ? »), mais dans le projet, dans « ce que nous pourrons faire si nous nous nouons » (2018, p21). C’est en cela que l’usage du nous et du verbe conjugué me semble ici plus porteur que l’infinitif dont elle va pourtant faire l’éloge dans un cours passage (2018, p40). Elle voit notamment dans l’infinitif « un phrasé général de l’action », ou encore « la forme syntaxique du possible, de la possibilisation des gestes et des choses, à chaque instant déclose ». Elle appuie ici la rhétorique du PEROU avec lequel elle partage manifestement une certaine sensibilité, puisque le texte « Nos Cabanes » y fait plusieurs fois référence. Pourtant c’est bien à la première personne du pluriel que s’établit, dans l’agir, le « sujet collectif ».
Sans doute, les artistes, écrivain·e·s, éditeur·rice·s et passant·e·s du Général Instin se sont noué·e·s par leurs écritures du GI, et se sont chacun élargi·e en ce « sujet collectif », réalisant le « nous », plus précisément le « nous faisons collectif ». Sans doute aussi que les noues sont comme les lisières, zones fertiles où se mêlent et s’hybrident librement les idées :
Cette co-construction, cette contamination, révèle des interdépendances, des imbrications constantes (entre espèces, entre des espèces et des techniques, entre des vivants et des objets, entre des vivants et des morts, entre des modes de vie, entre des soucis divergents, entre des valeurs disparates…) […]. (2018, p53)
Macé emprunte à Anna Tsing le terme de « diversité contaminée » pour rendre compte de ce qui renaît malgré tout d’une terre dévastée. Il est peut-être trop facile de relier cette diversité-là à celle des écritures successives, appropriées, contaminées, qui forment ensemble le GI. Pourtant dans les ZAD, les noues, les lisières ou le Général Instin, c’est bien d’imaginaire qu’il s’agit avant tout. Toutes ces luttes et ces écritures relèvent d’une même écologie de la diversité, soit d’une « multitude » qui suppose « d’imaginer davantage, de connaître davantage, de changer de registre d’abondances et d’élévations » (2018, p49).
L’abondance me semble en effet résonner assez bien avec les autres terrains d’étude, notamment le dispositif ENMI12 ou le Général Instin. L’abondance est celle du fragment, dont la granularité plus fine favorise sa circulation et sa multiplication. Et, pour faire écho à la « diversité contaminée », le fragment multiplié entraîne aussi, au fil de ses réécritures, sa diversification. Celle-ci se joue à deux niveaux. Le premier niveau est celui de l’énonciation éditoriale avec la recontextualisation du fragment dans des espaces d’écriture nouveaux. On parle là de « redocumentarisation »« Redocumentariser, c’est documentariser à nouveau un document ou une collection en permettant à un bénéficiaire de réarticuler les contenus sémiotiques selon son interprétation et ses usages à la fois selon la dimension interne (extraction de morceaux musicaux pour les ré- agencer avec d’autres, ou annotations en marge d’un livre suggérant des parcours de lecture différents…) ou externe (organisation d’une collection, d’une archive, d’un catalogue privé croisant les ressources de différents éditeurs selon une nouvelle logique d’association). » (Zacklad 2007a)
, entraînant effectivement une fabrication de sens. Le second niveau concerne les associations inédites qui en découlent, que ce soit par fragments juxtaposés ou que ce soit par l’ajout d’éléments d’interprétation. La diversification résulte bien de ces combinaisons, qu’elles soient banales, recyclées ou originales. Au croisement de ces lisières, l’enjeu, on l’aura compris, ne réside plus tant dans l’originalité des idées, mais dans leur circulation, processus que j’appellerais d’appropriation par lequel advient le collectif, le « nous », ou encore « nous faisons collectif ».
Le renouveau de la fonction éditoriale
L’une des réalisations du groupe Institutions fictionnelles est un texte à deux voix, récit d’une délégation diplomatique entre humains et non-humains. Le texte premier est imaginé par Patrick Chatelier, dont l’écriture témoigne d’un effort pour intégrer les différents éléments théoriques apportés par chaque participant. C’était une des hypothèses proposées dès la première journée d’atelier :
Créer une Diplomatie fantômnale. Patrick Chatelier. en lien avec l’hypothèse Des fictions ontologiques donneraient naissance à des institutions parasitaires et clandestines Sébastien Thiéry — et les communs latents Anna Tsing (voir prolongementPatrick Chatelier détaille son intention dans une note Prolongements :
« La proposition pour notre groupe est de former une légation humaine qui prendra contact avec une légation de fantômes. L’ensemble formant un corpus diplomatique. […] La première tâche de ces légations sera d’élaborer un langage commun entre eux et nous, de trouver par exemple un équivalent numérique de la transe du chaman (nous devrons donc définir, plus qu’un langage commun, une sphère commune de langage). » (sur Hypothesis)
ci-dessous)
En réponse à la première impulsion donnée par Sylvia Fredriksson, la diplomatie fantômnale de Chatelier articule intelligemment la question de l’institution avec celle des communs, abordés ici sous l’angle des « communs latents » d’Anna TsingFredriksson développe la pensée d’Anna Tsing dans un Glossaire Commun(s) :
« Anna Tsing cherche à “élargir le concept de communs” pour “inclure humains et non-humains en tant que contributeurs à un écosystème”. » (sur Hypothesis)
. Chatelier n’est pas familier de ces deux éléments théoriques que sont l’institution ou les communs, mais semble finalement en avoir l’intuition dans ses réalisations littéraires. C’est en effet sur le plan littéraire qu’il les invoque en imaginant une situation (l’institution fictionnelle d’une diplomatie fantômnale), un cadre d’écriture pour d’autres écritures (« des copublications régulières dans les univers fantômal et humain pour informer les populations de nos pourparlers »), et finalement des rôles à performer (des « traducteurs », « une équipe de recherche », « l’expédition diplomatique proprement dite »). Chatelier invente ici tout un dispositif d’écriture et de publication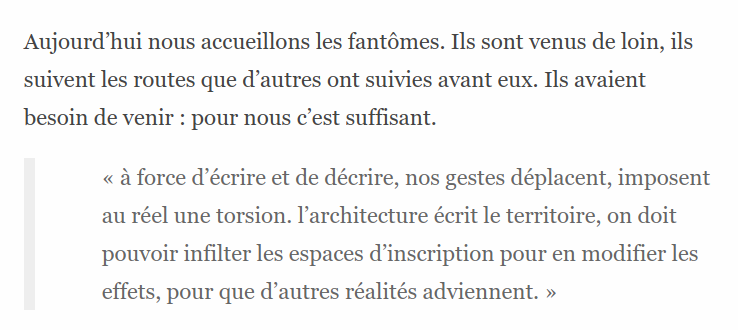
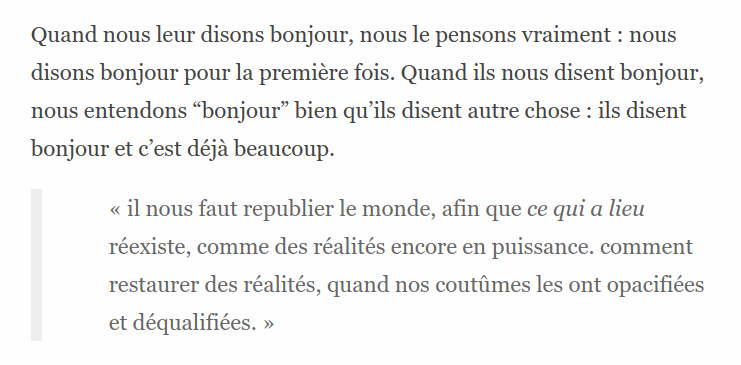
Micro-récits d’une diplomatie fantômnale par Patrick Chatelier (extraits)
. La seconde voix intervient comme un texte enchâssé dans le premier récit, mimant des fragments d’écritures diplomatiques. J’avais repris et travaillé pour cela une série de fausses citations issues des vraies conversations du groupe, la prise de note initiale servant de matériau pour réécrire une série d’aphorismes et de maximes qui teintent le premier récit d’injonctions reformulées de manière dramatique. Chatelier tisse dans cet imaginaire les éléments de conversation du groupe, il hybride sa pratique littéraire avec les concepts des uns, et les institutions fictionnelles des autres. Enrichi des écritures diplomatiques enchâssées, cet imaginaire peut aussi s’appréhender comme une forme de savoir, construite sur les principes du fragment. Aux côtés de la dynamique littéraire, s’élabore une dynamique de connaissances, tant dans l’écriture que dans la lecture, fonctionnant sur l’association d’idées et l’évocation ou l’inspiration de nouvelles idées.
Dans le cadre de la Publishing Sphere de Montréal, Chatelier s’est ainsi installé à la lisière de son espace d’écriture, ouvert à la « contamination ». Cette démarche est en fait caractéristique de la position qu’il a endossé dans le projet Général Instin. Rédacteur en chef du site Remue.net, il se définit sur sa page auteur comme « arpenteur et archiviste du Général Instin »Voir sur http://remue.net/patrick-chatelier.
. Cette formule évoque la pratique anthologique que Doueihi avait identifiée pour caractériser la culture numérique« Que la collecte initiale ait été effectuée par un seul chercheur ou individu ou par un groupe de lecteurs disparates, le modèle anthologique permet de transformer les éléments collectés en publication ouverte et dynamique de savoirs potentiellement nouveaux. » (Doueihi 2011, p70)
. Chatelier en effet collecte, édite et met en ligne sur Remue.net les textes du Général Instin. De cette toile centrale étoilent des productions diverses publiées sur d’autres espaces de création ou d’écriture. La pratique de Chatelier révèle en fait ce qu’on pourrait considérer comme une nouvelle fonction éditoriale propre à cette écriture en mouvement. Le premier aspect pratique de cette fonction consiste concrètement à agréger, éditer et publier des textes et des créations. Mais cela va plus loin, car il tisse entre ces contenus des liens, il structure et organise un espace, exemplifiant la définition théorique de l’éditorialisation« L’éditorialisation désigne l’ensemble des dynamiques qui produisent et structurent l’espace numérique. Ces dynamiques sont les interactions des actions individuelles et collectives avec un environnement numérique particulier. » (Vitali-Rosati 2016, sur Hypothesis)
. Ce processus déploie aussi une dimension écologique lorsque l’espace devient milieu, lorsque l’écriture se fait le terrain d’autres écritures. Chatelier entretient en quelque sorte des lisières propices à l’ouverture, il ménage des noues dans lesquelles un nous peut advenir. Le « faire collectif » énoncé par Chatelier résume bien cette fonction éditoriale dépassant la simple pratique d’édition et de publication pour investir une attention au collectif. Ce rôle et cette fonction ne sont-ils pas transposables aux chercheurs et aux éditeurs scientifiques ?
Lorsque s’y associent les auteurs et contributeurs du GI, « faire collectif » se conjugue à la première personne de l’indicatif : « nous nous approprions le Général » comme figure et objet littéraire. C’est un des aspects de la fonction éditoriale assurée par Chatelier que de rendre le Général public – publié – et appropriable. Le collectif advient réellement lors de ce processus d’appropriation. Or, la nature de l’appropriation diffère ici légèrement de ce que je décrivais à propos des appropriations successives des fragments de ressources dans le cas ENMI12. Les milieux d’écriture en effet ne sont pas de la même nature, le premier consistant en une figure littéraire au long cours, le second consistant en une documentation conversationnelle d’un colloque scientifique. Mais la dynamique relève d’un même geste d’écriture rendu possible par la fonction éditoriale. Dans un cas, cette fonction est assurée par Patrick Chatelier qui collecte, édite et agençe les textes et les productions artistiques sur les différents espaces de publication, en premier lieu Remue.net, comme autant de points d’entrée pour s’emparer du Général. Dans l’autre cas, la fonction éditoriale revient au « dispositif ENMI12 » par lequel se multiplient les « écritures dispositives » comme autant de gestes d’appropriation.
Quel bilan tirer alors de l’échec, tout relatif finalement, du groupe Institutions fictionnelles, et plus largement du dispositif Publishing Sphere ? Il apparaît manifestement nécessaire de renouveler la fonction éditoriale en y réintroduisant d’une part le mouvement et l’appropriation, et d’autre part une certaine contemporanéité que caractérise cette dynamique collective portée par le soin et la bienveillance. Mais alors, de quelle autorité peut bien bénéficier une telle fonction éditoriale ? Et en retour, quelle légitimité construit-elle ? Si l’éditeur doit maintenant apprendre à faire collectif, à promouvoir la diversité et la cohabitation des idées, ou encore à favoriser la « contamination » de la pensée, quel·s modèle·s de gouvernance adopter pour asseoir et construire une légitimité ? J’aborde ces problématiques essentielles dans le prochain cas d’étude au cours duquel j’ai pu expérimenter ce rôle d’éditeur bienveillant pour élaborer un dossier scientifique dans le cadre de la revue Sens public. Ce dossier consacré à l’écriture des communs constitue la dernière expérimentation éditoriale de ce chapitre et a été réalisé sous l’égide de la théorie des communs. En effet, la pratique du commoning et son modèle de gouvernance me permettent de réinvestir la question de la publication académique tout en réalisant la synthèse des conclusions de l’enquête Revue 2.0 et des principes précédents de la conversation et du collectif.
Ouvrir la gourvernance de la publication savante : « Écrire les communs » dans la revue Sens public
Les cas d’études étudiés dans cette partie ont ouvert des pistes d’exploration de la conversation et du collectif à travers différents modèles éditoriaux et au sein de communautés de pratiques parfois éloignées du milieu académique : notamment des écrivains et des artistes. Le cas de l’ouvrage « version 0 » s’appuyait sur l’édition collective d’une monographie, basée sur la mise en conversation de fragments et destinée à l’impression. L’événement Publishing Sphere cherchait à ouvrir le temps de la rencontre de nouveaux espaces publics par l’expérimentation de nouvelles formes d’écriture et de publication. Nous avons vu au travers d’un groupe de travail en particulier comment peut advenir un collectif lorsque celui-ci se conjugue au pluriel de ses subjectivités. Le troisième cas d’étude nous ramène à mon sujet premier, la revue scientifique, au sein de laquelle j’ai pu mener une expérimentation éditoriale inédite portant sur un protocole susceptible de faire collectif. La problématique posée ici rouvre le chantier de réflexion laissé ouvert à la fin de la seconde partie. Sur le mode d’une enquête conversée auprès des éditeurs et éditrices de revues, j’avais pu saisir de quoi est faite une revue scientifique en SHS, quels sont ses processus de décision au-delà des protocoles officiels et, finalement, quelles formes de légitimité elle autorise. En reconnaissant l’omniprésence de la conversation dans ces processus de légitimation, je concluais sur l’opportunité d’imaginer des protocoles éditoriaux laissant toute leur place à la conversation et au collectif. C’est ce que nous avons tenté de faire, avec Sylvia Fredriksson et la revue Sens public, en initiant un dossier de revue, dont le modèle éditorial – une collection d’articles – ne s’est réinventé qu’à la marge, mais dont le processus de fabrication laisse entrevoir pour les revues de SHS un nouvel horizon. Or repenser le processus de fabrication interroge bien entendu le processus de légitimation – largement sécularisé comme en témoigne sa transposition inopportune dans le monde numérique – notamment lorsqu’une telle renaissance suppose la mise en lumière de la fabrique. La remédiation de la revue savante dans l’environnement numérique n’est donc pas seulement l’occasion de remodeler le format, le protocole ou l’écriture. C’est aussi la possibilité de repenser le concept même de la scientificité. La question est éminemment épistémologique comme nous le verrons, car elle remet en cause le rapport entre scientificité et objectivité. Elle aussi certainement institutionnelle, puisque la scientificité ne peut qu’évoluer de concert avec les supports et les formes de communication scientifiques et leur institutionnalisation.
En parallèle à mon travail d’investigation dans le cadre du projet Revue 2.0, je souhaitais mettre en œuvre et tester des pistes pour résoudre certains problèmes relevés lors de mon enquête, notamment en termes de légitimation, d’évaluation, d’écriture. Ainsi, au début du mois de février 2018, je proposais à Sylvia Fredriksson de travailler sur un dossier sur les communs pour la revue Sens public. Nos premières discussions ont rapidement instauré quelques principes et idées directrices pour le projet, dont les implications se révèlent tout à fait porteuses pour le présent travail de recherche. Cette aventure éditoriale est devenue un terrain de recherche en soi s’emparant à bras le corps de la conversation comme forme éditoriale. En premier lieu, nous avons affirmé ensemble l’intention d’« ouvrir des conversations » entre praticiens des communs (les commoners) sur des problématiques déjà débattues dans leur milieu. Le second principe consistait à adopter la pratique des communs pour élaborer ce dossier, considérant qu’on ne pouvait écrire sur les communs sans faire de cette connaissance elle-même un commun. Appliquer une licence Creative Commons à un texte ou à une collection de textes est certes un début, mais cela ne suffit pas à établir un commun. Il s’agissait donc tout d’abord d’ouvrir la gouvernance du dossier à ses contributeurs et d’instaurer une véritable collégialité entre les auteurs et les éditeurs. Je développerai ce point ultérieurement. Enfin, un troisième principe s’est dégagé une fois le processus collectif engagé. Devant les écritures en cours, il nous a semblé essentiel de mobiliser les participants sur une lecture collective des textes en gestation. Nous avons adapté le protocole éditorial de manière publier les articles du dossier en édition continue. Il s’agissait d’ouvrir aux lecteurs la fabrique des textes en rendant accessibles les espaces d’écriture au fur et à mesure de leur production. Publiés alors « au fil de l’eau » en conservant un accès à leurs versions successives, les textes sont venus régulièrement enrichir le dossier depuis son lancement en ligne le 1er mars 2019. Nous verrons comment cette édition continue installe la transparence des processus de légitimation, là où l’édition scientifique tend à les masquer.
L’intention conversationnelle, la gouvernance partagée et l’expérimentation éditoriale ont fait de ce dossier un objet de recherche particulièrement pertinent pour la présente thèse. Je présente dans un premier temps le déroulé de l’expérimentation, le protocole mis en œuvre et les problématiques qui ont pu être discutées au sein du collectif ainsi formé. Je problématiserai ensuite les particularités de l’expérimentation sur le thème de la recherche-action, en montrant notamment la récursivité de l’objet sur lui-même d’une part et sur ma recherche d’autre part. Sur ces bases de réflexion, je tenterai de tirer les enseignements de l’écriture d’un dossier de revue scientifique par une communauté non-académique. Au-delà de la connaissance produite, quelle est la légitimité d’une telle démarche ? Aurait-elle fonctionné en mobilisant une autre communauté de savoirs ? L’institution scientifique peut-elle s’ouvrir à des savoirs dits profanes ? Et dans ce cas, comment concilier ces derniers avec le principe d’objectivité sur lequel s’appuie la légitimité du savoir scientifique ?
Ouvrir le protocole
Treize mois se seront passés entre les premiers échanges en février 2018 et la publication d’une première vague de textes en mars 2019. Le dossier est toujours ouvert à la publication de nouveaux textes ou de nouvelles versions de textes déjà soumis, en accord avec la direction de la revue. Jusqu’à sa publication en mars 2019, on peut décrire le projet en quatre phases, dont les frontières se recouvrent parfois selon le rythme d’écriture des auteurs. Une première phase de réflexion réalisée en binôme avec Sylvia Fredriksson nous amène à définir les contours du dossier. En avril 2019, nous soumettons le projet à la communauté des communs et entamons ainsi une seconde phase d’échange collectif qui va durer tout l’été. Les deux phases suivantes concernent l’écriture et l’édition des articles, allant de pair avec une lecture collective et/ou éditoriale, à différents stades de rédaction des textes. Chacune de ces phases a suscité des débats venant confronter et reconfigurer directement notre problématique.
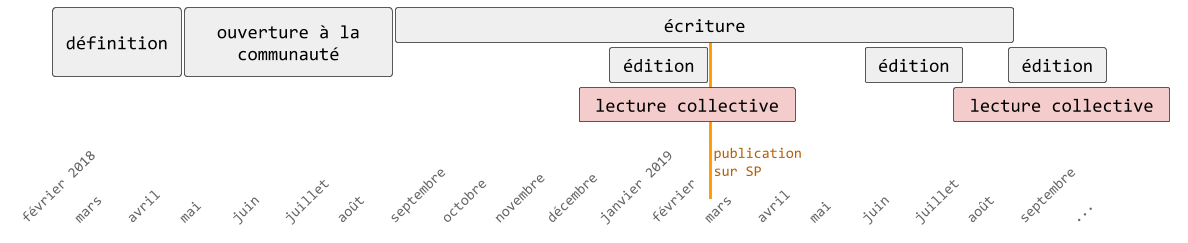
La première phase, correspondant par analogie à la constitution de l’appel à texte, a consisté avec Sylvia Fredriksson à mûrir l’idée initiale : proposer pour la revue Sens public un dossier sur les communs. Nos premières discussions font émerger une thématique plus préciseVoir ci-dessous la partie Écrire sur l’écrit.
et nos réflexions sont reportées sur un pad d’écriture qui deviendra le support de référence pour toute la fabrication du dossier. Ce document en ligne gardera trace de toutes les actions engagées, des brainstorms initiaux à la rédaction des textes-cadres comme la note d’intention ou, en toute fin de projet, le sommaire et l’argumentaire du dossier. Le document est ouvert par défaut, en conséquence de quoi toute personne accédant au document par son URL peut l’éditer ou l’annoter. Il s’agit donc d’une première entorse au protocole traditionnel, qui s’efforce de masquer cet aspect de la fabrique éditoriale. Là où l’appel apparaît généralement comme le point de départ d’un dossier, nous avons souhaité l’ouvrir dans le temps et à la collégialité. L’éditorialisation de nos éléments de réflexion et d’organisation dans un espace d’écriture libre a laissé transparaître le processus lui-même. C’est ainsi que fin avril 2018, nous diffusons sur la liste de diffusion EchangesLa liste de diffusion Echanges@biencommuns.org est la « Liste du réseau francophone autour des biens communs ». Elle compte environ 600 abonnés.
un appel à participation pour une première réunion téléphonique avec comme objectifs :
- affiner la thématique
- identifier des contributeurs
- définir un mode de collaboration original pour un dossier qui se voudra être aussi un commun.Voir en annexe le courriel Appel en commun, 17 avril 2018.
Dans ce message nous partageons aussi l’URL du document-cadre qui comprend une première note d’intentionVoir en annexe la version du 26 avril 2018 du pad, ou republiée dans le sommaire du dossier sur Sens public (Fredriksson et Sauret 2019b, voir « Note d’intention initiale (juin 2018) »).
qui servira de support à de futures discussions. À ce stade, tout reste encore à définir. L’appel est une invitation à s’emparer collectivement d’un projet éditorial, et entame le début de la seconde phase du projet, marquée par une série de rencontres téléphoniques où seront discutés plusieurs aspects du dossier.
Les premières rencontres servent à présenter le projet et à prendre le pouls des participants.
Les participants peuvent :
- participer au groupe de pilotage de ce numéro de la revue
- proposer des contributeurs éventuels
- et/ou proposer des contributions
- participer au comité de lecture et d’évaluation
- …
Objectifs de cette réunion, et des suivantes :
- travailler, affiner le champ du dossier
- agrandir la liste des contributeurs à solliciter (on se donne une limite ?)
- signaler/identifier des modes/formes d’écriture déjà expérimenté.e.s au sein de la communauté (et voir comment cela s’inscrit dans les catégories de la revue: essai, chronique, entretien, création)
- cibler ces formes en fonction des contributeurs qui seront sollicités
- définir un fonctionnement pour la relecture et l’évaluation : évaluation ouverte, cycle de réécriture.s, etc.
Inclusion des participants dans les courriels d’invitation
Nous décidons d’une réunion hebdomadaire pour donner une dynamique au projet, ouvrons un espace de contribution (à travers des pads partagés), nous constituons rapidement un comité de pilotage, un comité de lecture, identifions des contributions potentielles – soit des auteur·e·s, soit des sujets précis à aborder, et travaillons finalement à un appel ouvert à contribution sur la base de la note d’intention initiale. Pendant cette phase, les participants vont et viennent, ils sont parfois sollicités directement par courriel, tout repose sur le volontariat. Comme dans tout projet participatif, on pourra rapidement identifier différents degrés d’engagement. Au total, une vingtaine de personnes se manifestent et participent de près ou de loin au projet et/ou à son écriture, formant un cercle qui s’agrandira progressivement avec de nouveaux contributeurs et contributrices, tandis qu’une dizaine de contributions potentielles sont identifiéesÀ ce jour, six propositions ont abouti à une publication ; voir le sommaire sur Sens public.
.
Les échanges menés lors de cette seconde phase, qui correspond approximativement à l’été 2018, sont surtout l’occasion de questionner directement le dossier dans son positionnement et ses objectifs. Plusieurs participant·e·s sont en effet des praticien·ne·s des communs, engagé·e·s sur le terrain, et la première préoccupation qu’il·elle·s expriment est de savoir à qui s’adressera ce dossier, et dans quelle mesure il sera utile à la communauté des communs. Cette inquiétude, légitime par ailleurs, nous donne un indice sur les motivations poursuivies par les commoners réintroduire plus haut en reprenant le concept dans la partie gouvernance quant à leurs écrits. Le concept de « réciprocité » se trouve être en pleine gestation à ce moment-là dans la communauté des communs. Pour répondre à des situations de captation des communs, la communauté réfléchit à l’époque à des mécanismes de réciprocité, permettant à des acteurs extérieurs de bénéficier d’un commun et d’offrir en échange au commun ou à la société en général une forme de rétribution. Plusieurs initiatives s’emploient ainsi à concevoir une licence à réciprocité efficaceJe renvoie au post du blog S.I.Lex de Lionel Maurel décrivant, selon les initiatives, les différentes philosophies sous-jacentes aux notions de « réciprocité organique », « réciprocité en acte », « réciprocité institutionnelle » ou « réciprocité interne-externe » (Maurel 2018).
, dont le geste juridique consiste autant à protéger les communs des enclosures qu’à proposer des solutions juridiques pour connecter un commun à un marché ou à une zone d’activités et d’échanges plus large que sa seule communauté. Nicolas Loubet suggérera très tôt de penser une réciprocité entre la revue Sens public et les contributeurs au dossier. L’idée n’ira pas plus loin, mais la question initiale, encore non tout à fait résolue, reste pertinente : à qui s’adresse ce dossier, et peut-il profiter à la communauté des communs ? De cette inquiétude transparait en filigrane une certaine méfiance à l’égard de l’écrit scientifique, jugé déconnecté du terrain, et dont les praticiens ne peuvent s’approprier le discours théorique.
À ce propos, Lionel Maurel livre dans un courriel une réaction précieuse à la note d’intention initialeLa note a été republiée telle quelle dans le sommaire du dossier (Fredriksson et Sauret 2019b, voir « Note d’intention initiale (juin 2018) »), et est également accessible en annexe [Version du 26 avril 2018].
. Il pointe en premier lieu le pouvoir que confère la maîtrise de l’écrit, y compris dans les communautés pourtant soucieuses d’horizontalité :
J’ai souvent pensé que c’était un lieu où des pouvoirs s’exercent et je suis bien placé pour en parler, car j’ai une certaine faculté à écrire et que cela m’a toujours donné une place à part dans les collectifs par lesquels je suis passé (au point de parfois me sentir mal à l’aise, car c’est aussi une manière d’accaparer un certain pouvoir par la capabilité).
Il y aurait d’ailleurs grand intérêt à relier cette question de l’écriture dans les Communs avec les “Communs de capabilités” de Geneviève Fontaine, car en général, l’accès aux fonctions les plus élevées de gouvernance dans un collectif est lié à la maîtrise des capabilités d’écriture et cela peut constituer un vrai frein à la contribution.
Maurel met en garde par ailleurs sur le risque d’« enclosure académique des Communs », et nous invite à ne pas perdre de vue la spécificité de la production de connaissances par les commoners, en tension avec la connaissance scientifique.
Je pense aussi à une autre question importante : depuis quelques années, il y a une véritable prolifération des écrits académiques sur les Communs. Je fréquente d’ailleurs de plus en plus ces chercheurs sur les Communs, sans être vraiment l’un des leurs. Parfois, cela me donne un sentiment de malaise, car jusqu’à présent, les gens qui écrivaient sur les Communs étaient aussi profondément des commoners : des personnes comme Hervé le Crosnier ou Valérie Peugeot. C’est en train de changer et je me demande si cela ne va pas déboucher sur une sorte “d’enclosure académique des Communs” si l’on y prend pas garde.
C’est un vrai point d’attention à garder : il y a une “tension épistémologique” intrinsèque dans le monde des Communs, car les commoners produisent leur propre connaissance d’eux-mêmes et le statut de cette connaissance auto-produite est difficile à articuler avec la connaissance produite “de l’extérieur” par les chercheurs. C’est la raison pour laquelle je pense qu’on ne peut pas produire de la connaissance sur les Communs comme sur n’importe quel objet.Voir en annexe le courriel Revue Sens Public - Dossier sur les communs (Parution dec. 2018).
Cet aspect me semble essentiel pour défendre l’hypothèse que je poursuis, cherchant justement à répondre à une telle inquiétude. Il était bien question pour Sylvia et moi-même de faire produire un dossier sur les communs par les acteurs des communs, et de témoigner ainsi que d’autres écritures sont à même de produire des connaissances. Un des enjeux sous-jacents à l’accueil de formes d’écriture alternatives au sein d’une publication institutionnelleBien entendu, il convient de nuancer cette tentative tant la revue Sens public s’est toujours positionnée hors de l’institution, et est restée tout au long de sa période la plus institutionnelle (2012-2020) un véritable terrain d’expérimentation.
aura été de tester la capacité de « l’institution » à s’ouvrir à d’autres savoirs, qu’ils soient des savoirs citoyens, des savoirs de praticiens, voire du patrimoine immatériel, tel que l’Unesco semble classer les savoirs et pratiques ancestrales.
Autoriser et s’autoriser : la réciprocité dans la fonction éditoriale
Une autre question va revenir dans les discussions, notamment de la part des contributeurs et des contributrices sur le point de s’engager dans l’écriture. Plusieurs s’interrogent sur le format du texte qu’il·elle·s doivent produire. Quelle longueur, quel ton ou positionnement, quel niveau de rigueur est attendu ? Pour ces contributeurs et contributrices déjà habitué·e·s à écrire et à publier sur différents espaces de publication pour leur communauté, ces inquiétudes relèvent de la légitimité à écrire dans une revue identifiée comme scientifique. Convaincre des praticiens de publier dans une revue scientifique, aussi libre soit-elle par rapport à l’institution, ne sera pas allée de soi. Quand bien même leur travail se trouvait conforté par la collégialité des pairs, le passage à la revue constituait pour eux·elles un espace non-familier pour lequel il a fallu rassurer. Il y a sans doute là une limite, que l’on retrouve dans l’autocensure de la part des jeunes chercheurs, sur laquelle les revues doivent évoluer. Un des objectifs de l’expérimentation éditoriale consistait à ouvrir l’espace d’écriture et de publication à des individus non académiques. Il aura fallu pour cela assurer les contributeurs et les contributrices de leur légitimité, maintenir leur liberté d’écriture, parfois malgré eux. En tant que porteurs du projet, au regard des doutes émis lors des rencontres téléphoniques, nous avons hésité à cadrer les contributions par une formalisation dans laquelle les contributeurs pourraient s’inscrire, ou bien au contraire laisser le champ libre, quitte à proposer un accompagnement éditorial pour finaliser le texte. La seconde solution a ainsi été choisie.
Cette inquiétude du format et de la légitimité est particulièrement prégnante pour le texte signé par Nicolas Belett Vigneron, Émilie Picton, Sébastien Beyou et Xavier Coadic. Les auteur·e·s ont plusieurs fois manifesté un certain malaise à prendre la parole dans l’espace d’une revue. Cela transparait dans l’avant-propos du texte publié, évoquant « un positionnement conceptuel incertain » (Vigneron et al. 2019), s’excusant d’une interdisciplinarité pourtant très à proposNous choisissons de ne pas travailler sur « une seule science », car par notre réalité sociale, nous sommes une mosaïque de disciplines différentes qui ne se reconnaissent même pas toujours entre elles quand nous regardons le même problème, notre langage étant souvent si différent, et les scopes, réglés si différemment. (Vigneron et al. 2019, sur Hypothesis)
– qu’il·elle·s qualifieront d’« antidisciplinarité », ou encore insistant comme pour mieux les assumer sur « nos vécus et subjectivités » comme point de départ, censés justifier des « caractéristiques […] vagues et non soutenues par des bases de données triées » ou l’absence de « définition stable et de consensus accepté ». Ces précautions oratoires en début de texte pour se démarquer d’une rigueur scientifique est certes une marque de modestie, mais elle me rend très mal à l’aise en tant qu’éditeurJ’ai d’ailleurs réagi à cet avant-propos dans une annotation invitant les auteur·e·s à « assumer cette position de praticiens, d’auto-observation, d’auto-analyse, puisque tout le dossier est construit ainsi » ; voir sur Hypothesis.
. Qu’est-ce qu’une revue si son espace d’écriture et de publication n’a de public (adj.) que sa lecture ? Pourquoi la société civile n’aurait-elle pas voix au chapitre pour transmettre et diffuser elle aussi ses savoirs ? Y aurait-il une hiérarchie dans les savoirs ? A posteriori, en reprenant ma casquette de chercheur-observateur de l’expérimentation, l’inquiétude quant au format et à la légitimité d’écrire, témoigne d’une part de la distance problématique qui s’est installée entre le monde universitaire et le monde « profane », et pointe d’autre part une première fissure dans la démarche entreprise dans ce dossier. Car malgré les bonnes volontés des participants engagés, les riches discussions sur les modalités de publications, le positionnement vis-à-vis de la communauté des communs ou sur les inquiétudes face à une académisation des communs, le fait est que les contributeurs n’ont pas su, ou n’ont pas pu, s’emparer pleinement du dossier. La gouvernance du dossier est bien restée ouverte et transparente, comme en témoigne la série de courriels collectifs ou individuels envoyés aux différents participant·e·s, mais elle est largement retombée dans les mains de ses initiateurs. Outre la gouvernance, c’est également le moteur collectif qui n’a pas réellement fonctionné sur le plan de la dynamique. Sylvia et moi-même en sommes restés les porteurs.
Cet échec initial peut nous amener à tirer quelques conclusions. D’une part il n’est pas si étonnant qu’une telle aventure éditoriale reste le fait d’une poignée d’individus moteurs. Cela semble d’ailleurs être une constante dans les projets soutenus par le bénévolat, dont le succès se mesure davantage par le nombre de micro-contributions que par leur ampleur. L’horizontalité de l’action et de la décision, lorsque celles-ci ne sont pas strictement soumises au collectif par une charte ou un règlement, reviendra le plus souvent à quelques individus moteurs. Ce qui n’enlève rien par ailleurs au caractère collectif d’un processus si celui-ci poursuit sincèrement l’effort d’horizontalité. D’autre part, et c’est sans doute la véritable leçon de notre expérimentation, la fonction de l’éditeur demeure essentielle, en particulier dans des situations de co-écritures.
C’est ce qui a caractérisé la suite du processus éditorial dans les deux dernières phases du projet : l’écriture et l’édition des textes. Devant le succès mitigé des dernières réunions téléphoniques (peu ou pas de participants), notre action s’est redéployée vers des échanges individuels ou en petits groupes. Ces communications, par courriel ou par vidéoconférence, consistaient à discuter très concrètement avec les différents contributeurs et contributrices de leur texte en gestation. On retrouve ici la fonction classique de l’éditeur, fonction que notre protocole éditorial a su distribuer auprès des contributeurs et contributrices les plus engagé·e·s, souvent eux·elles-mêmes auteur·e·s. Pour ceux-là, nous avions proposé un protocole éditorial aussi libre possible, aussi bien en termes de supports d’écriture qu’en termes d’ouverture du texte. Certains ont pu partager des versions plus abouties de leur texte, lorsque d’autres rédigeaient sur des pads d’écriture collaborative, selon les pratiques ou les dispositions personnelles à rendre public un travail en cours. Le pad général partagé fin juin à tous les participants contactés a centralisé tout au long du processus l’ensemble des informations et des actions menées dans le cadre du projet. Nous y tenions à jour la liste des textes en cours de rédaction, les versions successives et les liens pour y accéder.
Cet accompagnement ciblé des auteur·e·s a pleinement porté ses fruits et plusieurs textes en rédaction pendant l’automne ont pu faire l’objet, au début de l’hiver, d’une première lecture. C’est dans cette troisième phase qu’est véritablement advenu le collectif.
Avec une première liste de textes prêts à la lecture, notre rôle a consisté à mobiliser des groupes de lecture autour des textes, en ciblant les personnes susceptibles d’interagir avec eux. Plusieurs discussions téléphoniques ont eu lieu, avec les porteur·e·s du projet et/ou entre auteur·e·s devenu·e·s lecteur·rice. D’autres textes ont suscité des conversations, sur les réseaux sociaux et dans les marges des textes en utilisant la plateforme Hypothesis. À ce propos, l’outil Stylo, développé par la CRC sur les écritures numériques, est arrivé à point nommé. En effet, ce dossier sur les communs aura été la première utilisation extensive des fonctionnalités de preview et d’annotation de la plateforme Stylo tout juste rendue publique dans une version bêtaLa plateforme Stylo a été mise en production et présentée lors du colloque ECRIDIL, en avril 2018. Chaque version des documents Stylo est accessible dans un format HTML outillé de l’annotateur Hypothes.is, et partageable par une simple URL.
. De ce point de vue, ce dossier a constitué une preuve de concept plausible pour homologuer l’un des objectifs visés par l’outil en contexte d’édition scientifique, à savoir l’évaluation ouverte et la conversation comme modalités de validation et de légitimation des articles de revue. Un ingrédient de ce succès a été l’articulation entre un protocole éditorial et l’outil d’édition numérique. Stylo s’est révélé particulièrement pertinent dans la mesure où ses concepteurs n’ont pas prédéfini d’usage ou de protocole particulier, mais ont pensé des fonctionnalités pouvant s’adapter à différentes pratiques éditoriales. Stylo est à la fois un outil de rédaction (écriture du texte), et un outil d’édition (production du document), couvrant ainsi les différentes étapes éditoriales d’un article jusqu’à sa publication. La généricité de l’outil est un atout essentiel pour explorer librement de nouvelles modalités d’écriture, d’édition et de lecture.
La conversation vertueuse au service du devenir texte
Le dossier s’est progressivement enrichi de nouveaux textes et de versions successivesUn texte a été publié l’été 2019, deux autres à l’automne 2019, et plusieurs sont en gestation.
. Mais un article en particulier a fait l’objet d’une conversation vertueuse, bénéficiant des différents échanges qu’il a suscités. Le cycle de vie de l’article de Romain Lalande met en évidence la portée d’un protocole éditorial ouvert au collectif. Jamais complètement formalisé, ce protocole était adapté selon les textes ou la pratique de leur·s auteur·e·s. Dans un courriel aux auteur·e·s du texte « Communs, outils numériques et diversité du « mouvement » : Enquête sur la liste de diffusion Échanges » (Eynaud et Sultan 2019), nous avions proposé le protocole suivant, représentatif du fonctionnement adopté pour la plupart des articles du dossier :
- 1ere version du manuscrit
- passage sur l’outil Stylo > édition rapide pour preview et annotation […]
- lecture et annotation par les contributeurs du dossier. On pourrait aussi annoncer le document de travail sur le sommaire publié du dossier, si vous êtes partant pour rendre publique un work-in-progress
- 2eme version (ou plus selon la teneur des discussions)
- quand vous êtes prêts, la revue Sens public prend en charge une révision linguistique + édition
- après votre validation, publication sur le site de la revue
Protocole éditorial soumis aux auteur·e·s.Voir le courriel du 30 janvier 2019 en annexe le courriel Gmail - 28a-[Sens public] Appel à conversation.html.
Le texte de Romain Lalande a quant à lui connu deux versions majeures. La première, rédigée à l’automne 2018 et intitulée « Les récits des Communs se nourrissent d’ailleurs. De l’importance de cultiver nos lisières », fait l’objet d’une première série d’annotations, de la part d’une contributrice au dossier. Cette lecture critique fait suite à l’appel à une lecture collective en décembre 2018 des deux premiers articles en cours d’écriture.
Cet appel, cité ci-dessous, témoigne de notre souci en tant que porteurs du dossier d’acter son changement de régime, tout en préservant l’ouverture de la gouvernance si le besoin s’en faisait sentir. À ce stade en effet, le comité de pilotage se réduisait aux seuls initiateurs. Ainsi, à défaut (et à regret) d’une gouvernance réellement collégiale, nous avons cherché à maintenir la collégialité (et le collectif) par la conversation.
Le dossier sur les communs en train de s’écrire avance bien. Plusieurs contributions entrent en phase de relecture.
Dans ce cadre, nous vous sollicitons pour ouvrir une conversation autour de deux contributions. Cette conversation pourra se dérouler en deux temps: 1) un temps de lecture et d’annotation collective, 2) un temps de rencontre en visioconf pour aborder les différentes problématiques des textes. Il s’agira de mettre en résonance vos propres pratiques, analyses et recherches, ainsi que votre contribution au dossier pour certains d’entre vous.
Ces conversations participent de la gouvernance partagée du dossier, et nous sommes preneurs de vos suggestions pour ré-intégrer les échanges à venir (synchrones comme asynchrones) dans le dossier lui-même. L’enjeu est de rendre compte de la dynamique du dossier, et de la manière dont les contributions se font échos.
Extrait de l’appel à conversationVoir en annexe le courriel du 7 décembre 2018 Gmail - 28a-[Sens public] Appel à conversation.html.
Le texte de Romain Lalande est soumis pendant l’hiver 2019 à une seconde annotation critique de la part des deux porteurs, en prévision d’une sortie officielle du dossier le 1er mars 2019. N’étant pas en mesure de retravailler son texte avant la publication du dossier, le texte sera publié dans une version en édition continue. Cela constitue une particularité du dossier constitutive de notre expérimentation éditoriale. Dès le mois de septembre précédent, nous avions validé avec la direction de la revue la possibilité de publier un dossier au fil de l’eau composé de textes finalisés publiés sur le site de la revue, ainsi que de textes sous forme de preprint pourrait-on dire, c’est-à-dire encore en rédaction. Ces textes ne sont pas publiés sur le site, mais présents au sommaire et rendus accessibles dans une version HTML de prévisualisation sur la plateforme Stylo. La publication en édition continue est une première pour la revue et marque une différence nette avec la publication traditionnelle. En particulier, l’externalisation d’un contenu vers une autre plateforme sous un format spécifique démontre une ouverture de l’espace de la revue. Cette dernière s’est ainsi étendue et a ruisselé hors de l’espace restreint du site où on l’attend. Cette ouverture éclate l’objet revue et la finitude de son interface, et matérialise la revue comme un réseau de documents et d’individus. Bien entendu, les lieux de l’archipel ainsi formé dialoguent entre eux, inaugurant une nouvelle conversation. D’un point de vue théorique, cette évolution éditoriale n’est pas anodine, car elle inscrit le dossier et ses articles dans la théorie de l’éditorialisation définie par Marcello Vitali-Rosati, et met en évidence ses natures processuelle et performative (2018, 68 et p.70).
Cet aspect est particulièrement bien orchestré par la maison d’édition Abrüpt dont les ouvrages existent de manière concomitante dans différents formats et sur différentes plateformes. Abrüpt et ses antilivres ont notamment largement investi la plateforme Gitlab sur laquelle est déposé et maintenu l’ensemble de ses sites. À vrai dire, Gitlab et le protocole git ne sont pas ici simplement exploités comme espace de maintenance et de déploiement de code, il s’agit d’une véritable éditorialisation des ouvrages, correspondant à une démarche éditoriale avancée consistant à faire exister chacun des livres – ou antilivres – dans son milieu d’écriture et d’édition. L’espace de fabrique est donc ici aussi publié et constitue le lieu même de vie de l’ouvrage. todo: illustrer en note
Publié le 1er 2019, le sommaire du dossier s’accompagne à nouveau d’un « appel à conversation » que nous relayons par courriel aux participants du projet, ainsi que sur la liste ÉchangesVoir le message dans les archives de la liste. Écrire les communs se veut avant tout un appel à poursuivre les conversations qui ont accompagné l’élaboration collective de ce dossier.
. Le texte de Romain Lalande génère plusieurs réactions sur les réseaux sociaux, puis dans ses marges sur la plateforme Stylo Tweet de Calimaq (alias Lionel Maurel) 2 mars 2019
Tweet de Calimaq (alias Lionel Maurel) 2 mars 2019
. S’ensuivent des échanges entre commoners et l’auteur, qui aboutiront à une réécriture conséquente de l’article, finalement publié dans sa version finale courant de l’été 2019. Cette conversation est marquée par un « profond désaccord » Tweet de Calimaq (alias Lionel Maurel) 2 mars 2019
Tweet de Calimaq (alias Lionel Maurel) 2 mars 2019
de certains commoners avec les arguments de Romain Lalande. Dans cet article déjà discuté précédemment, ce dernier exprime son malaise face au discours avançant que « les Communs ont un enseignement plus transversal que les autres à apporter aux autres mouvements »Voir sur Hypothesis.
. Il invite ainsi les Communs à ouvrir encore davantage leurs connaissances. Entre décembre 2019 et mars 2020, les annotations apportées au texte révèlent la diversité des modes de contribution possibles sur un texte ouvert à la lecture constructive. Les commentaires vont discuter d’une notion, apporter une critique, suggérer des nuances, enrichir les idées de références, questionner l’auteur et ouvrir une problématique, relier la controverse à d’autres, plus anciennes, contre-argumenter, parfois longuementVoir sur Hypothesis.
. L’auteur est notamment bousculé par Lionel Maurel, une figure éminente du mouvement des communs en France, dont les arguments sont, il est vrai, peu négociables.
Maurel déconstruit un certain nombre d’approximations, en montrant que la réalité, soit théoriquePar exemple : « C’est le principe même des Communs d’être capable de différencier les “bons” des “mauvais” usages. Ostrom explique que les Communs constituent une réponse institutionnelle au problème des “passagers clandestins” (free riders) et que la capacité d’un Commun à durer dans le temps dépend de la faculté du groupe à qualifier les usages abusifs, à fixer des règles pour les prévenir, à exercer une surveillance, appliquer des sanctions graduées et in fine exclure les contrevenants du groupe. C’est la raison pour laquelle Ostrom fait figurer le “droit d’exclure” comme un des éléments centraux du “faisceau de droits” liés à la gestion des Communs (Bundle of Rights). Cela n’exclut pas la “bienveillance” dont tu parles, mais sans postuler que tous les utilisateurs seront nécessairement bienveillants. Sinon, à quoi servirait le dispositif institutionnel ? » – Maurel sur Hypothesis
, soit des pratiquesPar exemple : « Peut-on dire que CoopCycle, qui utilise une licence à réciprocité pour son logiciel, exerce une domination semblable à celle d’Uber Eats ou Deliveroo ? Est-ce que l’on a vraiment envie de tout rarement sur un même plan où tout se confond et où aucun jugement de valeur ne peut plus être porté ? » – Maurel sur Hypothesis
, n’est pas aussi tranchée que celle énoncée par Lalande. Les arguments de Maurel sont fermes, mais constructifs, ouvrant la voie à l’inflexion des propos de Lalande. La transparence de la conversation offerte par la publication en continu et le dispositif d’annotation invite à une rhétorique d’échanges vertueuse.
À ce moment-là, Lalande ne s’engage pas dans la conversation en cours, mais il entreprend une réécriture conséquente de l’articleVoir en annexe la comparaison (git diff) des deux versions
, dont la revue publiera une seconde version intitulée « Des outils à la trace : vers des communs créolisés qui habitent le monde ? », finalisée en juillet 2019. L’article sortira du processus plus nuancé et mieux argumenté. Ce qui s’est passé pour ce texte pourrait ressembler à ce qu’on appelle dans l’édition classique une révision majeure, requise généralement par l’éditeur et/ou un évaluateur lors du processus de validation. Pourtant le processus implémenté pour ce dossier va plus loin et renverse le paradigme de validation. Celle-ci passe en effet d’une évaluation « aveugle » en coulisse, à une lecture transparente et donc collective. La mobilisation de chacun des acteurs engage une dynamique d’intelligence collective vertueuse sur le plan de la connaissance, mais aussi sur le plan du collectif.
D’un côté, l’autorité du texte se voit distribuée dans les mains d’un collectif de lecteurs. Bien que les niveaux de lecture et d’apport critique ne soient pas homogènes, la diversité des regards quadrille le texte sous des angles multiples auxquels un seul regard, aussi savant soit-il, ne saurait prétendre. Alors que, traditionnellement, la rigueur est associée de fait à l’épistémologie scientifique en tant qu’elle est performée lors du processus éditorial comme attribut de la légitimation d’un texte, elle émane ici de la multiplicité et de la diversité. De ce point de vue, le cas du texte de Lalande atteste l’hypothèse d’une édition scientifique s’accommodant d’un modèle conversationnel, basé sur l’édition continue et la lecture collective des versions successives.
Par ailleurs, sur le plan du collectif, le processus éditorial du dossier favorise la cohésion de collectif, renforcée dans le débat d’idées ou dans la création de passerelles individuelles nouvelles. Il rejoint en cela la pratique du commoning dans laquelle sont engagé·e·s les différents contributeurs et contributrices. Un tel croisement des subjectivités induit le dialogue et la conversation, avec pour effet de virtualiser le collectif. Enfin, comme je vais le développer plus tard, le déplacement épistémologique – multiplicité et diversité comme virtualisation de la légitimité – laisse également entrevoir une réintroduction du politique dans la production de connaissance.
Quatrième phase : édition/ échanges réviseur·euse-auteur·e
Pour explorer ce déplacement épistémologique et politique, je dois à présent revenir sur la thématique du dossier et la communauté de savoir concernée.
Écrire sur l’écrit
La problématique qui s’est dégagée de nos premiers échanges avec Sylvia Fredriksson consistait à interroger les praticiens des communs sur leurs pratiques d’écriture. Les observateurs et les praticiens du mouvement notent en effet à ce moment-là un certain tournant politique et juridique, passant par une intensification du passage à l’écrit et à la publication, qui donna le titre de notre note d’intention : « Les communs en train de s’écrire comme force politique ». Nous y faisions le constat suivant :
Les communautés des communs sont engagées depuis quelques années dans un processus d’écriture et de documentation qui témoigne d’une certaine forme de politisation des communs. Que ce soit les écrits scientifiques, les wikis communautaires, ou encore l’émergence de médias dédiés aux communs, les communs traversent ce moment particulier où la pensée et les principes des communs, après s’être incarnés dans un premier temps dans le commoning (la pratique des communs), cherchent aujourd’hui à s’incarner dans l’écriture et sa publication. (Fredriksson et Sauret 2019b, extrait de la note d’intention, sur Hypothesis)
En appelant ces communautés à (d)écrire comment elles-mêmes s’écrivent, c’est-à-dire à montrer comment elles documentent et transmettent leurs méthodes, leurs débats et leurs procédures, le dossier, en tant que production scripturale, revêt une première dimension récursive. Outre l’auto-documentation, l’écriture des communs investit aussi le champ juridique avec l’établissement de chartes et de règles de fonctionnement, comme les « dispositifs d’encadrement de la collaboration entre les citoyens et leur municipalité ». Ces écritures sont souvent collectives, marquées par une recherche de consensus, par exemple lorsqu’elles actent l’issue de négociations sur la gestion commune d’une ressource. Plus récemment, on peut aussi penser à l’écriture collective d’un cahier de propositions à destination des équipes électorales et des électeurs pour les élections municipales de 2020 en FranceVoir le « Cahier de propositions en contexte municipal » sur le site politiquesdescommuns.cc.
. Deux ans après la note d’intention du dossier, cette dernière démarche témoigne bien de l’engagement politique naissant au sein des communautés des communs. La politisation des communs ne se traduit pas pour autant par une force politique active, mais par l’élaboration d’un discours de plus en plus public (au sens « élargi » au-delà de la communauté active elle-même). Cet investissement de l’espace public passe naturellement par des actes de publication. Ce dossier de revue sur « les communs en train de s’écrire » requérait de la part des commoners sollicités un effort réflexif supplémentaire consistant, en plus de s’écrire pour rendre public leurs pratiques, à se questionner sur ces mêmes pratiques d’écriture. Le dispositif auto-réflexif du dossier, de par sa thématique et son protocole éditorial, a fonctionné en quelque sorte comme une mise en abîme du processus d’écriture des communs engagé par ses communautés. Il était essentiel de ce point de vue d’adapter en conséquence le protocole du dossier, de manière à ne pas le déraciner de son terrain, et de l’incorporer – ou l’inscrire – au mieux dans ses pratiques d’écriture collective. C’est dans ce sens que nous avons voulu faire de ce dossier un commun, appliquant à nous-mêmes et à notre démarche la pratique du commoning.
Il est important de noter la position particulière que j’ai été amené à adopter pour ce cas d’étude, en revêtant une double casquette. La première était celle d’éditeur de revue, impliqué autant sur le plan éditorial que scientifique dans la direction d’un dossier de revue. Dans ce rôle assumé en collaboration avec Sylvia Fredriksson, notre objectif scientifique consistait à proposer un éclairage sur les pratiques d’écriture au sein des communautés des communs. Ma seconde casquette était celle du chercheur engagé dans une réflexion sur les formes alternatives d’écriture – alternatives aux écritures académiques, sur le modèle éditorial conversationnel, et à travers ces formes sur l’hypothèse d’un « faire collectif ». En tant que chercheur, j’ai pu me faire designer et observateur de l’expérimentation éditoriale menée en tant qu’éditeur.
La théorie des communs telle que mise à jour par Elinor Ostrom articule schématiquement trois éléments constitutifs d’un commun : une ressource, une communauté et une gouvernance. Le commun se réalise ainsi lorsqu’une communauté définit collectivement une gouvernance pour gérer et partager une ressource. De ce principe très schématique, on comprend que la pratique des communs consiste alors à la fois en l’usage et la préservation d’une ressource et en l’exercice des modalités de gouvernance décidées collectivement. Les commoners, les praticiens des communs, étendent cependant le rayon d’action de cette pratique. Dans l’ouvrage Patterns of commoning (2016), Bollier et Helfrish établissent un paysage d’actions et de pensées des communs au-delà des ressources et communautés localement identifiées. Selon eux, « les communs ne sont pas des choses, des ressources ou des biens ; ils sont un tissu organique de structures et de processus vivants »“Yet commons are not things, resources or goods; they are an organic fabric of social structures and processes.” (2016, 2)
(2016, 2). Pensés comme « un cadre social de relations »“[…] understanding the social phenomena of commons, which are at their core ‘relational social frameworks’.” (2016, 3)
, les communs relèvent d’un agir et d’un habiter, dont ils nomment la pratique un commoning“The drama of commoning is an active, living process – a verb rather than a noun. We consider it to be an aspect of the human condition, an ongoing social process that never repeats in exactly the same way.” (2016, 3)
. Il n’est plus question alors de modalités économiques de gestion de ressources, mais « de penser, d’apprendre et d’agir en commoners ». C’est dans cet esprit de commoning que nous avons voulu avec Sylvia Fredriksson fabriquer le dossier de la revue Sens public, en remettant le collectif au cœur de la production et de la gouvernance. Est-il possible d’appliquer les principes du commun à un objet éditorial ? En tant que pratiques, l’écriture ainsi que la lecture et l’édition peuvent-elles se communiser ?
La légitimité : une affaire collective
Outre la première récursivité déjà discutée consistant à écrire (et éditer) les communs en train de s’écrire – de manière à engager les contributeurs dans une démarche de réflexivité sur leurs pratiques – une seconde récursivité apparaît tout aussi stimulante du point de vue de l’hypothèse défendue ici. Constatant en effet les limites de l’évaluation scientifique institutionnellement reconnue dans le cadre de l’édition scientifique, nous avons suggéré que des formes conversationnelles de production de connaissances permettraient de dépasser ces limites et de déplacer le véritable enjeu de la grande conversation scientifique d’une production éditoriale à l’avènement d’un collectif. Or, si l’évaluation scientifique repose sur la collégialité des pairs, incarnée dans des protocoles de lecture, de vérifications et de validation, cette collégialité est en réalité tout à fait partielle, voire inexistante. La collégialité suppose que « les décisions émanent d’un organe collectif dont les membres ont des pouvoirs égaux »D’après la définition du TLFI.
. Que peut-on dire pourtant d’une collégialité anonyme ? Peut-on qualifier de collectif le groupe évaluateurs-éditeurs-auteurs, avec ses relations si singulièrement disposées au nom de l’objectivité ? Quel est le sens de l’objectivité, lorsqu’il s’agit justement de converser sur des problématiques éminemment subjectives ?
Ma recherche-action a donc consisté ici à résolument transformer le protocole éditorial sous-jacent au dossier, en adoptant en premier lieu les pratiques de gouvernance et de collégialité des individus impliqués dans le projet. Nous avons cherché à ouvrir la gouvernance de notre objet éditorial, dont le sujet consistait justement à rendre compte des pratiques éditoriales dans un contexte de gouvernance ouverte.
Un dossier sur les communs en train de s’écrire ne peut qu’adopter les pratiques éditoriales collaboratives qu’il souhaite justement analyser. Le dossier devra donc s’imaginer, avec l’aide de la revue, comme un espace ouvert, tant pour sa gouvernance que pour les discussions à venir. (Fredriksson et Sauret 2019b, extrait de la note d’intention, sur Hypothesis)
En plus d’être cohérente avec le sujet du dossier, cette approche l’est aussi vis-à-vis de l’hypothèse conversationnelle pour l’édition scientifique. Sans encore prétendre à un format nouveau, nous visions la mise en place d’un protocole éditorial original susceptible d’une plus grande collégialité. Celle-ci s’incarne par l’ouverture des discussions (élargir le cercle), leur transparence (qui parle à qui), leur bienveillance (l’intérêt collectif avant les intérêts particuliers), mais aussi la collectivité (c’est-à-dire considérer le collectif avant la connaissance). Ces principes permettent de rejoindre la pratique du commoning, et se présentent comme des réponses directes aux limites déjà évoquées ci-dessus sur les protocoles éditoriaux censés garantir la scientificité des contenus publiés. Une partie de l’expérimentation éditoriale peut donc être considérée comme la tentative de transposer des pratiques existantes dans d’autres communautés de savoir vers la communauté universitaire, ou tout du moins chez les éditeurs scientifiques.
Au-delà de l’hypothèse conversationnelle explorée dans ce cas d’étude demeure la question du collectif, ou du faire collectif. L’expérience aura-t-elle fait « advenir le collectif »Voir la partie précédente Faire advenir le collectif : L’événement Publishing Sphere.
? L’expérience aurait-elle fonctionné si les éditeurs s’étaient emparé·e·s d’une autre thématique – par exemple « Les documents politiques analysés par ordinateur »Voir le dernier numéro de la revue Document numérique (sur Cairn.info).
, peut-être moins porteuse de collectif ? Enfin se pose la question de la scientificité d’une telle production. Le dispositif éditorial aura-t-il fait émerger une meilleure connaissance ?
Mais sans doute la question ne se pose pas ainsi. Si l’on change les modes de production du savoir, il n’est plus nécessairement pertinent de demeurer dans le même paradigme de scientificité. Comme pour le commoning, la finalité n’est pas tant la ressource et sa gestion durable, qu’une relation sociale vertueuse sur les plans humain, collectif et environnemental. Dans ce changement de priorité, il n’est pas question bien entendu d’opposer la rationalité scientifique à une éthique sociale. Il serait plus juste de dire qu’en réaffirmant la prévalence d’un nous sur l’objectivité, il s’agit plutôt de réintégrer du politique dans une communauté de savoir qui cherchait justement, par souci d’objectivité, à s’en défaire.
Comme on l’a vu dans la partie précédente, réaffirmer le collectif n’est pas une évidence au regard du régime de vérité appliqué dans les sciences humaines. Comme l’ont montré les entretiens menés auprès des éditeurs de revue dans le cadre du projet Revue 2.0, les dispositifs censés assurer la scientificité des connaissances entretiennent une collégialité très limitée. Si de telles modalités de légitimation ne sont pas favorables à l’émergence du collectif, elles empêchent certains savoirs d’exister au sein de l’institution scientifique, dans une forme de cloisonnement qui n’est pas sans rappeler les débats sur l’interdisciplinarité.
Des communautés d’écriture élaborent en effet des savoirs complexes, à même de faire émerger et d’organiser une intelligence collective. La communauté du logiciel libre en est probablement un bon exemple, comme l’ont mis en évidence plusieurs travaux (Weber 2005; Singh 2008). À plus petite échelle, la communauté de la MYNE (Manufacture des idées et nouvelles expérimentations) à Villeurbanne entreprend un travail minutieux de documentation de toutes ses activités, avec une approche assumée de commoning (Chow-Petit, Chow-Petit, et Pignot 2018). On retrouve d’ailleurs ces pratiques de documentation dans toute la communauté des tiers lieux (Vigneron et al. 2019), dont la vision hérite largement des principes de l’open source. Wikipédia constitue également un cas emblématique d’une intelligence collective qui procède, selon Dominique Cardon, de « l’attention collective que met chacun à révéler son intelligence en veillant à ce que tous fassent le même effort » (2015, sur Hypothesis).
Que faire alors de ces connaissances qui s’écrivent, s’archivent, s’échangent hors des cadres de l’institution académique ? Y a-t-il une place dans la conversation scientifique pour ces savoirs ancrés dans les pratiques et les territoires ? Le monde universitaire ne gagnerait-il pas à s’ouvrir à ces connaissances, mais aussi et surtout à leurs pratiques de production ?
Faire science autrement
La réconciliation entre sciences et société n’est pas un thème nouveau. Ce thème est notamment traité par la philosophe des sciences Isabelle Stengers qui avance le projet d’une « écologie politique ». Ce que je souhaite montrer maintenant, c’est que le dossier sur les communs en train de s’écrire et la dynamique collective de co-écriture qui le caractérise vient peut-être réaliser cet agenda écologique des connaissances auquel appelle Stengers à la suite de plusieurs penseurs.
L’« écologie politique » vient notamment s’ancrer dans les travaux de Guattari (et de son concept d’écosophie), de Donna Harraway (pour son apport sur ce qu’elle a appelé « les savoirs situés »), ou encore de Bruno Latour (en particulier de son ouvrage « Politiques de la Nature » qui dialogue, justement, avec les idées de Stengers). Elle implique une « mise en politique des sciences »« L’écologie politique implique une « mise en politique des sciences », mais cela […] ne veut pas dire une réduction des sciences au politique ou une « politisation » qui contaminerait leur « neutralité ». Il s’agirait plutôt de développer, à propos de chaque situation problématique, les questions politiques primordiales : qui peut parler de quoi ? être le porte-parole de quoi ? et à quelles conditions ? » (Stengers 2013, 132)
qui consiste en l’ouverture et l’interconnexion des savoirs, en particulier le savoir scientifique, qui depuis la modernité, a acquis une position hégémonique au service du paradigme capitaliste, et légitimée par la double injonction au progrès et à la rationalité.
Rendre ce savoir « politiquement actif » suppose de remettre en conversation les « faits » dont s’occuperaient les scientifiques, et les « valeurs » dont s’occuperait la société civile. Comme le rappelle Stengers, Bruno Latour propose un autre partage éloquent, distinguant « matter of fact » et « matter of concern », ce dernier pouvant se traduire comme nos « inquiétudes »Terme manifestement latourien avec lequel Camille Louis incitait le groupe des Institutions fictionnelles à exprimer de quels terrains, territoires, pratiques chacun venait.
qui nous obligent à ce que « nous pensions, hésitions, imaginions, prenions position » (Stengers 2013, 9). Cette réintroduction du politique impose au chercheur de prendre en compte le collectif, ce nous déjà présent et concerné par son objet d’étude.
I will propose that scientific thought collectives, facing the prospect of their destruction, should actively accept that their concern for ‘facts’ must include the way these facts come to matter for other collectives.Que je traduis ainsi : « Je proposerai que les collectifs de pensée scientifique, confrontée à la perspective de leur destruction, acceptent activement que leur préoccupation pour les “faits” inclue la façon dont ces faits sont pris en compte par d’autres collectifs. »
(Stengers 2018, 84)
Il s’agit ici d’un appel à une déhiérarchisation des savoirs qui n’est pas sans rappeler les projets féministes et post-coloniaux, et dans leur sillage la pensée post-humaine. Isabelle Stengers défend ainsi la vision d’une « science située » qui fait écho aux Politiques de la nature de Bruno Latour« Se réapproprier [la pratique expérimentale] comme telle, contre sa capture par un modèle général de connaissance objective, a pour corrélat la nécessité de prolonger et de renouveler ces questions dans chaque nouveau milieu, pour chaque nouvelle situation problématique, ce qui correspond à la procédure proposée par Bruno Latour dans ses Politiques de la nature. Pour les scientifiques, cela signifie d’abord l’obligation d’avoir à présenter ce qu’ils pensent sur un mode ‘civilisé’[…]. Ils auraient, en d’autres termes, à présenter leur savoir comme partie prenante de chaque situation problématique où il pourrait faire une différence, mais sans prétendre au moindre privilège quant à la manière dont le problème est formulé et dont ses solutions seront envisagées. » (2013, 132)
et au concept de « savoir situé » de Donna Haraway« L’épreuve qui m’intéresse, celle de ce que Donna Haraway appelait dès 1988 un ‘savoir situé’, désigne ce qui précisément, et de manière concrète, a pour vocation de contester ce rapport privilégié des sciences aux questions d’intérêt collectif. […] Être capable de se situer, de situer ce qu’on sait, […] implique d’être redevable à l’existence des autres, de celles et ceux qui posent d’autres questions, font importer autrement une situation, qui peuplent un paysage sur un mode qui en interdit l’appropriation au nom de quelque idéal abstrait que ce soit. » (2013, 48‑49)
. L’enjeu est de renouer la connaissance scientifique avec les pratiques et les affaires de la cité.
Je ferai ici le choix de définir les sciences par la singularité d’un travail collectif, où la valeur d’une proposition individuelle est celle d’une ‘contribution’ à une dynamique d’ensemble. (2013, 58)
Il est intéressant de voir que Stengers reconnait dans le projet scientifique la dynamique collective de production de savoir. Mais elle conteste la validité de ses principes, et en particulier de ses modes d’évaluation. Dans le chapitre L’emprise de l’évaluation, elle synthétise à grands traits les dérives de l’évaluation de la « science rapide », biaisée à la fois par un contexte de compétition et d’accélération et par les conditions hors-sol requises pour valider l’expérimentation. Or ce modèle d’évaluation, nous dit-elle, est adopté comme un idéal de scientificité, y compris pour les sciences molles. Elle en appelle à une slow science, renouant avec une pluralité des savoirs et une pluralité des modes d’évaluation.
[J]e voudrais plaider pour un ralentissement des sciences qui ne soit pas un retour à un passé quelque peu idéalisé, où les chercheurs honnêtes et méritants étaient justement reconnus par leurs pairs. Ce ralentissement devrait impliquer une prise en compte active de la pluralité des sciences, à laquelle devrait répondre une définition plurale, négociée et pragmatique (elle-même évaluée à partir de ses effets) des modes d’évaluation et de valorisation des différents types de recherche. (Stengers 2013, 55)
[L]es critères [d’évaluation de la recherche], tout formels qu’ils soient, aveugles au contenu, n’en sont pas moins contradictoires avec ce qui donne sens [à l’]activité [des chercheurs], et qu’ils sont non négociables. (Stengers 2013, 52)
Peut-on réinterpréter notre dossier des communs à l’aune de la vision de Stengers d’une science ralentie et partie prenante d’une écologie politique ? La collégialité mise en place entre praticiens situés ne valide-t-elle pas une autre manière de « faire science » ? Par ailleurs, l’ouverture de la revue Sens public non pas tant à des savoirs alternatifs, mais à des modes alternatifs d’écriture et de production de connaissances, ne témoigne-t-elle pas d’un possible renouvellement des formes, qui plus est dans le sens d’un faire collectif ? C’est peut-être finalement ce qu’on pourra retenir du processus éditorial de notre dossier, à savoir une proposition pour ouvrir au sein des revues scientifiques des espaces alternatifs et collectifs, accordant aux textes une nouvelle temporalité inscrite dans la durée. Par leur éditorialisation et leur mise en conversation, l’article, la monographie ou n’importe quelle autre production savante peuvent en effet s’extraire au couperet de la publication et adopter la posture paisible et réfléchie de la slow science.
Il est tentant alors d’intégrer dans ce collectif les connaissances elles-mêmes, en reprenant la notion de « collectif hybride » issue de la théorie de l’acteur-réseau et avec laquelle Michel Callon et Bruno Latour désignent les associations entre humains et non-humains. Ce pont théorique peut sembler audacieux, mais il coïncide avec plusieurs travaux que synthétise Lionel Maurel dans un essai (en cours d’écriture) intitulé « Accueillir les non-humains dans les communs » (Maurel 2019). L’auteur y articule des propositions théoriques convergeant toutes, malgré la diversité des champs ou disciplines, vers une écologie refusant la « rupture ontique » entre acteurs humains et non-humains.
Il n’est pas surprenant que la pensée écologique récente innerve celle des communs. Isabelle Stengers livre d’ailleurs avec Serge Gutwirth un essai conséquent sur « le droit à l’épreuve des communs » (Gutwirth et Stengers 2016). Plus récemment dans son ouvrage « Réactiver le sens commun » (2020), elle concrétise son idée d’écologie politique dans ce qu’elle appelle des « dispositifs génératifs » susceptibles de nous faire renouer collectivement avec le « sens commun ». Sur le modèle de la palabre en AfriqueSur Wikipédia : « La palabre est une coutume de rencontre, et de création ou de maintien de lien social. Elle apparaît comme une véritable institution sociale à laquelle participe tout ou partie de la communauté d’un village. »
, ou encore des rites quaker, ces dispositifs, que l’on pourrait qualifier de conversationnels, doivent permettre la rencontre des antagonismes, rencontre pour laquelle il ne s’agit plus d’avoir raison, mais d’entendre l’autre. Cette civilité permet en fait à des collectifs de savoirs d’exister. Elle est sans doute à rapprocher du concept de bienveillance que défendait Louise Merzeau dans sa vision des dispositifs d’éditorialisationVoir au chapitre La revue format la partie « Bienveillance ».
. Pour Stengers, l’enjeu dans la conversation réside dans l’ouverture de nouveaux imaginaires à même d’appréhender le monde dans sa complexité ; ce que fait peut-être à sa manière le Général Instin…
Parallèle à faire entre la transgression des frontières politiques, religieuses propre à la pratique épistolaire de la République des lettres, et la transgression des disciplines ou plutôt de l’hybridation ou de la contamination des communautés de savoir entre elles, notamment hors académie
Conclusion
Ce chapitre livre le récit d’un parcours à la fois théorique et pratique, dont chaque étape apporte un éclairage nouveau sur ces deux concepts, la conversation et le collectif, ainsi que sur l’éditorialisation qui les performe et les articule. D’un cas d’étude à l’autre, j’ai essayé de montrer leur profonde imbrication au sein d’une écriture plurielle, processuelle et en mouvement. De la diversité des terrains se dégage une constante, habitant d’ailleurs les écrits de penseur·se·s et d’observateur·rice·s du monde contemporain. Ces dernier·ère·s convergent tou·te·s vers une écologie, à savoir la conscience et le soin d’un milieu. La déhiérarchisation à l’œuvre dans ces pensées interpelle bien sûr l’anthropocentrisme qui a caractérisé une époque moderne aujourd’hui à bout de souffle. Mais elle concerne aussi les savoirs et les institutions qui les autorisent. À travers la conversation, je tente d’envisager une approche de la pluralité intégrative des savoirs, en reconnaissant la nécessité de leur diversité que les processus de légitimation institutionnalisés ont malheureusement tendance à écarter pour des critères d’objectivité et de scientificité.
Adoptés par les revues en lettres et sciences humaines sous la pression institutionnelle pour favoriser le modèle de légitimation des sciences dures, ces critères ont été formalisés dans les protocoles éditoriaux pour mimer une certaine scientificité et objectivité. Or, la crise de l’édition savante révélait déjà le non-sens de ces postulats pour des domaines fortement ancrés dans la subjectivité. Aujourd’hui, la profonde mutation des supports d’écriture et de publication jette en fait une lumière crue sur cette contradiction, tant les conversations, et avec elles les subjectivités, ne souffrent plus d’être contenues dans ces protocoles. Ainsi les revues, en tant qu’instances éditoriales, peuvent entamer un mouvement d’émancipation, tant il est nécessaire (et possible) de libérer l’écriture à nouveau, au travers d’une série de principes que j’ai pu mettre en évidence dans ce chapitre à travers différents cas pratiques.
Il s’agit tout d’abord de remettre en mouvement les ressources et les connaissances en en fluidifiant la circulation. Les éditeurs doivent créer les conditions d’appropriation des ressources documentaires, d’une part en favorisant leur fragmentation, et d’autre part en proposant des dispositifs d’écriture permettant de les recontextualiser. Un tel mouvement aura pour objectif de mettre les fragments et les individus en conversation. J’ai montré par ailleurs l’importance de considérer l’écriture comme un processus continu et collectif, s’inscrivant dans un milieu tout en l’inscrivant, c’est-à-dire en le façonnant. Ces « écritures dispositives » suggèrent à nouveau la conversation, dont le mouvement doit être celui de la pensée collective. On comprend que cette dernière ne fera sens qu’en se saisissant des questions collectives. Cette écriture en mouvement relève ainsi d’une écologie politique au sens où d’un côté elle fait corps avec son milieu, et de l’autre elle réaffirme la primordialité du soin, celui son milieu et de tous ses acteurs. Enfin, un dernier principe suppose l’émancipation des revues vis-à-vis des protocoles éditoriaux institutionnalisés. L’éclatement des règles ne peut se faire qu’en cohérence avec les principes précédents de l’écriture et de la conversation. Il se joue sur de multiples plans. Il s’agit tout d’abord d’une double ouverture du protocole. L’ouverture au sens de la transparence d’une part, en dévoilant à la communauté de la revue les conversations qui jalonnent le processus éditorial. L’ouverture au sens d’un élargissement de la collégialité d’autre part, en considérant que les fonctions éditoriales de sélection et de validation doivent être redistribuées au collectif. Cette ouverture de la collégialité est aussi celle d’une plus grande intégration des savoirs alternatifs et non institutionnels, par exemple les savoirs portés par les communautés concernées par la problématique dont une revue – un collectif – s’empare. La fonction éditoriale de la revue et de son équipe peut alors se décentrer sur la mise en œuvre du dispositif et de ses protocoles, à savoir créer les conditions de possibilité de l’appropriation et de la conversation. Mais l’ouverture ne s’arrête pas là. Car une fois ces conditions réunies par l’éditeur, celui-ci peut encore confier la gouvernance éditoriale elle-même au collectif. Ainsi, la conception même du protocole doit pouvoir anticiper le partage de sa gouvernance, c’est-à-dire permettre au collectif de la revue de constamment discuter et valider les modalités d’écriture et de conversation, soit leurs dispositifs. C’est le principe de l’écriture dispositive que de pouvoir façonner son milieu d’écriture, et d’habiter un espace en le structurant.
Une telle entreprise relève effectivement d’une pratique éditoriale qui est aussi une écologie politique. L’approche du commoning telle que nous l’avons appliquée pour le dossier « Écrire les communs » constitue en cela un modèle, que d’autres initiatives éditoriales sauront perfectionner. En effet, la récursivité de l’écriture sur le collectif confirme la finalité première de l’entreprise éditoriale, à savoir non pas la production d’un artefact documentaire, mais l’affirmation du collectif. Réintégrer du politique dans les sciences humaines suppose ainsi de prendre soin du collectif. Comme le dit Stengers, il s’agit pour les scientifiques de ne plus considérer seulement le monde comme une somme d’objets d’étude, mais de considérer les problématiques que le monde et ses collectifs au sens large nous intiment de dénouer.
Bibliographie
Agamben, Giorgio. 2014. Qu’est-Ce Qu’un Dispositif? Éditions Payot & Rivages.
Aigrain, Philippe. 2005. « Alternance et articulation ». Ars Industrialis. http://www.arsindustrialis.org/node/1944.
Audet, René, Nicolas Sauret, Servanne Monjour, Margot Mellet, Jean-Louis Soubret, Julie Blanc, Renée Bourrassa, et al., éd. 2018. Version 0. Notes Sur Le Livre Numérique. Montréal: CRC en écritures numériques / Codicille éditeur.
Bardini, Thierry. 2016. « Entre archéologie et écologie. Une perspective sur la théorie médiatique. » Multitudes, nᵒ 62 (avril): 159‑68.
Besson, Rémy. 2014. « Prolégomènes pour une définition de l’intermédialité ». Cinémadoc. http://culturevisuelle.org/cinemadoc/2014/04/29/prolegomenes/.
Bollier, David, et Silke Helfrish. 2016. Patterns of Commoning. The Commons Strategy Group.
Bomsel, Olivier. 2013. Protocoles éditoriaux - Qu’est-ce que publier ? Armand Colin.
Caligaris, Nicole. 2015. « L’auteur Comme Copiste ». In Anthologie Général Instin, 51. Othello. Paris: Le Nouvel Attila | Remue.net.
Cardon, Dominique. 2015. « Surveiller sans punir. La gouvernance de Wikipédia ». In Wikipédia, objet scientifique non identifié, édité par Lionel Barbe, Louise Merzeau, et Valérie Schafer, 15‑39. Sciences humaines et sociales. Nanterre: Presses universitaires de Paris Nanterre.
Chatelier, Patrick. 2019. « Général à vendre ». Revue littéraire. Remue.net.
Choplin, Hugues. 2020. Le collectif et ses énigmes. Philosophie. Hermann.
Chow-Petit, Benjamin, Connie Chow-Petit, et Lisa Pignot. 2018. « La MYNE : pour une capacité d’agir citoyenne ». L’Observatoire N 52 (2): 53‑55.
Collectif. 2020. « Knowledge is a commons - Pour des savoirs en commun ». Sens public, juin.
Doueihi, Milad. 2011. La Grande Conversion Numérique ; Suivi de Rêveries d’un Promeneur Numérique. Traduit par Paul Chemla. Points. Série Essais, ISSN 1264-5524. Paris, France: Éd. du Seuil.
Drucker, Johanna. 2013. « Performative Materiality and Theoretical Approaches to Interface ». Digital Humanities Quarterly 007 (1).
Dyens, Ollivier. 2015. « Lecture du troisième hémisphère ». In Virus, parasites et ordinateurs, 35‑82. Parcours Numériques. Montréal: Les Presses de l’Université de Montréal.
Eynaud, Léa, et Frédéric Sultan. 2019. « Communs, outils numériques et diversité du mouvement . Enquête sur la liste de diffusion Échanges du Réseau francophone des biens communs ». Sens public, septembre.
Fauchié, Antoine. 2019. « Vers un système modulaire de publication : éditer avec le numérique ». Mémoire, Enssib.
Flückiger, François, et Tim Smith. s. d. « Le Web Sous Licence | CERN ». https://home.cern/fr/science/computing/birth-web/licensing-web.
Fredriksson, Sylvia, et Nicolas Sauret. 2019a. « Écrire Les Communs. Au-Devant de l’irréversible ». Sens public, mars.
———. 2019b. « Écrire les communs. Au-devant de l’irréversible ». Sens public, mars.
Georges, Fanny. 2009. « Représentation de soi et identité numérique ». Reseaux n 154 (2): 165‑93.
Goody, Jack. 1979. La Raison Graphique. La Domestication de La Pensée Sauvage. Le Sens Commun. Les Editions de Minuit.
Gutwirth, Serge, et Isabelle Stengers. 2016. « Le Droit à l’épreuve de La Résurgence Des Commons ». Revue Juridique de l’Environnement, nᵒ 2016/2: 306‑43.
Haraway, Donna. 1985. « Manifesto for Cyborgs: Science, Technology, and Socialist Feminism in the 1980s ». Socialist Review, nᵒ 80: 65‑108.
Hardin, Garrett. 1968. « The Tragedy of the Commons ». science 162 (3859): 1243‑8.
Huhtamo, Erkki, et Jussi Parikka. 2011. Media Archaeology: Approaches, Applications, and Implications. Univ of California Press.
Jacob, Christian. 2007. Lieux de Savoir - Tome 1. Albin Michel.
Jahjah, Marc. 2018. « Les "communautés de vérité" de la culture numérique ». Marc Jahjah.
———. 2019. « L’annotation comme "conversation" (1/2) : des humanistes aux acteurs du web ». Carnet de recherche. Marc Jahjah.
Jenkins, Henry. 2006. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. New York: New York University Press.
Lalande, Romain. 2019. « Des outils à la trace : vers des communs créolisés qui habitent le monde ? » Sens Public, juillet.
Lankes, R. David. 2016. The New Librarianship Field Guide. The MIT Press.
Lapointe, Jean-Michel, et Marie D. Martel. 2019. « Glossaire ». In Exigeons de meilleures bibliothèques. Les Ateliers de [sens public].
Larrue, Jean-Marc. 2015. « Du média à la médiation : les trente ans de la pensée intermédiale et la résistance théâtrale ». In Théâtre et intermédialité, édité par Jean-Marc Larrue, 27‑56. Presses universitaires du Septentrion. https://doi.org/10.4000/books.septentrion.8158.
Lévy, Pierre. 1998. « La Place de La Médiologie Dans Le Trivium ». Les cahiers de médiologie, nᵒ 2: 43‑58.
Macé, Marielle. 2018. « Les Noues ». Posie N 164 (2): 64‑67.
Maurel. 2019. « Accueillir les Non-Humains dans les Communs (Introduction) ». - S.I.Lex -.
Maurel, Lionel. 2018. « Coopyright : enfin une licence à réciprocité pour faire le lien entre Communs et ESS ? » - S.I.Lex -.
McLuhan, Marshall. 1976. « Formal Causality in Chesterton ». The Chesterton Review 2 (2): 253‑59.
Merzeau, Louise. 2007. « Une nouvelle feuille de route ». Médium, nᵒ 13: 3‑15. https://doi.org/10.3917/mediu.013.0003.
———. 2013a. « L’intelligence Des Traces ». Intellectica - La revue de l’Association pour la Recherche sur les sciences de la Cognition (ARCo) 1 (59): p.115‑135.
———. 2006. « Médiologie : Une Arme à Double Tranchant ». merzeau.net. https://web.archive.org/web/20060216143300/www.merzeau.net/txt/mediation/guerre.html.
———. 2010. « L’intelligence de l’usager ». In L’usager numérique : séminaire INRIA, ADBS, 9‑37. Sciences et techniques de l’information. Paris.
———. 2012. « La médiation identitaire ». Revue française des sciences de l’information et de la communication, nᵒ 1 (juillet). https://doi.org/10.4000/rfsic.193.
———. 2013b. « Éditorialisation collaborative d’un événement ». Communication et organisation, nᵒ 43 (juin): 105‑22. https://doi.org/10.4000/communicationorganisation.4158.
———. 2014. « Entre Événement et Document : Vers l’environnement-Support ». Les Cahiers de la SFSIC, nᵒ 9 (janvier): 230‑33.
———. 2017. « De la bibliothèque à l’Internet : la matrice réticulaire ». In Robert Damien, du lecteur à l’électeur. Bibliothèque, démocratie et autorité. BnF Éditions / Presses de l’Enssib.
Meunier, Jean-Guy. 2014. « Humanités numériques ou computationnelles : Enjeux herméneutiques ». Sens Public, décembre.
Monjour, Servanne. 2018. Mythologies Postphotographiques. L’invention Littéraire de l’image Numérique. Parcours Numériques 10. Montréal: Presses Universitaires de Montréal.
———. 2020. « Les impensés de la littérature contemporaine. Une lecture de Moderne/contemporain de Pascal Mougin ». Sens public, mai.
Monjour, Servanne, et Nicolas Sauret. 2017. « Éditorialisation et littérature : le cas du Général Instin ». In Des humanités numériques littéraires ? Cerisy.
Ostrom, Elinor. 1990. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Political Economy of Institutions and Decisions. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763.
Ostrom, Elinor, Roy Gardner, James Walker, et Jimmy Walker. 1994. Rules, Games, and Common-Pool Resources. University of Michigan Press.
Parikka, Jussi. 2013. What Is Media Archaeology? John Wiley & Sons.
Patrin-Leclère, Valérie. 2011. « La communication revisitée par la conversation ». Communication langages N 169 (3): 15‑22.
Rongier, Sébastien. 2017. « Le Général Instin, les vies multiples du littéraire ». Fabula Colloques, février.
Ruffel, Lionel. 2016. Brouhaha. Les mondes du contemporain. EPUB. Lagrasse: Verdier.
Sauret, Nicolas, et Ariane Mayer. 2016. « L’autorité Dans Anarchy. Les Constructions de l’autorité Dans Un Dispositif de Production Littéraire Collaborative : Le Cas de l’expérience Transmédia Anarchy.Fr ». In Colloque Médiations Informatisées de l’autorité - GRIPIC, ISCC, ComSol. Paris.
Singh, Vandana. 2008. « Knowledge Creation, Sharing and Reuse in Online Technical Support for Open Source Software ». Ph.D., Ann Arbor, United States.
Souchier, Emmanuël. 1998. « L’image du texte pour une théorie de l’énonciation éditoriale ». Les cahiers de mediologie N 6 (2): 137‑45.
Stengers, Isabelle. 2013. Une Autre Science Est Possible! Manifeste Pour Un Ralentissement Des Sciences. Les Empêcheurs de Tourner En Rond. La Découverte.
———. 2018. Another Science Is Possible. A Manifesto for Slow Science. Traduit par Stephen Muecke. Polity Press.
———. 2020. Réactiver Le Sens Commun. Lecture de Whitehead En Temps de Débâcle. Les Empêcheurs de Tourner En Rond. La Découverte.
Vial, Stéphane, et Marie-Julie Catoir-Brisson. 2017. « Nouvelles mises en expérience du texte : design, littératie, édition ». In Design & innovation dans la chaîne du livre. Écrire, éditer, lire à l’ère numérique, 260. Hors collection. Presses Universitaires de France.
Vigneron, Nicolas Belett, Émilie Picton, Sébastien Beyou, et Xavier Coadic. 2019. « De l’hypothèse de la documentation comme technique de résistance et du wiki comme objet de ces résistances ». Sens public, mars.
Vitali-Rosati, Marcello. 2018. On Editorialization: Structuring Space and Authority in the Digital Age. Institute of Network Cultures. Theory on Demand 26.
———. 2015. « Digital Architectures: The Web, Editorialization, and Metaontology ». BlogPost. Culture numérique.
———. 2016. « Qu’est-ce que l’éditorialisation? » Sens public, mars.
Weber, Steven. 2005. The Success of Open Source. Cambridge; London: The Belknap Press of Harvard University Press.
Wormser, Gérard. 2018. Facebook. L’école Des Fans. Les atelier de Sens public.
Zacklad, Manuel. 2008. « Participative Documentary Spaces and Governance ». International Journal of Sustainable Development 11 (2/3/4): 247. https://doi.org/10.1504/IJSD.2008.026504.
———. 2007a. « Réseaux et communautés d’imaginaire documédiatisées ». In A Document (Re)turn: Contributions from a Research Field in Transition, Frankfurt am Main: Peter Lang, 64:279‑97. Roswitha Skare, Niels Windfeld Lund, Andreas Vårheim.
———. 2007b. « Espace documentaire participatif et gouvernance ». In Congress of the European Regional Science Association (47th Congress) and ASRDLF (Association de Science Régionale de Langue Française, 44th Congress) PARIS - August 29th - September 2nd, 2007., ?
———. 2012. « Organisation et architecture des connaissances dans un contexte de transmédia documentaire : les enjeux de la pervasivité ». Études de communication. langages, information, médiations, nᵒ 39 (décembre): 41‑63. https://doi.org/10.4000/edc.4017.
———. 2019. « Le design de l’information : textualisation, documentarisation, auctorialisation ». Communication langages N 199 (1): 37‑64.